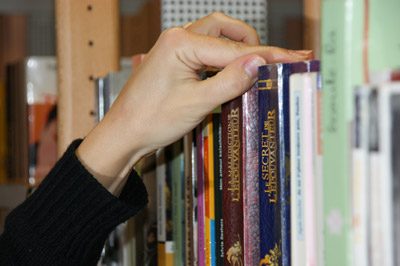|
| Titre : |
Contribution a l’étude de l’ethnomédecine vétérinaire dans la région de Kolda (Sénégal). |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Mouhammad DIARRA, Auteur |
| Editeur : |
Dakar : EISMV |
| Année de publication : |
2024 |
| Importance : |
142p. |
| Langues : |
Français (fre) |
| Catégories : |
THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2024
|
| Mots-clés : |
MEDECINE TRADITIONNELLE MEDECINE VETERINAIRE SENEGAL |
| Index. décimale : |
TD-THESE DE DOCTORAT |
| Résumé : |
L'élevage représente un secteur important pour la subsistance des habitants des pays d'Afrique subsaharienne. Dans ces pays, les agriculteurs élèvent du bétail pour répondre aux besoins alimentaires des ménages et comme sources de revenus supplémentaires, mais sa production est entravée par des maladies animales endémiques. L'impact des maladies animales est particulièrement grave pour les communautés pauvres qui, bien que dépendant fortement du bétail, ont un accès limité aux services vétérinaires modernes et dépendent donc des médicaments indigènes pour le traitement des maladies du bétail. Ces pratiques sont toujours basées notament sur des croyances populaires et sur la flore. Mais dans un contexte sanitaire mondial caractérisé par la résistance aux antimicrobiens associés aux dérèglements climatiques, il apparait urgent de consolider cette médecine traditionnelle qui, du fait de son mode de conservation et de sa transmission orale risque de grosses pertes dans son contenu au fil des décennies. C’est dans cette vision que sous le financement du projet Thiellal (une seule santé en Pulaar) qui est porté par l’ONG Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) en tant que chef de file, nous avons pu apporter notre modeste contribution à cet édifice.
Notre étude s’est effectuée dans la région de Kolda, auprès des quatres communes de Vélingara (Ouassadou, Pakour, Paroumba et Linkéring) situées sur le long de la frontière avec la Guinée Conakry et la Guinée Bissau. Cent éléveurs et tradipraticiens sont intérogés dont 88 hommes et 12 femmes à travers des entretiens semi-structurés sur la base d’un questionnaire auprès des populations locales. La tranche d’âges des personnes enquêtées varie de 32 à 96 dont la majorité des tradipraticiens a un âge supérieur à 50ans. Les points abordés étaient le fonctionnement général de l’élevage, les types de maladies rencontrées (les affections des appareils digestifs, reproducteurs, respiratoires, cutanés et musculaires), les remèdes traditionnels utilisés contre chaque type d’affection. Les données relatives aux plantes galactogènes, fourragères et toxiques ont été collectées. Et pour toutes les plantes ou substances citées, le nom local, la partie utilisée, les modes de préparation et d’administration, la posologie et l’efficacité du traitement par rapport au traitement moderne ont été précisés.
Les résultats de notre étude ont montré que plus de trente et deux (32) affections et pathologies sévissent dans la zone. Elles sont dominées par la fièvre aphteuse, la pasteurellose, la peste des petits ruminants (PPR), la dermatose nodulaire cutanée des bovins (DNCB), le charbon symptomatique, les trypanosomoses ainsi que la maladie de Newcastlle et la variole aviaire.
Concernant les plantes nous avons répertorié cent quarante-six (146) espèces végétales réparties en cinquante-quatre (55) familles dont les mieux représentées sont par ordre d’importance les Fabacées (15,27% des espèces); les Combrétacées et les Rubiacées représentent chacune 6,87% des espèces; les Malvacées et les Poacées représentent chacune 6,11% des espèces ; les Apocynacées (4,58% des espèces) ; les Solanacées (3,82%) ; les Anacardiacées et les mimosacées représentent chacune 3,05% des espèces.
Les organes de plantes les plus utilisées sont les écorces et les feuilles. Le pilage est le mode de préparation le plus utilisé dans la zone d’étude qui représente effectivement 34%, suivi la macération (26%) et la décoction (09%), le séchage et la calcination représentent 02%. 29% des cas ne subissent aucune transformation et sont donnés directement. À coté des plantes, 50 autres substances sont utilisées dans le traitement de ces affection, dont les plus citées sont: Le sel, le charbon, les termitières, les sables de rizière, le lait, le vin, l’argile, le miel, le savon, le pétrole, l’essence, huile de moto, le sucre, les lessives en poudre, l’eau de javel, le cendre, les beurres de vache, les poissons de rizière, les urines et les crottins. Deux principales voies ont été décrites. La voie orale domine avec 70% suivie de la voie locale qui représente 30% dont 27% pour la voie cutanée, 1% pour la voie nasale, 1% pour la voie intravaginale et 1% pour la voie anale). Les recettes monospécifiques représentent 96% quant aux recettes plurispécifiques ne sont que 4%.
De nombreuses espèces sont utilisées pour l’alimentation du cheptel, la famille des Fabacées et Poacées sont les mieux représentées. La population utilise également certaines espèces de plantes pour améliorer la productivité du lait des vaches locales dont les plus représentées sont : Ptérocarpus erinaceus, Adansonia digitata et Gossypium herbaceum. Quelques plantes toxiques ont été rapportées mais se raréfient de plus en plus dans la plupart du temps de la zone du fait que certains bergers qui font la transhumance, les brulent pour empêcher à leurs animaux de les consommer. La médecine traditionnelle, malgré les pressions d’origines diverses qu’elle subit survit toujours et parvient même parfois à suppléer la médecine moderne. Ceci pose alors l’imposante nécessité d’une collaboration plus étroite entre les médecines vétérinaires traditionnelle et moderne qui serait profitable à tous et jetterait peut être les bases d’une nouvelle ère de la médecine vétérinaire. |
| PRESIDENT DE JURY : |
M. DIOP Amadou, Pr Titulaire à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’odontologie de Dakar |
| DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : |
M. LAPO Rock Allister, Maitre de conférences agrégé à l’E.I.S.M.V. de Dakar |
| RAPPORTEUR : |
M. LAPO Rock Allister, Maitre de conférences agrégé à l’E.I.S.M.V. de Dakar |
| MEMBRE : |
Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr Titulaire à l’E.I.S.M.V. de Dakar |
| DATE DE SOUTENANCE : |
21/06/2024 |
| PAYS : |
Sénégal |
| Permalink : |
./index.php?lvl=notice_display&id=5161 |
Contribution a l’étude de l’ethnomédecine vétérinaire dans la région de Kolda (Sénégal). [texte imprimé] / Mouhammad DIARRA, Auteur . - Dakar : EISMV, 2024 . - 142p. Langues : Français ( fre)
| Catégories : |
THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2024
|
| Mots-clés : |
MEDECINE TRADITIONNELLE MEDECINE VETERINAIRE SENEGAL |
| Index. décimale : |
TD-THESE DE DOCTORAT |
| Résumé : |
L'élevage représente un secteur important pour la subsistance des habitants des pays d'Afrique subsaharienne. Dans ces pays, les agriculteurs élèvent du bétail pour répondre aux besoins alimentaires des ménages et comme sources de revenus supplémentaires, mais sa production est entravée par des maladies animales endémiques. L'impact des maladies animales est particulièrement grave pour les communautés pauvres qui, bien que dépendant fortement du bétail, ont un accès limité aux services vétérinaires modernes et dépendent donc des médicaments indigènes pour le traitement des maladies du bétail. Ces pratiques sont toujours basées notament sur des croyances populaires et sur la flore. Mais dans un contexte sanitaire mondial caractérisé par la résistance aux antimicrobiens associés aux dérèglements climatiques, il apparait urgent de consolider cette médecine traditionnelle qui, du fait de son mode de conservation et de sa transmission orale risque de grosses pertes dans son contenu au fil des décennies. C’est dans cette vision que sous le financement du projet Thiellal (une seule santé en Pulaar) qui est porté par l’ONG Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) en tant que chef de file, nous avons pu apporter notre modeste contribution à cet édifice.
Notre étude s’est effectuée dans la région de Kolda, auprès des quatres communes de Vélingara (Ouassadou, Pakour, Paroumba et Linkéring) situées sur le long de la frontière avec la Guinée Conakry et la Guinée Bissau. Cent éléveurs et tradipraticiens sont intérogés dont 88 hommes et 12 femmes à travers des entretiens semi-structurés sur la base d’un questionnaire auprès des populations locales. La tranche d’âges des personnes enquêtées varie de 32 à 96 dont la majorité des tradipraticiens a un âge supérieur à 50ans. Les points abordés étaient le fonctionnement général de l’élevage, les types de maladies rencontrées (les affections des appareils digestifs, reproducteurs, respiratoires, cutanés et musculaires), les remèdes traditionnels utilisés contre chaque type d’affection. Les données relatives aux plantes galactogènes, fourragères et toxiques ont été collectées. Et pour toutes les plantes ou substances citées, le nom local, la partie utilisée, les modes de préparation et d’administration, la posologie et l’efficacité du traitement par rapport au traitement moderne ont été précisés.
Les résultats de notre étude ont montré que plus de trente et deux (32) affections et pathologies sévissent dans la zone. Elles sont dominées par la fièvre aphteuse, la pasteurellose, la peste des petits ruminants (PPR), la dermatose nodulaire cutanée des bovins (DNCB), le charbon symptomatique, les trypanosomoses ainsi que la maladie de Newcastlle et la variole aviaire.
Concernant les plantes nous avons répertorié cent quarante-six (146) espèces végétales réparties en cinquante-quatre (55) familles dont les mieux représentées sont par ordre d’importance les Fabacées (15,27% des espèces); les Combrétacées et les Rubiacées représentent chacune 6,87% des espèces; les Malvacées et les Poacées représentent chacune 6,11% des espèces ; les Apocynacées (4,58% des espèces) ; les Solanacées (3,82%) ; les Anacardiacées et les mimosacées représentent chacune 3,05% des espèces.
Les organes de plantes les plus utilisées sont les écorces et les feuilles. Le pilage est le mode de préparation le plus utilisé dans la zone d’étude qui représente effectivement 34%, suivi la macération (26%) et la décoction (09%), le séchage et la calcination représentent 02%. 29% des cas ne subissent aucune transformation et sont donnés directement. À coté des plantes, 50 autres substances sont utilisées dans le traitement de ces affection, dont les plus citées sont: Le sel, le charbon, les termitières, les sables de rizière, le lait, le vin, l’argile, le miel, le savon, le pétrole, l’essence, huile de moto, le sucre, les lessives en poudre, l’eau de javel, le cendre, les beurres de vache, les poissons de rizière, les urines et les crottins. Deux principales voies ont été décrites. La voie orale domine avec 70% suivie de la voie locale qui représente 30% dont 27% pour la voie cutanée, 1% pour la voie nasale, 1% pour la voie intravaginale et 1% pour la voie anale). Les recettes monospécifiques représentent 96% quant aux recettes plurispécifiques ne sont que 4%.
De nombreuses espèces sont utilisées pour l’alimentation du cheptel, la famille des Fabacées et Poacées sont les mieux représentées. La population utilise également certaines espèces de plantes pour améliorer la productivité du lait des vaches locales dont les plus représentées sont : Ptérocarpus erinaceus, Adansonia digitata et Gossypium herbaceum. Quelques plantes toxiques ont été rapportées mais se raréfient de plus en plus dans la plupart du temps de la zone du fait que certains bergers qui font la transhumance, les brulent pour empêcher à leurs animaux de les consommer. La médecine traditionnelle, malgré les pressions d’origines diverses qu’elle subit survit toujours et parvient même parfois à suppléer la médecine moderne. Ceci pose alors l’imposante nécessité d’une collaboration plus étroite entre les médecines vétérinaires traditionnelle et moderne qui serait profitable à tous et jetterait peut être les bases d’une nouvelle ère de la médecine vétérinaire. |
| PRESIDENT DE JURY : |
M. DIOP Amadou, Pr Titulaire à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’odontologie de Dakar |
| DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : |
M. LAPO Rock Allister, Maitre de conférences agrégé à l’E.I.S.M.V. de Dakar |
| RAPPORTEUR : |
M. LAPO Rock Allister, Maitre de conférences agrégé à l’E.I.S.M.V. de Dakar |
| MEMBRE : |
Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr Titulaire à l’E.I.S.M.V. de Dakar |
| DATE DE SOUTENANCE : |
21/06/2024 |
| PAYS : |
Sénégal |
| Permalink : |
./index.php?lvl=notice_display&id=5161 |
|


 Interroger des sources externes
Interroger des sources externesContribution a l’étude de l’ethnomédecine vétérinaire dans la région de Kolda (Sénégal). / Mouhammad DIARRA (2024)