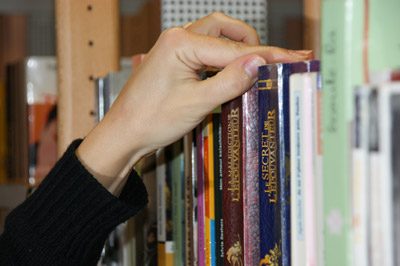EISMV DE DAKAR: Service d'Information et de Documentation
Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (17)


 Interroger des sources externes
Interroger des sources externesEvaluation des mesures de biosécurité et de l’antibiorésistance des souches d’escherichia coli dans deux couvoirs du district de Bamako et en zone péri-urbaine de Bamako (Mali) de 2022 a 2023 / Kadiatou TOURE (2025)

Titre : Evaluation des mesures de biosécurité et de l’antibiorésistance des souches d’escherichia coli dans deux couvoirs du district de Bamako et en zone péri-urbaine de Bamako (Mali) de 2022 a 2023 Type de document : texte imprimé Auteurs : Kadiatou TOURE, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2025 Importance : 83p. Langues : Français (fre) Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2025 Mots-clés : BIOSECURITE ANTIBIORESISTANCE ESCHERIACHIA COLI BAMAKO Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : Au Mali, l’aviculture moderne est surtout localisée dans les zones périurbaines de Bamako, Ségou, Sikasso, Kayes et Mopti. Elle prend de l’essor autour du centre urbain de Bamako et constitue ainsi la principale source d’approvisionnement des populations urbaines en oeufs de consommation et en poulet de chair.
Face à la réémergence de certaines pathologies, à l’utilisation abusive d’antibiotiques en chimioprévention au détriment de l’immunisation et aux échecs thérapeutiques de plus en plus récurrents, l’on est en droit de s’interroger sur l’efficacité des mesures de biosécurité ainsi que des pratiques d’antibiothérapie mises en place par les producteurs dans les couvoirs.
En prenant acte de ce constat, la présente étude a porté sur l’évaluation des mesures de biosécurité et de l’antibiorésistance des souches d’Escherichia coli dans deux couvoirs du district de Bamako et en zone péri-urbaine de Bamako (Mali) de novembre 2022 à juin 2023 soit une période de huit (8) mois.
Après enquête, l’étude révélait que la durée du vide sanitaire, la distance entre les couvoirs et les habitats ainsi que les pratiques pour une bonne gestion des cadavres étaient bien respectés dans les deux couvoirs qui, à leur tour, étaient bien clôturés. Par contre, l’eau de boisson provenait du puits dans l’une des exploitations et les normes de construction n’étaient pas totalement respectées. En plus de cela, (58,33%) des ouvriers n’avaient pas reçu de formation formelle contre (33,33%) qui avaient un niveau secondaire et (8,33%) un niveau primaire. Chaque exploitation était suivie par un agent de santé et possédait également un registre d’élevage à jour. Quant aux programmes de prophylaxie médicale notamment la vaccination, ils étaient établis et réalisés par les agents de santé. Les principales pathologies rencontrées dans ces différentes exploitations étaient surtout la coccidiose, la maladie de Newcastle et la maladie de Gumboro. En ce qui concerne les antibiotiques couramment utilisés, la colistine, l’oxytétracycline, l’érythromycine et l’enrofloxacine pouvaient être énumérés. Selon l’agent de santé de l’une des exploitations, l’échec de l’antibiothérapie était surtout dû au développement de la résistance, à la mauvaise qualité des médicaments, au mauvais diagnostic, à la mauvaise posologie et l’application des consignes d’administration données par l’agent de santé en question et pour finir, l’usage inapproprié et abusif des antibiotiques. Cependant, dans le deuxième couvoir, les agents de santé disaient ne pas avoir connu d’échec car ils faisaient recours à l’antibiogramme avant chaque utilisation d’antibiotique. La colibacillose était bien connue des agents de santé des deux différents couvoirs et étaient également conscients de la notion de résidus contrairement aux ouvriers des exploitations.
Au total, 56 souches d’Escherichia coli ont été isolées soit 12,39% sur 452 échantillons analysés. La méthode de l’antibiogramme par diffusion sur gélose a été utilisée pour tester la sensibilité des bactéries isolées par rapport à 7 antibiotiques d’importance en médecine vétérinaire. La résistance était de 100% (56/56) pour la colistine, 98% (55/56) pour la tétracycline, 93,61% (52/56) pour l’acide nalidixique, 75% (42/56) pour l’amoxicilline, 24,44% (14/56) pour la kanamycine et 6, 25% (3/56) pour la néomycine. 12,5% des isolats étaient résistants à au moins 2 antibiotiques, 53,57% à 3 antibiotiques, 17,85% à 4 antibiotiques et 5,35% à 5 antibiotiques.PRESIDENT DE JURY : M. DIENG Assane Maître de conférences agrégé à la FMPO de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou Pr titulaire à l’EISMV de Dakar. RAPPORTEUR : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou Pr titulaire à l’EISMV de Dakar. MEMBRE : Mme KADJA WONOU Mireille Catherine Maître de conférences agrégé à l’EISMV de Dakar CO-DIRECTEUR : Dr OUSMANE HAMID Abdoul Madihou, ATER à l’EISMV de Dakar/Dr TRAORE Amadou Dit Baba, Vétérinaire épidémiologiste, à la FAO-ECTAD du Mali DATE DE SOUTENANCE : 17/04/2025 PAYS : Mali Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5133 Evaluation des mesures de biosécurité et de l’antibiorésistance des souches d’escherichia coli dans deux couvoirs du district de Bamako et en zone péri-urbaine de Bamako (Mali) de 2022 a 2023 [texte imprimé] / Kadiatou TOURE, Auteur . - Dakar : EISMV, 2025 . - 83p.
Langues : Français (fre)
Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2025 Mots-clés : BIOSECURITE ANTIBIORESISTANCE ESCHERIACHIA COLI BAMAKO Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : Au Mali, l’aviculture moderne est surtout localisée dans les zones périurbaines de Bamako, Ségou, Sikasso, Kayes et Mopti. Elle prend de l’essor autour du centre urbain de Bamako et constitue ainsi la principale source d’approvisionnement des populations urbaines en oeufs de consommation et en poulet de chair.
Face à la réémergence de certaines pathologies, à l’utilisation abusive d’antibiotiques en chimioprévention au détriment de l’immunisation et aux échecs thérapeutiques de plus en plus récurrents, l’on est en droit de s’interroger sur l’efficacité des mesures de biosécurité ainsi que des pratiques d’antibiothérapie mises en place par les producteurs dans les couvoirs.
En prenant acte de ce constat, la présente étude a porté sur l’évaluation des mesures de biosécurité et de l’antibiorésistance des souches d’Escherichia coli dans deux couvoirs du district de Bamako et en zone péri-urbaine de Bamako (Mali) de novembre 2022 à juin 2023 soit une période de huit (8) mois.
Après enquête, l’étude révélait que la durée du vide sanitaire, la distance entre les couvoirs et les habitats ainsi que les pratiques pour une bonne gestion des cadavres étaient bien respectés dans les deux couvoirs qui, à leur tour, étaient bien clôturés. Par contre, l’eau de boisson provenait du puits dans l’une des exploitations et les normes de construction n’étaient pas totalement respectées. En plus de cela, (58,33%) des ouvriers n’avaient pas reçu de formation formelle contre (33,33%) qui avaient un niveau secondaire et (8,33%) un niveau primaire. Chaque exploitation était suivie par un agent de santé et possédait également un registre d’élevage à jour. Quant aux programmes de prophylaxie médicale notamment la vaccination, ils étaient établis et réalisés par les agents de santé. Les principales pathologies rencontrées dans ces différentes exploitations étaient surtout la coccidiose, la maladie de Newcastle et la maladie de Gumboro. En ce qui concerne les antibiotiques couramment utilisés, la colistine, l’oxytétracycline, l’érythromycine et l’enrofloxacine pouvaient être énumérés. Selon l’agent de santé de l’une des exploitations, l’échec de l’antibiothérapie était surtout dû au développement de la résistance, à la mauvaise qualité des médicaments, au mauvais diagnostic, à la mauvaise posologie et l’application des consignes d’administration données par l’agent de santé en question et pour finir, l’usage inapproprié et abusif des antibiotiques. Cependant, dans le deuxième couvoir, les agents de santé disaient ne pas avoir connu d’échec car ils faisaient recours à l’antibiogramme avant chaque utilisation d’antibiotique. La colibacillose était bien connue des agents de santé des deux différents couvoirs et étaient également conscients de la notion de résidus contrairement aux ouvriers des exploitations.
Au total, 56 souches d’Escherichia coli ont été isolées soit 12,39% sur 452 échantillons analysés. La méthode de l’antibiogramme par diffusion sur gélose a été utilisée pour tester la sensibilité des bactéries isolées par rapport à 7 antibiotiques d’importance en médecine vétérinaire. La résistance était de 100% (56/56) pour la colistine, 98% (55/56) pour la tétracycline, 93,61% (52/56) pour l’acide nalidixique, 75% (42/56) pour l’amoxicilline, 24,44% (14/56) pour la kanamycine et 6, 25% (3/56) pour la néomycine. 12,5% des isolats étaient résistants à au moins 2 antibiotiques, 53,57% à 3 antibiotiques, 17,85% à 4 antibiotiques et 5,35% à 5 antibiotiques.PRESIDENT DE JURY : M. DIENG Assane Maître de conférences agrégé à la FMPO de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou Pr titulaire à l’EISMV de Dakar. RAPPORTEUR : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou Pr titulaire à l’EISMV de Dakar. MEMBRE : Mme KADJA WONOU Mireille Catherine Maître de conférences agrégé à l’EISMV de Dakar CO-DIRECTEUR : Dr OUSMANE HAMID Abdoul Madihou, ATER à l’EISMV de Dakar/Dr TRAORE Amadou Dit Baba, Vétérinaire épidémiologiste, à la FAO-ECTAD du Mali DATE DE SOUTENANCE : 17/04/2025 PAYS : Mali Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5133 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T1789 TD25-15 Thèse Bibliothèque (SID) Thèses Vétérinaires Disponible Documents numériques

TD25-15Adobe Acrobat PDFSéroprévalence et facteurs de risque de la Peste Porcine Africaine dans les régions du Poro et du Tchologo (Côte d’Ivoire) en 2024. / Amenan Tania Morelle KONAN (2025)

Titre : Séroprévalence et facteurs de risque de la Peste Porcine Africaine dans les régions du Poro et du Tchologo (Côte d’Ivoire) en 2024. Type de document : texte imprimé Auteurs : Amenan Tania Morelle KONAN, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2025 Importance : 93p. Langues : Français (fre) Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2025 Mots-clés : PESTE PORCINE AFRICAINE SEROPREVALENCE PORO TCHOLOGO COTE D'IVOIRE Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : Les régions du Poro et du Tchologo au nord de la Côte d’Ivoire ont connu leur première épizootie de PPA en 2017. Depuis lors, des mortalités imputées à cette pathologie sont signalées tous les ans, malgré l’adoption de différentes stratégies de lutte mises en oeuvre par l’État. La présente étude avait pour objectif de connaitre la séro-épidémiologie de la PPA en Côte d’Ivoire après le foyer de 2017. Pour cela, une enquête CAP a été entreprise auprès de 79 porciculteurs, suivie d’une enquête sérologique. 432 échantillons de sang de porc ont été récoltés et suite à des hémolyses, 368 de sérums issus de ces prélèvements sanguins ont été soumis à un test ELISA spécifique aux anticorps induits par le virus de la PPA. Les résultats ont révélé que la porciculture est principalement pratiquée par des hommes (76,92%) ayant un niveau d’éducation secondaire (46,15%) et une expérience de moins de 10 ans (61,54%). L’élevage porcin est souvent considéré comme une activité secondaire. L’enquête a révélé que la plupart (89,87%) des porciculteurs avaient déjà entendu parler de la PPA et connaissaient les signes de l’affection, son caractère fortement contagieux (92,40%) et mortel pour le porc (96,20%). Cependant, les pratiques d’hygiène et de biosécurité dans ces exploitations restent encore faibles. En effet, l’accès aux porcheries était limité (64,56%), mais seulement 21,51% des éleveurs utilisaient des tenues spéciales pour l’élevage. De même que 8,86% des porciculteurs disposaient de pédiluves sur leurs exploitations et 7,59% ont déclaré procéder correctement au nettoyage et à la désinfection des loges.
Au niveau de l’enquête sérologique, l’étude a relevé que la prévalence globale de la PPA était de 13,59%. Cependant, sur l’ensemble des facteurs de risque étudiés, seul l’âge, les régions et les départements avaient une influence sur la prévalence de l’affection (p < 0,05). Au niveau de la région du Poro où aucun moyen de lutte offensive n’a été mis en oeuvre, le risque de l’infection était 9,64 fois plus élevé que dans la région du Tchologo où des moyens défensifs reposant sur l’isolement et l’abattage des porcs avaient été mis en oeuvre.
Au terme de cette étude, il est observé que le virus de la PPA s’est grandement propagé dans la région du Poro, présentant 9,64 fois plus de risque d’infection que dans la région du Tchologo. Cette approche de lutte contre la PPA mise en place dans la région du Tchologo se révèle alors plus efficace que celle entreprise dans la région du Poro qui a été de laisser les foyers s’éteindre d’eux-mêmes.PRESIDENT DE JURY : M. BASSOUM Oumar, Maître de Conférences Agrégé à la FMPO de l’UCAD DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Professeur Titulaire à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Professeur Titulaire à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. GBATI Oubri Bassa, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar CO-DIRECTEUR : M. M’BARI Benjamin Kiffopan, Chargé de recherche à l’UPGC de Korhogo (Côte d’Ivoire)/M. OUSMANE HAMID Abdoul Madihou, Attaché Temporaire de Recherche au service de MIPI DATE DE SOUTENANCE : 27/03/2025 PAYS : Côte d'Ivoire Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5135 Séroprévalence et facteurs de risque de la Peste Porcine Africaine dans les régions du Poro et du Tchologo (Côte d’Ivoire) en 2024. [texte imprimé] / Amenan Tania Morelle KONAN, Auteur . - Dakar : EISMV, 2025 . - 93p.
Langues : Français (fre)
Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2025 Mots-clés : PESTE PORCINE AFRICAINE SEROPREVALENCE PORO TCHOLOGO COTE D'IVOIRE Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : Les régions du Poro et du Tchologo au nord de la Côte d’Ivoire ont connu leur première épizootie de PPA en 2017. Depuis lors, des mortalités imputées à cette pathologie sont signalées tous les ans, malgré l’adoption de différentes stratégies de lutte mises en oeuvre par l’État. La présente étude avait pour objectif de connaitre la séro-épidémiologie de la PPA en Côte d’Ivoire après le foyer de 2017. Pour cela, une enquête CAP a été entreprise auprès de 79 porciculteurs, suivie d’une enquête sérologique. 432 échantillons de sang de porc ont été récoltés et suite à des hémolyses, 368 de sérums issus de ces prélèvements sanguins ont été soumis à un test ELISA spécifique aux anticorps induits par le virus de la PPA. Les résultats ont révélé que la porciculture est principalement pratiquée par des hommes (76,92%) ayant un niveau d’éducation secondaire (46,15%) et une expérience de moins de 10 ans (61,54%). L’élevage porcin est souvent considéré comme une activité secondaire. L’enquête a révélé que la plupart (89,87%) des porciculteurs avaient déjà entendu parler de la PPA et connaissaient les signes de l’affection, son caractère fortement contagieux (92,40%) et mortel pour le porc (96,20%). Cependant, les pratiques d’hygiène et de biosécurité dans ces exploitations restent encore faibles. En effet, l’accès aux porcheries était limité (64,56%), mais seulement 21,51% des éleveurs utilisaient des tenues spéciales pour l’élevage. De même que 8,86% des porciculteurs disposaient de pédiluves sur leurs exploitations et 7,59% ont déclaré procéder correctement au nettoyage et à la désinfection des loges.
Au niveau de l’enquête sérologique, l’étude a relevé que la prévalence globale de la PPA était de 13,59%. Cependant, sur l’ensemble des facteurs de risque étudiés, seul l’âge, les régions et les départements avaient une influence sur la prévalence de l’affection (p < 0,05). Au niveau de la région du Poro où aucun moyen de lutte offensive n’a été mis en oeuvre, le risque de l’infection était 9,64 fois plus élevé que dans la région du Tchologo où des moyens défensifs reposant sur l’isolement et l’abattage des porcs avaient été mis en oeuvre.
Au terme de cette étude, il est observé que le virus de la PPA s’est grandement propagé dans la région du Poro, présentant 9,64 fois plus de risque d’infection que dans la région du Tchologo. Cette approche de lutte contre la PPA mise en place dans la région du Tchologo se révèle alors plus efficace que celle entreprise dans la région du Poro qui a été de laisser les foyers s’éteindre d’eux-mêmes.PRESIDENT DE JURY : M. BASSOUM Oumar, Maître de Conférences Agrégé à la FMPO de l’UCAD DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Professeur Titulaire à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Professeur Titulaire à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. GBATI Oubri Bassa, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar CO-DIRECTEUR : M. M’BARI Benjamin Kiffopan, Chargé de recherche à l’UPGC de Korhogo (Côte d’Ivoire)/M. OUSMANE HAMID Abdoul Madihou, Attaché Temporaire de Recherche au service de MIPI DATE DE SOUTENANCE : 27/03/2025 PAYS : Côte d'Ivoire Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5135 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T1786 TD25-12 Thèse Bibliothèque (SID) Thèses Vétérinaires Disponible Documents numériques

TD25-12Adobe Acrobat PDFEvaluation technico-économique des élevages de porc en zones urbaine et périurbaine de Bobo Dioulasso (Burkina Faso) / Moïse KONATE (2025)

Titre : Evaluation technico-économique des élevages de porc en zones urbaine et périurbaine de Bobo Dioulasso (Burkina Faso) Type de document : texte imprimé Auteurs : Moïse KONATE, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2025 Importance : 86p. Langues : Français (fre) Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2025 Mots-clés : ELEVAGE PORC METHODE D’ELEVAGE BURKINA FASO Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : Cette étude a pour principal objectif de faire une évaluation technique et économique des élevages porcins en zone urbain et périurbain de Bobo Dioulasso. Elle a été menée au travers d’une enquête transversale avec la méthode d’échantillonnage non probabiliste utilisant l’approche boule de neige auprès de 50 éleveurs porcin. En ce qui concerne la conduite, l’étude a montré que les éleveurs sont majoritairement des hommes (78%), chrétiens (88%), instruits (70%), mariés (96%), majoritairement des ethnies bôbô (42%), mossi (22%) et gourounsi (12%). Ils s’inscrivent dans d’autres secteurs d’activité notamment l’agriculture (48%), le commerce (12%) et la fonction publique (10%). Ils pratiquent l’élevage à des fins commerciales et évoluent dans trois systèmes d’élevage différents (traditionnel, semi-intensif ou intensif), avec une nette prédominance du système semi-intensif (76% des élevages) ; l’élevage de porc est très souvent associé à d’autres spéculations (78%). Les races améliorées (importée) sont les plus exploitées (62%) dans un type de production quasiment mixte (98%) avec un effectif moyen global de 63 porcs. L’âge moyen de la mise à la reproduction est de 10,61 mois pour les verrats et 9,56 mois pour les truies. Le nombre de mise-bas moyen par an est de deux (02) et la taille moyenne de la portée 8,53 porcelets. L’âge de sevrage variait entre 30 et 90 jours et la castration entre 14 et 120 jours. L’alimentation est dans la totalité des cas un rationnement personnel des éleveurs, constituée essentiellement de son de maïs (96%), de drêche de dôlô (80%), d’épluchures de mangue (76%), et de farine de poisson (50%). Les pathologies dominantes restent des parasitoses cutanées, la Peste Porcine Africaine, les maladies digestives à l’origine de la diarrhée.
La vente d’un porc engraissé rapporte en moyenne 22 397 F CFA. Le sous-secteur de la porciculture présente un énorme potentiel pour lutter contre l’extrême pauvreté ; néanmoins, le manque de formation des producteurs, les habitats porcins inadaptés, les contraintes alimentaires, sanitaires et la conduite irrationnelle restent les principaux défis au développement de l’élevage porcin à Bobo Dioulasso. Il serait utile de trouver des voies alternatives d’amélioration des conditions d’habitat, d’alimentation et de suivi sanitaire des porcs et de renforcement de capacité des producteurs au travers d’un encadrement technique et d’un appui financier.PRESIDENT DE JURY : Mme NDIAYE Arame, Maître de Conférences Agrégé à la faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontostomatologie de Dakar. DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. OSSEBIWalter, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : M. OSSEBIWalter, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. AYSSIWEDE Simplice Bosco, Professeur Titulaire à l’EISMV de Dakar CO-DIRECTEUR : M. OROU SEKO Malik, Assistant à l’EISMV de Dakar DATE DE SOUTENANCE : 06/03/2025 PAYS : Burkina Faso Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5137 Evaluation technico-économique des élevages de porc en zones urbaine et périurbaine de Bobo Dioulasso (Burkina Faso) [texte imprimé] / Moïse KONATE, Auteur . - Dakar : EISMV, 2025 . - 86p.
Langues : Français (fre)
Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2025 Mots-clés : ELEVAGE PORC METHODE D’ELEVAGE BURKINA FASO Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : Cette étude a pour principal objectif de faire une évaluation technique et économique des élevages porcins en zone urbain et périurbain de Bobo Dioulasso. Elle a été menée au travers d’une enquête transversale avec la méthode d’échantillonnage non probabiliste utilisant l’approche boule de neige auprès de 50 éleveurs porcin. En ce qui concerne la conduite, l’étude a montré que les éleveurs sont majoritairement des hommes (78%), chrétiens (88%), instruits (70%), mariés (96%), majoritairement des ethnies bôbô (42%), mossi (22%) et gourounsi (12%). Ils s’inscrivent dans d’autres secteurs d’activité notamment l’agriculture (48%), le commerce (12%) et la fonction publique (10%). Ils pratiquent l’élevage à des fins commerciales et évoluent dans trois systèmes d’élevage différents (traditionnel, semi-intensif ou intensif), avec une nette prédominance du système semi-intensif (76% des élevages) ; l’élevage de porc est très souvent associé à d’autres spéculations (78%). Les races améliorées (importée) sont les plus exploitées (62%) dans un type de production quasiment mixte (98%) avec un effectif moyen global de 63 porcs. L’âge moyen de la mise à la reproduction est de 10,61 mois pour les verrats et 9,56 mois pour les truies. Le nombre de mise-bas moyen par an est de deux (02) et la taille moyenne de la portée 8,53 porcelets. L’âge de sevrage variait entre 30 et 90 jours et la castration entre 14 et 120 jours. L’alimentation est dans la totalité des cas un rationnement personnel des éleveurs, constituée essentiellement de son de maïs (96%), de drêche de dôlô (80%), d’épluchures de mangue (76%), et de farine de poisson (50%). Les pathologies dominantes restent des parasitoses cutanées, la Peste Porcine Africaine, les maladies digestives à l’origine de la diarrhée.
La vente d’un porc engraissé rapporte en moyenne 22 397 F CFA. Le sous-secteur de la porciculture présente un énorme potentiel pour lutter contre l’extrême pauvreté ; néanmoins, le manque de formation des producteurs, les habitats porcins inadaptés, les contraintes alimentaires, sanitaires et la conduite irrationnelle restent les principaux défis au développement de l’élevage porcin à Bobo Dioulasso. Il serait utile de trouver des voies alternatives d’amélioration des conditions d’habitat, d’alimentation et de suivi sanitaire des porcs et de renforcement de capacité des producteurs au travers d’un encadrement technique et d’un appui financier.PRESIDENT DE JURY : Mme NDIAYE Arame, Maître de Conférences Agrégé à la faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontostomatologie de Dakar. DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. OSSEBIWalter, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : M. OSSEBIWalter, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. AYSSIWEDE Simplice Bosco, Professeur Titulaire à l’EISMV de Dakar CO-DIRECTEUR : M. OROU SEKO Malik, Assistant à l’EISMV de Dakar DATE DE SOUTENANCE : 06/03/2025 PAYS : Burkina Faso Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5137 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T1785 TD25-11 Thèse Bibliothèque (SID) Thèses Vétérinaires Disponible Documents numériques

TD25-11Adobe Acrobat PDFÉtude des pratiques d’élevage et évaluation du niveau de biosécurité en cuniculture dans le district d’Abidjan et la ville de Grand-Bassam (Côte d’Ivoire) en 2024 / Abré Sara Ophélia BEUGRE (2025)

Titre : Étude des pratiques d’élevage et évaluation du niveau de biosécurité en cuniculture dans le district d’Abidjan et la ville de Grand-Bassam (Côte d’Ivoire) en 2024 Type de document : texte imprimé Auteurs : Abré Sara Ophélia BEUGRE, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2025 Importance : 81p. Langues : Français (fre) Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2025 Mots-clés : PRATIQUE D'ELEVAGE BIOSECURITE CUNICULTURE ABIDJAN GRAND BASSAM COTE D'IVOIRE Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : La présente étude porte sur l’évaluation du fonctionnement et des mesures de biosécurité dans les élevages cunicoles. Elle s’est déroulée de janvier 2024 à juin 2024 dans le district d’Abidjan et la ville de Grand-Bassam. Les données ont été collectées dans Kobotoolbox auprès de 49 élevages cunicoles grâce aux cuniculteurs présents sur les lieux. La saisie et l’analyse des données ont été effectuées à l’aide d’Excel 2019, du logiciel R studio version 2023. 12.1. La majorité des éleveurs enquêtés étaient des hommes (85,7%). Ces cuniculteurs étaient pour la plupart âgés entre [40 - 50] ans (42,9%), ayant le niveau secondaire (49%) et plus de 10 ans d’expérience en élevage cunicole (77%). Le système de production artisanal ou familial (51%). Les élevages se situaient pour la plupart hors des agglomérations (57,1%). Dans les élevages, 71,4 % des éleveurs possèdent un seul bâtiment, compartimenté en fonction des stades physiologiques et des besoins de productions. L’effectif des lapereaux sous mère, des lapereaux après sevrage et des reproducteurs variait d’un élevage a un autre. L’achat du noyau reproducteur se faisait pour la plupart 1 mâle - 9 femelles soit (59,2%). Le prix élevé de l’achat des reproducteurs reste la principale difficulté. Les mâles et les femelles sont mis à la reproduction respectivement à 6 mois et à plus de 4 mois chez un grand nombre d’eleveur. L’application de mesures de biosécurité n’est pas effective dans tous les élevages. En effet si 61,2% disposent de zones de quarantaine, 32,6% d’entre elles ne sont pas isolées. Les éleveurs affirment que l’accès aux différents élevages cunicoles est réglementé. En revanche, les protocoles sanitaires ne sont pas correctement mis en oeuvre. Tous les cuniculteurs affirment nettoyer les bâtiments mais seulement 53,06% le font quotidiennement avec de l’eau savonneuse (26,5%). Par ailleurs certains cuniculteurs ont recours aux pratiques vétérinaires (98%) pour prévenir, traiter, certaines pathologies ou pour améliorer les performances de leurs sujets. Des recommandations ont été formulées à l’endroit de tous les acteurs afin de contribuer à un développement optimal de la filière cunicole en Côte d’ivoire. PRESIDENT DE JURY : Mme GUEYE Rokhaya, Professeur à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. MISSOHOU Ayao, Professeur Titulaire à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : M. NTEME ELLA Gualbert Simon, Maitre de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. GBATI Oubri Bassa, Maitre de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar ENCADRANT : Colonel TANO Jule, Chef de département d’administration, de formation de recherche au service des vétérinaires de l’armée DATE DE SOUTENANCE : 06/02/2025 PAYS : Côte d’Ivoire Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5139 Étude des pratiques d’élevage et évaluation du niveau de biosécurité en cuniculture dans le district d’Abidjan et la ville de Grand-Bassam (Côte d’Ivoire) en 2024 [texte imprimé] / Abré Sara Ophélia BEUGRE, Auteur . - Dakar : EISMV, 2025 . - 81p.
Langues : Français (fre)
Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2025 Mots-clés : PRATIQUE D'ELEVAGE BIOSECURITE CUNICULTURE ABIDJAN GRAND BASSAM COTE D'IVOIRE Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : La présente étude porte sur l’évaluation du fonctionnement et des mesures de biosécurité dans les élevages cunicoles. Elle s’est déroulée de janvier 2024 à juin 2024 dans le district d’Abidjan et la ville de Grand-Bassam. Les données ont été collectées dans Kobotoolbox auprès de 49 élevages cunicoles grâce aux cuniculteurs présents sur les lieux. La saisie et l’analyse des données ont été effectuées à l’aide d’Excel 2019, du logiciel R studio version 2023. 12.1. La majorité des éleveurs enquêtés étaient des hommes (85,7%). Ces cuniculteurs étaient pour la plupart âgés entre [40 - 50] ans (42,9%), ayant le niveau secondaire (49%) et plus de 10 ans d’expérience en élevage cunicole (77%). Le système de production artisanal ou familial (51%). Les élevages se situaient pour la plupart hors des agglomérations (57,1%). Dans les élevages, 71,4 % des éleveurs possèdent un seul bâtiment, compartimenté en fonction des stades physiologiques et des besoins de productions. L’effectif des lapereaux sous mère, des lapereaux après sevrage et des reproducteurs variait d’un élevage a un autre. L’achat du noyau reproducteur se faisait pour la plupart 1 mâle - 9 femelles soit (59,2%). Le prix élevé de l’achat des reproducteurs reste la principale difficulté. Les mâles et les femelles sont mis à la reproduction respectivement à 6 mois et à plus de 4 mois chez un grand nombre d’eleveur. L’application de mesures de biosécurité n’est pas effective dans tous les élevages. En effet si 61,2% disposent de zones de quarantaine, 32,6% d’entre elles ne sont pas isolées. Les éleveurs affirment que l’accès aux différents élevages cunicoles est réglementé. En revanche, les protocoles sanitaires ne sont pas correctement mis en oeuvre. Tous les cuniculteurs affirment nettoyer les bâtiments mais seulement 53,06% le font quotidiennement avec de l’eau savonneuse (26,5%). Par ailleurs certains cuniculteurs ont recours aux pratiques vétérinaires (98%) pour prévenir, traiter, certaines pathologies ou pour améliorer les performances de leurs sujets. Des recommandations ont été formulées à l’endroit de tous les acteurs afin de contribuer à un développement optimal de la filière cunicole en Côte d’ivoire. PRESIDENT DE JURY : Mme GUEYE Rokhaya, Professeur à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. MISSOHOU Ayao, Professeur Titulaire à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : M. NTEME ELLA Gualbert Simon, Maitre de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. GBATI Oubri Bassa, Maitre de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar ENCADRANT : Colonel TANO Jule, Chef de département d’administration, de formation de recherche au service des vétérinaires de l’armée DATE DE SOUTENANCE : 06/02/2025 PAYS : Côte d’Ivoire Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5139 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T1782 TD25-08 Thèse Bibliothèque (SID) Thèses Vétérinaires Disponible Documents numériques

TD25-08Adobe Acrobat PDFPrincipales maladies des chiens et des chats rencontrées lors des urgences vétérinaires à domicile en France en 2024 / Baptiste MENENDEZ (2025)

Titre : Principales maladies des chiens et des chats rencontrées lors des urgences vétérinaires à domicile en France en 2024 Type de document : texte imprimé Auteurs : Baptiste MENENDEZ, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2025 Importance : 115p. Langues : Français (fre) Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2025 Mots-clés : MALADIE DES ANIMAUX CHIEN CHAT URGENCE VETERINAIRE FRANCE Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : Ce travail a pour objectif d'identifier les pathologies les plus courantes chez les chiens et les chats lors des urgences vétérinaires à domicile en France.
Vingt services vétérinaires à domicile, répartis sur l’ensemble du territoire français, ont été interrogés.
Les animaux traités en urgence à domicile sont principalement des chiens de race (55%), (comme le golden retriever (73%), le bouledogue français (68%) et le berger australien (63%) et des chats européens (90%), souvent sujets à des pathologies génétiques. Les chiens sont consultés à l'âge adulte pour des problèmes aigus ou chroniques, tandis que les chats âgés présentent des maladies gériatriques.
Pour déterminer la démarche diagnostique, thérapeutique de ces carnivores, l'examen clinique (80%) est l'outil principal des urgences vétérinaires à domicile, complété par des examens comme les lactates (60%), la glycémie (20%) et la créatinémie (10%), Les traitements sont adaptés à la pathologie.
Les pathologies les plus courantes lors des urgences vétérinaires à domicile incluent les affections gastro-intestinales (53,80%), fin de vie (38,50%), et musculo-squelettique (15,40%). Les chats sont souvent affectés par des troubles digestifs et urinaires, tandis que l'arthrose (45%) touche fréquemment les chiens âgés. En été, les urgences augmentent en raison de coups de chaleur et d'infestations parasitaires. Les troubles ophtalmologiques et neurologiques, bien que moins fréquents, nécessitent également une prise en charge rapide.PRESIDENT DE JURY : Mme GUEYE Rokhaya, Maître de Conférences à la faculté de Médecine, de Pharmacie et d’odontologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme KADJA Mireille Catherine, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : Mme KADJA Mireille Catherine, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. GBATI Oubri Bassa, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar ENCADRANT : Dr CISSE Serigne Abdoulaye, Clinicien vacataire à l’EISMV de Dakar DATE DE SOUTENANCE : 12/02/2025 PAYS : France Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5140 Principales maladies des chiens et des chats rencontrées lors des urgences vétérinaires à domicile en France en 2024 [texte imprimé] / Baptiste MENENDEZ, Auteur . - Dakar : EISMV, 2025 . - 115p.
Langues : Français (fre)
Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2025 Mots-clés : MALADIE DES ANIMAUX CHIEN CHAT URGENCE VETERINAIRE FRANCE Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : Ce travail a pour objectif d'identifier les pathologies les plus courantes chez les chiens et les chats lors des urgences vétérinaires à domicile en France.
Vingt services vétérinaires à domicile, répartis sur l’ensemble du territoire français, ont été interrogés.
Les animaux traités en urgence à domicile sont principalement des chiens de race (55%), (comme le golden retriever (73%), le bouledogue français (68%) et le berger australien (63%) et des chats européens (90%), souvent sujets à des pathologies génétiques. Les chiens sont consultés à l'âge adulte pour des problèmes aigus ou chroniques, tandis que les chats âgés présentent des maladies gériatriques.
Pour déterminer la démarche diagnostique, thérapeutique de ces carnivores, l'examen clinique (80%) est l'outil principal des urgences vétérinaires à domicile, complété par des examens comme les lactates (60%), la glycémie (20%) et la créatinémie (10%), Les traitements sont adaptés à la pathologie.
Les pathologies les plus courantes lors des urgences vétérinaires à domicile incluent les affections gastro-intestinales (53,80%), fin de vie (38,50%), et musculo-squelettique (15,40%). Les chats sont souvent affectés par des troubles digestifs et urinaires, tandis que l'arthrose (45%) touche fréquemment les chiens âgés. En été, les urgences augmentent en raison de coups de chaleur et d'infestations parasitaires. Les troubles ophtalmologiques et neurologiques, bien que moins fréquents, nécessitent également une prise en charge rapide.PRESIDENT DE JURY : Mme GUEYE Rokhaya, Maître de Conférences à la faculté de Médecine, de Pharmacie et d’odontologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme KADJA Mireille Catherine, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : Mme KADJA Mireille Catherine, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. GBATI Oubri Bassa, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar ENCADRANT : Dr CISSE Serigne Abdoulaye, Clinicien vacataire à l’EISMV de Dakar DATE DE SOUTENANCE : 12/02/2025 PAYS : France Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5140 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T1778 TD25-04 Thèse Bibliothèque (SID) Thèses Vétérinaires Disponible Documents numériques

TD25-04Adobe Acrobat PDFSéroprévalence de la bronchite infectieuse chez les poulets locaux élevés en divagation dans le département d’Agnibilekrou en Côte d’Ivoire (2024). / Bofa Twimasi Emmanuel KOFFI (2025)

PermalinkAmélioration de la rentabilité de production par l’incorporation de la farine de larves de mouche soldat noire (hermetia illucens) dans l’alimentation des poulets de chair à Bamako (Mali) / Assitan COULIBALY (2025)

PermalinkSouches de escherichia coli et klebsiella spp. multirésistantes isolées des fèces de carnivores et primates en captivité au zoo national d’Abidjan en 2024 / Malick-Aziz Kader CISSÉ (2025)

PermalinkÉpidémiologie de la Tuberculose bovine et pertes financières associées chez les ruminants abattus à l’aire d’abattage de Koupéla au Burkina Faso. / Davy Wilfried BASSILA (2025)

PermalinkDétermination des valeurs usuelles de quelques paramètres biochimiques et hématologiques chez les chevaux de course au Sénégal en 2024 : cas des régions de Dakar et Thiès / Babacar Marc-Henri Antoine DIOUF (2025)

PermalinkSéroprévalence de l’infection par le virus de l’Hépatite E chez les vaches laitières, connaissances et comportements à risque de transmission zoonotique des bouviers dans la zone péri-urbaine de Ouagadougou au Burkina Faso en 2023 / Lanfo Apollinaire TIALLA (2025)

PermalinkEvaluation comparée de deux méthodes de diagnostic de gestation chez les bovins : palpation transrectale et échographie dans la zone périurbaine de Bamako (Mali) / Kalilou MAÏGA (2025)

PermalinkPrévalence des zoonoses responsables de saisies de viandes de bovins et de petits ruminants et incidences économiques à l’Abattoir Régional de Kayes (Mali) / Hady Conkobo TRAORE (2025)

PermalinkPratiques d’élevage des ânes, pathologies dominantes et méthodes de lutte dans la région de Zinder au Niger / Lamine AMADOU OUMAROU LAMIDO (2025)

PermalinkEffets de la distribution du typha australis comme fourrage de base sur les performances zootechnico-economiques en embouche du zébu maure dans la région de Saint-Louis au Sénégal / Dibasse Justin SENGHOR (2025)

Permalink