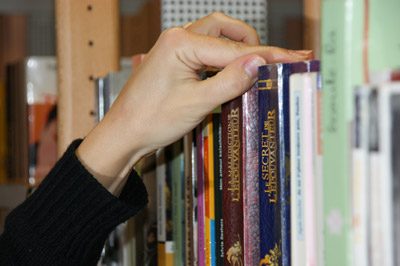EISMV DE DAKAR: Service d'Information et de Documentation
Détail de l'éditeur
EISMV
localisé à :
Dakar
|
Documents disponibles chez cet éditeur (2069)

 Interroger des sources externes
Interroger des sources externesAnalyse des pratiques apicoles et contamination du couvain des abeilles domestiques (Apis mellifera) par les bactéries dans les ruchers au Burkina Faso. / Fatogoman Téophile SANOU (2023)

Titre : Analyse des pratiques apicoles et contamination du couvain des abeilles domestiques (Apis mellifera) par les bactéries dans les ruchers au Burkina Faso. Type de document : texte imprimé Auteurs : Fatogoman Téophile SANOU, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2023 Importance : 94p. Langues : Français (fre) Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2023 Mots-clés : APICULTURE CONTAMINATION COUVAIN ABEILLE BACTERIE BURKINA FASO Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : Au fil des années, l’apiculture burkinabè est devenue une activité génératrice de revenus financiers non négligeables pour l’économie nationale. Cependant, des défis restent à relever. Il est nécessaire d’améliorer les méthodes et les outils de travail pour prendre en compte la protection de l’environnement et une maintenance de colonies d’abeilles saines et fortes permettant des productions en quantité et en qualité. C’est dans cet ordre d’idée qu’intervient cette étude dont l’objectif est de contribuer à caractériser les pratiques apicoles et les facteurs associés aux bactéries présentes dans le couvain des ruchers au Burkina Faso. Pour ce faire, nous avons dans un premier temps interviewé 76 apiculteurs et effectué des prélèvements d’échantillons d’alvéoles de couvain (121) dans des ruchers de six (06) régions du pays. Dans un second temps, des travaux de laboratoire en vue de faire l’état des lieux des ruches visitées et d’évaluer le niveau de prévalence des bactéries Gram positifs et négatifs dans la zone d’étude.
Après dépouillement des questionnaires et traitement des données, il ressort que l’apiculture est une activité secondaire majoritairement pratiquée par les hommes (94,74%). En termes de visite des ruches, il est effectué de façon mensuelle par 64,47% des apiculteurs. Le taux de connaissances sur les maladies des abeilles par les apiculteurs est relativement faible. La diminution des abeilles est constatée par plus de 96% des enquêtés. Le manque de suivi sanitaires par des spécialistes de la santé apicole (98,68%), de soutiens financiers (78,95%) et l’existence de prédateurs des abeilles et les pesticides sont les principales contraintes de l’apiculture dans la zone d’étude.
Le niveau de prévalence obtenu après analyse des données est de de 26,45% de bactéries Gram positifs contre 73,55% de bactéries Gram négatifs.
Le sexe et la formation en apiculture ont significativement influencé leur niveau de contamination par les bactéries dans les ruches. Des investigations sur les aspects épidémiologiques des pathologies apicoles notamment ceux bactériennes permettront d’asseoir des bases de stratégies de contrôle.PRESIDENT DE JURY : M. DIOP Amadou, Pr Titulaire à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. GBATI Oubri Bassa, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : M. GBATI Oubri Bassa, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. LAPO Rock Allister, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar CO-DIRECTEUR : Mme ZERBO/OUERMI Lamouni Habibata, Dir du Laboratoire National d’Elevage du Burkina Faso ENCADRANT : M. N’DA Kacou Martial, Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’EISMV de Dakar DATE DE SOUTENANCE : 07/12/2023 PAYS : Burkina Faso Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5212 Analyse des pratiques apicoles et contamination du couvain des abeilles domestiques (Apis mellifera) par les bactéries dans les ruchers au Burkina Faso. [texte imprimé] / Fatogoman Téophile SANOU, Auteur . - Dakar : EISMV, 2023 . - 94p.
Langues : Français (fre)
Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2023 Mots-clés : APICULTURE CONTAMINATION COUVAIN ABEILLE BACTERIE BURKINA FASO Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : Au fil des années, l’apiculture burkinabè est devenue une activité génératrice de revenus financiers non négligeables pour l’économie nationale. Cependant, des défis restent à relever. Il est nécessaire d’améliorer les méthodes et les outils de travail pour prendre en compte la protection de l’environnement et une maintenance de colonies d’abeilles saines et fortes permettant des productions en quantité et en qualité. C’est dans cet ordre d’idée qu’intervient cette étude dont l’objectif est de contribuer à caractériser les pratiques apicoles et les facteurs associés aux bactéries présentes dans le couvain des ruchers au Burkina Faso. Pour ce faire, nous avons dans un premier temps interviewé 76 apiculteurs et effectué des prélèvements d’échantillons d’alvéoles de couvain (121) dans des ruchers de six (06) régions du pays. Dans un second temps, des travaux de laboratoire en vue de faire l’état des lieux des ruches visitées et d’évaluer le niveau de prévalence des bactéries Gram positifs et négatifs dans la zone d’étude.
Après dépouillement des questionnaires et traitement des données, il ressort que l’apiculture est une activité secondaire majoritairement pratiquée par les hommes (94,74%). En termes de visite des ruches, il est effectué de façon mensuelle par 64,47% des apiculteurs. Le taux de connaissances sur les maladies des abeilles par les apiculteurs est relativement faible. La diminution des abeilles est constatée par plus de 96% des enquêtés. Le manque de suivi sanitaires par des spécialistes de la santé apicole (98,68%), de soutiens financiers (78,95%) et l’existence de prédateurs des abeilles et les pesticides sont les principales contraintes de l’apiculture dans la zone d’étude.
Le niveau de prévalence obtenu après analyse des données est de de 26,45% de bactéries Gram positifs contre 73,55% de bactéries Gram négatifs.
Le sexe et la formation en apiculture ont significativement influencé leur niveau de contamination par les bactéries dans les ruches. Des investigations sur les aspects épidémiologiques des pathologies apicoles notamment ceux bactériennes permettront d’asseoir des bases de stratégies de contrôle.PRESIDENT DE JURY : M. DIOP Amadou, Pr Titulaire à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. GBATI Oubri Bassa, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : M. GBATI Oubri Bassa, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. LAPO Rock Allister, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar CO-DIRECTEUR : Mme ZERBO/OUERMI Lamouni Habibata, Dir du Laboratoire National d’Elevage du Burkina Faso ENCADRANT : M. N’DA Kacou Martial, Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’EISMV de Dakar DATE DE SOUTENANCE : 07/12/2023 PAYS : Burkina Faso Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5212 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T1708 TD23-61 Thèse Bibliothèque (SID) Thèses Vétérinaires Disponible Documents numériques

TD2361Adobe Acrobat PDFEvaluation des connaissances, attitudes et pratiques des acteurs de la santé et des étudiants sur l’usage des antibiotiques et la résistance aux antibiotiques au Togo. / Olouwamouyiwa AKINSOLA (2023)

Titre : Evaluation des connaissances, attitudes et pratiques des acteurs de la santé et des étudiants sur l’usage des antibiotiques et la résistance aux antibiotiques au Togo. Type de document : texte imprimé Auteurs : Olouwamouyiwa AKINSOLA, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2023 Importance : 113p. Langues : Français (fre) Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2023 Mots-clés : ANTIBIOTIQUE ANTIBIORESISTANCE TOGO Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : La découverte des antibiotiques a été la grande avancée thérapeutique du début du 20ème siècle. Cette découverte avait fait naître l’espoir de stopper l’ensemble des maladies infectieuses, mais très rapidement cet espoir a été compromis par l’émergence des bactéries résistantes. L’antibiorésistance est devenue l’une des plus graves menaces mondiales pour la santé humaine, la santé animale, la biodiversité, la sécurité alimentaire et le développement. La lutte contre cette menace passe par une meilleure sensibilisation des acteurs de la santé et des populations. La présente étude visait à offrir une base scientifique à une telle action de sensibilisation à travers d’une enquête CAP.
Au total, 383 étudiants et 121 professionnels de la santé composés de 41 médecins, 40 pharmaciens et 40 vétérinaires avaient participé à cette étude qui s’est déroulée de Février à Avril 2021 au Togo.
Il ressort de l’évaluation des connaissances, attitudes et pratiques sur l’usage rationnel des antibiotiques que 60% des acteurs de la santé étaient dans la catégorie de niveau de connaissances insuffisant. Environ 91% des acteurs de la santé enquêtés n’avaient aucune connaissance sur les antibiotiques interdits ou retirés du marché, 77% ne connaissaient pas les antibiotiques d’importance critiques dans leurs domaines. En dépit de ces insuffisances les acteurs percevaient très bien le problème de la résistance bactérienne. Cela se confirme par un score moyen de (6,66/ 8 points) avec des extrêmes de 4 à 8 points. Les acteurs de la santé incriminaient l’automédication par les humains (96%), le sous dosage des antibiotiques (79%) et l’auto-administration des antibiotiques par les éleveurs (58%) comme les trois principales causes de la résistance aux antibiotiques. Et pour lutter contre ces causes, ils proposaient le renforcement des contrôles sur la distribution des antibiotiques et l’éducation des profanes sur l’importance de la préservation des antibiotiques dans les actions phares pour lutter contre la résistance aux antibiotiques.
Bien que les professionnels de la santé aient un rôle à jouer dans l’émergence de la résistance aux antibiotiques, ils n’en sont pas les seuls responsables. Les consommateurs de ces antibiotiques ont aussi leur part de responsabilité. Nous avons évalué les connaissances et perceptions des étudiants et ils avaient un score moyen de (5,33/12 points). Un modèle statistique a permis d’expliquer les facteurs déterminant les niveaux de connaissances des étudiants. Ce modèle a montré que la faculté d’étude de l’étudiant et la connaissance ou non de l’étudiant de ce que c’est qu’un antibiotique jouaient sur le comportement de l’étudiant et son classement dans la catégorie de niveau de connaissances insuffisant, moyen et bon. Ainsi, les étudiants de la FDD avaient [6,47, IC (1,41-29,8)] fois de chance d’être dans la catégorie de niveau de connaissances “insuffisant” sur le bon usage des antibiotiques et la perception sur la résistance aux antibiotiques par rapport aux étudiants de la FSS. Les étudiants de la FASEG présentaient le risque le plus élevé d’être dans la catégorie de niveau de connaissances insuffisant. De même, un étudiant n’ayant pas connaissance de ce que c’est qu’un antibiotique avait [8,95 IC (2,53-31,7)] fois de chance d’être dans la catégorie de niveau de connaissances “insuffisant” qu’un étudiant qui a connaissance d’un antibiotique.
A la lumière de ces résultats, nous devons concentrer nos efforts sur la lutte intégrée en passant par l’éducation et la formation à tous les niveaux. Ces efforts doivent aider à l’évolution des pratiques vers une réduction d’usage des antibiotiques.PRESIDENT DE JURY : M. MBAYE Gora, Pr à la Faculté de Médecine, Pharmacie et d’Odontologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar MEMBRE : Mme KADJA Mireille Catherine, Maître de Conférence Agrégé à l’EISMV de Dakar ENCADRANT : M. BEDEKELABOU André Pouwedeou, Docteur vétérinaire au laboratoire central vétérinaire de Lomé DATE DE SOUTENANCE : 22/05/2023 PAYS : TOGO Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5213 Evaluation des connaissances, attitudes et pratiques des acteurs de la santé et des étudiants sur l’usage des antibiotiques et la résistance aux antibiotiques au Togo. [texte imprimé] / Olouwamouyiwa AKINSOLA, Auteur . - Dakar : EISMV, 2023 . - 113p.
Langues : Français (fre)
Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2023 Mots-clés : ANTIBIOTIQUE ANTIBIORESISTANCE TOGO Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : La découverte des antibiotiques a été la grande avancée thérapeutique du début du 20ème siècle. Cette découverte avait fait naître l’espoir de stopper l’ensemble des maladies infectieuses, mais très rapidement cet espoir a été compromis par l’émergence des bactéries résistantes. L’antibiorésistance est devenue l’une des plus graves menaces mondiales pour la santé humaine, la santé animale, la biodiversité, la sécurité alimentaire et le développement. La lutte contre cette menace passe par une meilleure sensibilisation des acteurs de la santé et des populations. La présente étude visait à offrir une base scientifique à une telle action de sensibilisation à travers d’une enquête CAP.
Au total, 383 étudiants et 121 professionnels de la santé composés de 41 médecins, 40 pharmaciens et 40 vétérinaires avaient participé à cette étude qui s’est déroulée de Février à Avril 2021 au Togo.
Il ressort de l’évaluation des connaissances, attitudes et pratiques sur l’usage rationnel des antibiotiques que 60% des acteurs de la santé étaient dans la catégorie de niveau de connaissances insuffisant. Environ 91% des acteurs de la santé enquêtés n’avaient aucune connaissance sur les antibiotiques interdits ou retirés du marché, 77% ne connaissaient pas les antibiotiques d’importance critiques dans leurs domaines. En dépit de ces insuffisances les acteurs percevaient très bien le problème de la résistance bactérienne. Cela se confirme par un score moyen de (6,66/ 8 points) avec des extrêmes de 4 à 8 points. Les acteurs de la santé incriminaient l’automédication par les humains (96%), le sous dosage des antibiotiques (79%) et l’auto-administration des antibiotiques par les éleveurs (58%) comme les trois principales causes de la résistance aux antibiotiques. Et pour lutter contre ces causes, ils proposaient le renforcement des contrôles sur la distribution des antibiotiques et l’éducation des profanes sur l’importance de la préservation des antibiotiques dans les actions phares pour lutter contre la résistance aux antibiotiques.
Bien que les professionnels de la santé aient un rôle à jouer dans l’émergence de la résistance aux antibiotiques, ils n’en sont pas les seuls responsables. Les consommateurs de ces antibiotiques ont aussi leur part de responsabilité. Nous avons évalué les connaissances et perceptions des étudiants et ils avaient un score moyen de (5,33/12 points). Un modèle statistique a permis d’expliquer les facteurs déterminant les niveaux de connaissances des étudiants. Ce modèle a montré que la faculté d’étude de l’étudiant et la connaissance ou non de l’étudiant de ce que c’est qu’un antibiotique jouaient sur le comportement de l’étudiant et son classement dans la catégorie de niveau de connaissances insuffisant, moyen et bon. Ainsi, les étudiants de la FDD avaient [6,47, IC (1,41-29,8)] fois de chance d’être dans la catégorie de niveau de connaissances “insuffisant” sur le bon usage des antibiotiques et la perception sur la résistance aux antibiotiques par rapport aux étudiants de la FSS. Les étudiants de la FASEG présentaient le risque le plus élevé d’être dans la catégorie de niveau de connaissances insuffisant. De même, un étudiant n’ayant pas connaissance de ce que c’est qu’un antibiotique avait [8,95 IC (2,53-31,7)] fois de chance d’être dans la catégorie de niveau de connaissances “insuffisant” qu’un étudiant qui a connaissance d’un antibiotique.
A la lumière de ces résultats, nous devons concentrer nos efforts sur la lutte intégrée en passant par l’éducation et la formation à tous les niveaux. Ces efforts doivent aider à l’évolution des pratiques vers une réduction d’usage des antibiotiques.PRESIDENT DE JURY : M. MBAYE Gora, Pr à la Faculté de Médecine, Pharmacie et d’Odontologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar MEMBRE : Mme KADJA Mireille Catherine, Maître de Conférence Agrégé à l’EISMV de Dakar ENCADRANT : M. BEDEKELABOU André Pouwedeou, Docteur vétérinaire au laboratoire central vétérinaire de Lomé DATE DE SOUTENANCE : 22/05/2023 PAYS : TOGO Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5213 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T1667 TD23-20 Thèse Bibliothèque (SID) Thèses Vétérinaires Disponible Documents numériques

TD23-20Adobe Acrobat PDFEtude typologique des élevages avicoles modernes dans la zone périurbaine de Bamako (Mali) / Aïcha WELE (2023)

Titre : Etude typologique des élevages avicoles modernes dans la zone périurbaine de Bamako (Mali) Type de document : texte imprimé Auteurs : Aïcha WELE, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2023 Importance : 77p Langues : Français (fre) Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2023 Mots-clés : AVICULTURE BAMAKO MALI Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : L’élevage occupe une place importante dans l’économie nationale au regard de la forte demande des populations en produits animaux. L'aviculture présente ainsi une importance cruciale au Mali, à la fois pour l'apport en protéines animales et pour le développement économique.
Dans cette dynamique, une étude typologique des élevages avicoles de la zone périurbaine de Bamako a été réalisée durant les mois de Septembre, Octobre 2022 et Février 2023 dans 42 fermes avicoles. Il ressort que 60% font uniquement de l'élevage de poulets de chair, 19% uniquement à l'élevage de poules pondeuses, et 21% un élevage mixte poules pondeuses et chairs. 55% des fermes ont moins de 5 ans d’existence. Les propriétaires sont à 76% des hommes, avec des profils d'âge et de formation variés. Toutes les fermes font appel à un conseiller en aviculture dont 36% sont des docteurs vétérinaires et 36% ont des consultants d’élevage comme conseiller. Diverses pathologies notamment les maladies digestives, la New Castle, la coccidiose entre autres ont été rencontrées tout au long des activités d’élevage. La commercialisation se fait surtout via des intermédiaires. Trois types d'élevages ressortent. Les élevages de type I (69%) en bâtiments semifermés, font de la spéculation chair (83%) et mixte (17%) avec un niveau de biosécurité moyen. Ceux de type II sont de 10% et la majorité font de la spéculation mixte (chair et pondeuses) à 75% dans des bâtiments semi-fermés avec niveau de biosécurité bas. Les élevages de type III représentent 21% et font tous les spéculations pondeuses dans des bâtiments semi-fermés, avec un niveau biosécurité moyen malgré des effectifs importants. Des recommandations sont formulées pour soutenir ce secteur avicole malien en plein essor.PRESIDENT DE JURY : M. FALL Mamadou, Pr Titulaire à la faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de Dakar. DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. MISSOHOU Ayao, Pr Titulaire à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : M. AYSSIWEDE Simplice Bosco, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. GBATI Oubri Bassa, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar ENCADRANT : Mme SANOGO Diarha, Vétérinaire Qualiticienne à la Société Promavet-SARL ETUDE TYPOLOGIQUE DES ELEVAGES AVICOLES MODERNES DANS LA ZONE PERIURBAINE DE BAMAKO (MALI) JURY DATE DE SOUTENANCE : 22/12/2023 PAYS : Mali Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5214 Etude typologique des élevages avicoles modernes dans la zone périurbaine de Bamako (Mali) [texte imprimé] / Aïcha WELE, Auteur . - Dakar : EISMV, 2023 . - 77p.
Langues : Français (fre)
Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2023 Mots-clés : AVICULTURE BAMAKO MALI Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : L’élevage occupe une place importante dans l’économie nationale au regard de la forte demande des populations en produits animaux. L'aviculture présente ainsi une importance cruciale au Mali, à la fois pour l'apport en protéines animales et pour le développement économique.
Dans cette dynamique, une étude typologique des élevages avicoles de la zone périurbaine de Bamako a été réalisée durant les mois de Septembre, Octobre 2022 et Février 2023 dans 42 fermes avicoles. Il ressort que 60% font uniquement de l'élevage de poulets de chair, 19% uniquement à l'élevage de poules pondeuses, et 21% un élevage mixte poules pondeuses et chairs. 55% des fermes ont moins de 5 ans d’existence. Les propriétaires sont à 76% des hommes, avec des profils d'âge et de formation variés. Toutes les fermes font appel à un conseiller en aviculture dont 36% sont des docteurs vétérinaires et 36% ont des consultants d’élevage comme conseiller. Diverses pathologies notamment les maladies digestives, la New Castle, la coccidiose entre autres ont été rencontrées tout au long des activités d’élevage. La commercialisation se fait surtout via des intermédiaires. Trois types d'élevages ressortent. Les élevages de type I (69%) en bâtiments semifermés, font de la spéculation chair (83%) et mixte (17%) avec un niveau de biosécurité moyen. Ceux de type II sont de 10% et la majorité font de la spéculation mixte (chair et pondeuses) à 75% dans des bâtiments semi-fermés avec niveau de biosécurité bas. Les élevages de type III représentent 21% et font tous les spéculations pondeuses dans des bâtiments semi-fermés, avec un niveau biosécurité moyen malgré des effectifs importants. Des recommandations sont formulées pour soutenir ce secteur avicole malien en plein essor.PRESIDENT DE JURY : M. FALL Mamadou, Pr Titulaire à la faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de Dakar. DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. MISSOHOU Ayao, Pr Titulaire à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : M. AYSSIWEDE Simplice Bosco, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. GBATI Oubri Bassa, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar ENCADRANT : Mme SANOGO Diarha, Vétérinaire Qualiticienne à la Société Promavet-SARL ETUDE TYPOLOGIQUE DES ELEVAGES AVICOLES MODERNES DANS LA ZONE PERIURBAINE DE BAMAKO (MALI) JURY DATE DE SOUTENANCE : 22/12/2023 PAYS : Mali Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5214 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T1709 TD23-62 Thèse Bibliothèque (SID) Thèses Vétérinaires Disponible Documents numériques

TD23-62Adobe Acrobat PDFEvaluation de la rentabilité économique de l’embouche bovine au Mali, cas du cercle de Ségou / Boubacar COULIBALY (2024)

Titre : Evaluation de la rentabilité économique de l’embouche bovine au Mali, cas du cercle de Ségou Type de document : texte imprimé Auteurs : Boubacar COULIBALY, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2024 Importance : 29p. Langues : Français (fre) Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2024 Mots-clés : BOVIN EMBOUCHE SEGO MALI Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : Ce travail qui contribue à l’amélioration des revenus des producteurs par la mise à la disposition
d’informations fiables sur la rentabilité économique de l’embouche bovine, s’est déroulé du
01er décembre 2021 au 30 mars 2022. L’étude a été réalisée dans le cercle de Ségou au Mali.
Elle a touché quarante exploitations. Les données ont été obtenues par enquête de terrain et
analysées. Il en ressort que 65% des exploitations utilisent exclusivement des mâles entiers,
25% des mâles castrés et des femelles, 3% des femelles et 3% des mâles castrés. L’alimentation
des animaux est assurée principalement avec les aliments concentrés et les aliments grossiers.
Les maladies rencontrées dans les exploitations ont été la Fièvre aphteuse 3% et les Parasitoses
(interne et externe) 3%. Par ailleurs, 94% des exploitations faisaient de la fièvre aphteuse, des
parasitoses, de la tuberculose et de la trypanosomose. Les points de dépenses dans les
exploitations d’embouche ont concerné l’achat des animaux, l’alimentation, l’achat de matériel,
de la main d’œuvre et les frais de soins vétérinaires. Les emboucheurs achetaient les animaux
adultes à différent prix, dont les moyennes se situaient entre 274 214 FCFA à 293 750 FCFA.
Les poids vifs moyens à l’entrée des animaux embouchés étaient de 374 kg et de 425kg pour
90 et 120 jours. Les poids vifs moyens à la sortie des animaux embouchés étaient de 444 kg et
de 518 kg pour 90 et 120 jours. Les animaux consommaient en moyenne 623 kg en aliment
grossier et 870 kg en aliment concentré pour l’embouche de 90 jours. Ceux de 120 jours
consommaient en moyenne 622,5 kg en aliment grossier et 1402 kg en aliment concentré. Les
gains moyens quotidiens étaient de 770 g pour 90 jours d’embouche et 775 g pour 120 jours
d’embouche. Le coût de l’alimentation par animal embouché pendant 120 jours est ou était,
harmoniser dans le document de 274 524 FCFA comme maximal, moyen 211 002 FCFA et
minimum 95 963 FCFA. Les animaux d’embouche de 90 jours ont un coût d’alimentation
minimum de 63 863 FCFA, moyen de 121 370 FCFA et un maximum de 196 587 FCFA. Les
animaux embouchés durant 90 jours ont été vendus à un prix moyen de 519 286 FCFA et de
618 750 FCFA prix moyen de vente des animaux embouchés durant 120 jours. Les
emboucheurs ont fait un bénéfice moyen de 140 000 FCFA en embouche de 120 jours et
120 000FCFA en celle de 90 jours. L’embouche bovine est une activité rentable selon les
emboucheurs. Les emboucheurs ignorent certains postes de dépenses tels que la main-d’œuvre
et les infrastructures.PRESIDENT DE JURY : M. KABORET Yalacé Yamba, Pr à l’EISMV de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. MISSOHOU Ayao, Pr à l’EISMV de Dakar MEMBRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar/M. SAWADOGO Germain Jérôme, Pr honoraire de l’EISMV de Dakar/M. TRAORE Elhadji, Maître de recherches à l’ISRA/ Sénégal CO-DIRECTEUR : M. KASSAMBARA Hamidou, Expert en production animale au PADEL-Mali DATE DE SOUTENANCE : 02/05/2024 PAYS : Mali Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5258 Evaluation de la rentabilité économique de l’embouche bovine au Mali, cas du cercle de Ségou [texte imprimé] / Boubacar COULIBALY, Auteur . - Dakar : EISMV, 2024 . - 29p.
Langues : Français (fre)
Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2024 Mots-clés : BOVIN EMBOUCHE SEGO MALI Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : Ce travail qui contribue à l’amélioration des revenus des producteurs par la mise à la disposition
d’informations fiables sur la rentabilité économique de l’embouche bovine, s’est déroulé du
01er décembre 2021 au 30 mars 2022. L’étude a été réalisée dans le cercle de Ségou au Mali.
Elle a touché quarante exploitations. Les données ont été obtenues par enquête de terrain et
analysées. Il en ressort que 65% des exploitations utilisent exclusivement des mâles entiers,
25% des mâles castrés et des femelles, 3% des femelles et 3% des mâles castrés. L’alimentation
des animaux est assurée principalement avec les aliments concentrés et les aliments grossiers.
Les maladies rencontrées dans les exploitations ont été la Fièvre aphteuse 3% et les Parasitoses
(interne et externe) 3%. Par ailleurs, 94% des exploitations faisaient de la fièvre aphteuse, des
parasitoses, de la tuberculose et de la trypanosomose. Les points de dépenses dans les
exploitations d’embouche ont concerné l’achat des animaux, l’alimentation, l’achat de matériel,
de la main d’œuvre et les frais de soins vétérinaires. Les emboucheurs achetaient les animaux
adultes à différent prix, dont les moyennes se situaient entre 274 214 FCFA à 293 750 FCFA.
Les poids vifs moyens à l’entrée des animaux embouchés étaient de 374 kg et de 425kg pour
90 et 120 jours. Les poids vifs moyens à la sortie des animaux embouchés étaient de 444 kg et
de 518 kg pour 90 et 120 jours. Les animaux consommaient en moyenne 623 kg en aliment
grossier et 870 kg en aliment concentré pour l’embouche de 90 jours. Ceux de 120 jours
consommaient en moyenne 622,5 kg en aliment grossier et 1402 kg en aliment concentré. Les
gains moyens quotidiens étaient de 770 g pour 90 jours d’embouche et 775 g pour 120 jours
d’embouche. Le coût de l’alimentation par animal embouché pendant 120 jours est ou était,
harmoniser dans le document de 274 524 FCFA comme maximal, moyen 211 002 FCFA et
minimum 95 963 FCFA. Les animaux d’embouche de 90 jours ont un coût d’alimentation
minimum de 63 863 FCFA, moyen de 121 370 FCFA et un maximum de 196 587 FCFA. Les
animaux embouchés durant 90 jours ont été vendus à un prix moyen de 519 286 FCFA et de
618 750 FCFA prix moyen de vente des animaux embouchés durant 120 jours. Les
emboucheurs ont fait un bénéfice moyen de 140 000 FCFA en embouche de 120 jours et
120 000FCFA en celle de 90 jours. L’embouche bovine est une activité rentable selon les
emboucheurs. Les emboucheurs ignorent certains postes de dépenses tels que la main-d’œuvre
et les infrastructures.PRESIDENT DE JURY : M. KABORET Yalacé Yamba, Pr à l’EISMV de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. MISSOHOU Ayao, Pr à l’EISMV de Dakar MEMBRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar/M. SAWADOGO Germain Jérôme, Pr honoraire de l’EISMV de Dakar/M. TRAORE Elhadji, Maître de recherches à l’ISRA/ Sénégal CO-DIRECTEUR : M. KASSAMBARA Hamidou, Expert en production animale au PADEL-Mali DATE DE SOUTENANCE : 02/05/2024 PAYS : Mali Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5258 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité M390 MEM24-03 Mémoire Bibliothèque (SID) Mémoires de Master Disponible Documents numériques

MEM24-03Adobe Acrobat PDFEvaluation des pratiques de gestion reproductive des chevaux dans les haras au Sénégal : cas des haras nationaux de Kébémer, Dahra et Thiès. / Aminata GUEYE (2023)

Titre : Evaluation des pratiques de gestion reproductive des chevaux dans les haras au Sénégal : cas des haras nationaux de Kébémer, Dahra et Thiès. Type de document : texte imprimé Auteurs : Aminata GUEYE, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2023 Importance : 74p. Langues : Français (fre) Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2023 Mots-clés : REPRODUCTION CHEVAL HARAS NATIONAL SENEGAL Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : L’objectif de cette étude était de décrire les pratiques de gestion reproductive existantes dans les haras au Sénégal : les modes de reproduction pratiqués, les techniques de récolte et de conservation de la semence et les performances de reproduction des étalons et juments. L’étude a concerné les données de reproduction de 2018 à 2022 des trois haras nationaux suivants : Kébémer, Dahra et Thiès. Notre travail a révélé que les modes de reproduction pratiqués au Sénégal dans les haras sont l’insémination artificielle de semence fraîche et de semence réfrigérée. Ces deux techniques se font avec le suivi folliculaire par échographie ou synchronisation des chaleurs. La technique de suivi folliculaire échographe associée à l’IAF est la plus pratiquée. Au total, 6764 juments ont été suivies et inséminées dans les trois structures durant les saisons de reproduction de 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Le taux de gestation moyen est de 51,98% ce qui représente 3516 juments gestantes. Dans ces haras, la récolte de la semence se fait avec un mannequin ou à l’aide d’une jument en chaleurs. La semence est diluée avec du lait demi-écrémé et conservée dans des equitainers ou des glacières. PRESIDENT DE JURY : M. MBAYE Gora, Pr à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-Stomatologie DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. NTEME-ELLA Gualbert Simon, Maître de conférences Agrégé à l’EISMV RAPPORTEUR : M. NTEME-ELLA Gualbert Simon, Maître de conférences Agrégé à l’EISMV MEMBRE : M. LAPO Rock Allister, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar CO-DIRECTEUR : M. DIAW Mouhamadou, Pr agrégé à la faculté de Médecine Vétérinaire de l’Université de Montréal DATE DE SOUTENANCE : 29/11/2023 PAYS : Sénégal Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5217 Evaluation des pratiques de gestion reproductive des chevaux dans les haras au Sénégal : cas des haras nationaux de Kébémer, Dahra et Thiès. [texte imprimé] / Aminata GUEYE, Auteur . - Dakar : EISMV, 2023 . - 74p.
Langues : Français (fre)
Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2023 Mots-clés : REPRODUCTION CHEVAL HARAS NATIONAL SENEGAL Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : L’objectif de cette étude était de décrire les pratiques de gestion reproductive existantes dans les haras au Sénégal : les modes de reproduction pratiqués, les techniques de récolte et de conservation de la semence et les performances de reproduction des étalons et juments. L’étude a concerné les données de reproduction de 2018 à 2022 des trois haras nationaux suivants : Kébémer, Dahra et Thiès. Notre travail a révélé que les modes de reproduction pratiqués au Sénégal dans les haras sont l’insémination artificielle de semence fraîche et de semence réfrigérée. Ces deux techniques se font avec le suivi folliculaire par échographie ou synchronisation des chaleurs. La technique de suivi folliculaire échographe associée à l’IAF est la plus pratiquée. Au total, 6764 juments ont été suivies et inséminées dans les trois structures durant les saisons de reproduction de 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Le taux de gestation moyen est de 51,98% ce qui représente 3516 juments gestantes. Dans ces haras, la récolte de la semence se fait avec un mannequin ou à l’aide d’une jument en chaleurs. La semence est diluée avec du lait demi-écrémé et conservée dans des equitainers ou des glacières. PRESIDENT DE JURY : M. MBAYE Gora, Pr à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-Stomatologie DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. NTEME-ELLA Gualbert Simon, Maître de conférences Agrégé à l’EISMV RAPPORTEUR : M. NTEME-ELLA Gualbert Simon, Maître de conférences Agrégé à l’EISMV MEMBRE : M. LAPO Rock Allister, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar CO-DIRECTEUR : M. DIAW Mouhamadou, Pr agrégé à la faculté de Médecine Vétérinaire de l’Université de Montréal DATE DE SOUTENANCE : 29/11/2023 PAYS : Sénégal Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5217 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T1703 TD23-56 Thèse Bibliothèque (SID) Thèses Vétérinaires Disponible Documents numériques

TD23-56Adobe Acrobat PDFContribution à la connaissance épidémiologique et à l’étude de l’impact de la fièvre aphteuse porcine dans les zones suivant la route nationale Nº1. (SENEGAL) Cas de l’épizootie de 2018. / Aloyse DIOUF (2023)

PermalinkEvaluation de l’utilisation des antimicrobiens dans les aliments avicoles dans les régions de Dakar et Thiès (Sénégal) en 2023 / Abdoulkader MOUSBAHOU MAMAN (2023)

PermalinkAnalyse des connaissances, attitudes et pratiques des populations sur l’Influenza Aviaire Hautement Pathogène dans la région du Centre au Burkina Faso / Blegnê Ulrich BASSANE (2023)

PermalinkContribution à l’étude de l’anatomie échographique abdominale chez le chien de race locale à Dakar (Sénégal). / Abdelkerim ISSA RACHID (2023)

PermalinkEtat de mise en œuvre de la législation vétérinaire harmonisée dans les pays de l’UEMOA entre 2018 et 2022 : cas du Sénégal / Abdoulaye DIALLO (2023)

PermalinkContribution des activités de l’EISMV dans le développement des secteurs de l’élevage et de la pèche dans les Etats membres et perspectives : cas du Burkina Faso de 1968 a 2022 / Farida OUEDRAOGO (2023)

PermalinkContribution des activités de l’EISMV dans le développement des secteurs de l’élevage et de la pêche dans les États membres et perspectives : cas du Cameroun de 1968 à 2022. / Amadou Mamadou DJIGO (2024)

PermalinkEtude comparée de trois (03) méthodes de diagnostic de gestation chez les vaches inséminées au Sénégal : dosage de la progestérone, des protéines associées à la gestation et l’échographie / Ousseynatou MBALLO (2023)

PermalinkContribution des activités de l’EISMV dans le développement des secteurs de l’élevage et de la pêche des Etats membres : cas du Bénin / Claude Valère EZOUN (2023)

PermalinkEtat des lieux des pratiques chirurgicales dans les cabinets vétérinaires de la cote d’ivoire / Bouhy Franck Emmanuel KONAN (2023)

Permalink