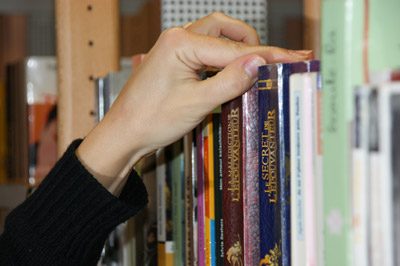EISMV DE DAKAR: Service d'Information et de Documentation
Résultat de la recherche
64 recherche sur le mot-clé
'MALI' 


 Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche Interroger des sources externes
Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche Interroger des sources externesAnalyse de la chaîne de valeur viande bovine dans le district de Bamako (Mali / Mohamed Niaré (2016)

Titre : Analyse de la chaîne de valeur viande bovine dans le district de Bamako (Mali : propositions de stratégies pour une réduction du prix du kilogramme de la viande bovine Type de document : texte imprimé Auteurs : Mohamed Niaré, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2016 Importance : 91 p. Note générale :
Langues : Français (fre) Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2016 Mots-clés : VIANDE BOVIN COMMERCIALISATION MALI Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : Le Mali est un pays sahélien à vocation essentiellement agro-pastorale. Le sous-secteur élevage participe de façon importante entre 10 et 20% au PIB et constitue le troisième produit d’exportation du pays, après l’or et le coton. Le cheptel bovin national est estimé à plus de 10 000 000 de têtes et offre au Mali un profit favorable à l’exportation du bétail. En dépit de ce potentiel fort intéressant, se pose au Mali la problématique de
l’approvisionnement satisfaisant de la population, en viande rouge et ses produits dérivés. Le niveau de consommation de la viande rouge est estimé à 12 kg par personne par an contre 62 kg fixé comme norme minimale de référence de la FAO. La viande est devenue donc un aliment de luxe dont le coût à l’état actuel qui est de 2000 à 2 200 FCFA le kg est jugé élevé par les consommateurs Malien, d’où l’importance de la présente étude. L'objectif de l'étude est de procéder à une analyse de la chaîne de valeur viande bovine dans le district de Bamako et de proposer un modèle de fonctionnement pouvant contribuer à la réduction du prix de kilogramme de viande bovine chez le consommateur. L’étude a porté sur 105
bouchers composés de chevillards, bouchers abattants et bouchers détaillants. L’étude a révélé une faible performance, caractérisée par : la mauvaise hygiène, la faible communication, une mauvaise gouvernance, la mauvaise répartition des gains entre les maillons et au sein des maillons. Avec un résultat de 111 FCFA de bénéfice par kg chez le chevillard (producteur) et un écart-type de 85 FCFA, une diminution de 100 FCFA peut
entraîner une perte considérable chez la moitié des producteurs. Cet écart de marge est en grande partie dû aux erreurs d’estimation du poids de l’animal à l’achat. La possibilité de diminution du prix repose sur l’organisation de la commercialisation. La stratégie proposée, consiste à améliorer la pratique métrologique en instaurant au niveau des marchés à bétail après concertations, des bascules pèse-bétails, permettant la vente au poids vif des animaux de boucherie. Toutefois, en vue de rendre possible une diminution du prix du kg de viande, il faudra diminuer considérablement le risque de résultat négatif dû à l’achat de l’animal de boucherie par estimation du poids carcasse en évoluer vers des marchés de cadran (achat au poids vif des animaux sur pieds) et réduire l’exportation du bétail sur pieds au profit de la viande.PRESIDENT DE JURY : M. MBAYE Gora, Maître de Conférences Agrégé à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. DIAKITE Lamissa, PHD, Chercheur à l’IER, Bamako - Mali RAPPORTEUR : M. KAMGA WALADJO Alain Richi, Maître de Conférences agrégé à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. LAPO Rock Allister, Maître de Conférences agrégé à l’EISMV de Dakar CO-DIRECTEUR : M. OSSEBI Walter, Assistant à l’EISMV de Dakar DATE DE SOUTENANCE : 30/01/2016 PAYS : MALI Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1907 Analyse de la chaîne de valeur viande bovine dans le district de Bamako (Mali : propositions de stratégies pour une réduction du prix du kilogramme de la viande bovine [texte imprimé] / Mohamed Niaré, Auteur . - Dakar : EISMV, 2016 . - 91 p.
Langues : Français (fre)
Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2016 Mots-clés : VIANDE BOVIN COMMERCIALISATION MALI Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : Le Mali est un pays sahélien à vocation essentiellement agro-pastorale. Le sous-secteur élevage participe de façon importante entre 10 et 20% au PIB et constitue le troisième produit d’exportation du pays, après l’or et le coton. Le cheptel bovin national est estimé à plus de 10 000 000 de têtes et offre au Mali un profit favorable à l’exportation du bétail. En dépit de ce potentiel fort intéressant, se pose au Mali la problématique de
l’approvisionnement satisfaisant de la population, en viande rouge et ses produits dérivés. Le niveau de consommation de la viande rouge est estimé à 12 kg par personne par an contre 62 kg fixé comme norme minimale de référence de la FAO. La viande est devenue donc un aliment de luxe dont le coût à l’état actuel qui est de 2000 à 2 200 FCFA le kg est jugé élevé par les consommateurs Malien, d’où l’importance de la présente étude. L'objectif de l'étude est de procéder à une analyse de la chaîne de valeur viande bovine dans le district de Bamako et de proposer un modèle de fonctionnement pouvant contribuer à la réduction du prix de kilogramme de viande bovine chez le consommateur. L’étude a porté sur 105
bouchers composés de chevillards, bouchers abattants et bouchers détaillants. L’étude a révélé une faible performance, caractérisée par : la mauvaise hygiène, la faible communication, une mauvaise gouvernance, la mauvaise répartition des gains entre les maillons et au sein des maillons. Avec un résultat de 111 FCFA de bénéfice par kg chez le chevillard (producteur) et un écart-type de 85 FCFA, une diminution de 100 FCFA peut
entraîner une perte considérable chez la moitié des producteurs. Cet écart de marge est en grande partie dû aux erreurs d’estimation du poids de l’animal à l’achat. La possibilité de diminution du prix repose sur l’organisation de la commercialisation. La stratégie proposée, consiste à améliorer la pratique métrologique en instaurant au niveau des marchés à bétail après concertations, des bascules pèse-bétails, permettant la vente au poids vif des animaux de boucherie. Toutefois, en vue de rendre possible une diminution du prix du kg de viande, il faudra diminuer considérablement le risque de résultat négatif dû à l’achat de l’animal de boucherie par estimation du poids carcasse en évoluer vers des marchés de cadran (achat au poids vif des animaux sur pieds) et réduire l’exportation du bétail sur pieds au profit de la viande.PRESIDENT DE JURY : M. MBAYE Gora, Maître de Conférences Agrégé à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. DIAKITE Lamissa, PHD, Chercheur à l’IER, Bamako - Mali RAPPORTEUR : M. KAMGA WALADJO Alain Richi, Maître de Conférences agrégé à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. LAPO Rock Allister, Maître de Conférences agrégé à l’EISMV de Dakar CO-DIRECTEUR : M. OSSEBI Walter, Assistant à l’EISMV de Dakar DATE DE SOUTENANCE : 30/01/2016 PAYS : MALI Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1907 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T1314 TD16-1 Thèse Bibliothèque (SID) Thèses Vétérinaires Disponible Documents numériques

TD16-1Adobe Acrobat PDF
Titre : Analyse du fonctionnement de la chaine de valeur bétail au Mali : cas du commerce de bétail sur l’axe Mali-Sénégal. Type de document : texte imprimé Auteurs : Alou Dolo, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2017 Importance : 67 p. Langues : Français (fre) Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2017 Mots-clés : BETAIL COMMERCIALISATION SENEGAL MALI Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : Le Mali est un pays d’Afrique de l’Ouest à vocation agro-sylvo-pastorale. Disposant d’un effectif numérique du cheptel, le bétail malien fait l’objet d’exportation vers les pays de la sous-région. Avec la crise ivoirienne de 2002, l’exportation de bétail vers le Sénégal a augmenté de façon
considérable. Cette opportunité d’une nouvelle chaine de commerce fait intervenir une multitude d’acteur qui renchérit le prix du bétail et rend le bétail moins compétitif le bétail malien sur le marché Sénégalais. C’est dans cette optique qu’une étude a été entreprise pour analyser le fonctionnement de la chaine de valeur bétail sur l’axe de commerce Mali - Sénégal. Cette étude a intéressé 14 marchés à bétail au Mali et au Sénégal a permis de recueillir les informations auprès des intervenants de la chaine de valeur. Ce travail vise à faire une typologie des acteurs et une évaluation économique de leurs activités afin de formuler des recommandations pour améliorer son fonctionnement. Un questionnaire a été administré auprès de 100 acteurs de la chaine. Les résultats montrent que les acteurs intervenant dans la chaine de valeur sont les producteurs, les
commerçants qui sont majoritairement présent sur les marchés une proportion de 69.8% et les bouchers. La vente de bovins s’avère la plus rentable pour les commerçants avec une marge moyenne de 59 000 F CFA. Pour la vente de petits ruminants les bouchers
détiennent une marge plus élevée avec une moyenne de 17 000 F CFA et 10 000F CFA pour les ovins et caprins respectivement. Les producteurs sont les plus lésés de la chaine de valeur en termes de rentabilité économique. Pour améliorer le fonctionnement du commerce de bétail entre le Mali et le Sénégal, les deux Etats , doivent assouplir le nombre de barrière de contrôle sur les axes de convoyages en les réduisant au strict minimum, entrevoir une possibilité de financement de l’activité des acteurs et crée un cadre de concertation entre les deux Etats, les acteurs et les institutions financements pour une redynamisation de la chaine de commerce.PRESIDENT DE JURY : M. FALL Djibril, Pr à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odontologie de Dakar. DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. WALADJO Alain Richi KAMGA, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : M. LAPO Rock Allister, Maitre de conférences agrégé à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. ASSANE Moussa, Professeur titulaire à l’EISMV de Dakar CO-DIRECTEUR : M. KERGNA Alpha Oumar, Chercheur Agro-Economiste à IER/ECOFIL Bamako-Mali. DATE DE SOUTENANCE : 16/12/2017 PAYS : Mali Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=2005 Analyse du fonctionnement de la chaine de valeur bétail au Mali : cas du commerce de bétail sur l’axe Mali-Sénégal. [texte imprimé] / Alou Dolo, Auteur . - Dakar : EISMV, 2017 . - 67 p.
Langues : Français (fre)
Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2017 Mots-clés : BETAIL COMMERCIALISATION SENEGAL MALI Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : Le Mali est un pays d’Afrique de l’Ouest à vocation agro-sylvo-pastorale. Disposant d’un effectif numérique du cheptel, le bétail malien fait l’objet d’exportation vers les pays de la sous-région. Avec la crise ivoirienne de 2002, l’exportation de bétail vers le Sénégal a augmenté de façon
considérable. Cette opportunité d’une nouvelle chaine de commerce fait intervenir une multitude d’acteur qui renchérit le prix du bétail et rend le bétail moins compétitif le bétail malien sur le marché Sénégalais. C’est dans cette optique qu’une étude a été entreprise pour analyser le fonctionnement de la chaine de valeur bétail sur l’axe de commerce Mali - Sénégal. Cette étude a intéressé 14 marchés à bétail au Mali et au Sénégal a permis de recueillir les informations auprès des intervenants de la chaine de valeur. Ce travail vise à faire une typologie des acteurs et une évaluation économique de leurs activités afin de formuler des recommandations pour améliorer son fonctionnement. Un questionnaire a été administré auprès de 100 acteurs de la chaine. Les résultats montrent que les acteurs intervenant dans la chaine de valeur sont les producteurs, les
commerçants qui sont majoritairement présent sur les marchés une proportion de 69.8% et les bouchers. La vente de bovins s’avère la plus rentable pour les commerçants avec une marge moyenne de 59 000 F CFA. Pour la vente de petits ruminants les bouchers
détiennent une marge plus élevée avec une moyenne de 17 000 F CFA et 10 000F CFA pour les ovins et caprins respectivement. Les producteurs sont les plus lésés de la chaine de valeur en termes de rentabilité économique. Pour améliorer le fonctionnement du commerce de bétail entre le Mali et le Sénégal, les deux Etats , doivent assouplir le nombre de barrière de contrôle sur les axes de convoyages en les réduisant au strict minimum, entrevoir une possibilité de financement de l’activité des acteurs et crée un cadre de concertation entre les deux Etats, les acteurs et les institutions financements pour une redynamisation de la chaine de commerce.PRESIDENT DE JURY : M. FALL Djibril, Pr à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odontologie de Dakar. DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. WALADJO Alain Richi KAMGA, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : M. LAPO Rock Allister, Maitre de conférences agrégé à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. ASSANE Moussa, Professeur titulaire à l’EISMV de Dakar CO-DIRECTEUR : M. KERGNA Alpha Oumar, Chercheur Agro-Economiste à IER/ECOFIL Bamako-Mali. DATE DE SOUTENANCE : 16/12/2017 PAYS : Mali Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=2005 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T1398 TD17-40 Thèse Bibliothèque (SID) Thèses Vétérinaires Disponible Documents numériques

TD17-40Adobe Acrobat PDFappréciation des caractéristiques physico-chimiques, nutritionnelles et sensorielles de trios variétés de sorgho fortifiées et de leurs dérivés au Mali (2022) / Koniba KONARE (2023)

Titre : appréciation des caractéristiques physico-chimiques, nutritionnelles et sensorielles de trios variétés de sorgho fortifiées et de leurs dérivés au Mali (2022) Type de document : texte imprimé Auteurs : Koniba KONARE, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2023 Importance : 32p. Langues : Français (fre) Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2023 Mots-clés : ALIMENTATION DES ANIMAUX SORGHO MALI Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : Le sorgho est l’une des céréales la plus utilisée au Mali, mais pauvre en éléments nutritifs. La fortification du sorgho a vu le jour afin d’améliorer ses qualités nutritionnelles et technologiques. Le but de notre étude est de caractériser deux variétés fortifiées de sorgho (Saba nafantè, Doucouyiriwa) et d’une variété témoin (Séguifa). La caractérisation a porté sur la détermination de leurs caractéristiques physicochimiques, nutritionnelles et sensorielles ainsi que les caractéristiques organoleptiques et nutritionnelles de leurs produits transformés (tô et couscous). La teneur en protéines a été déterminée par la méthode de Kjeldahl. Les teneurs en lysine et thréonine ont été déterminées par la méthode AccQ-Fluor Reagent Kit. Les teneurs en fer et zinc ont été déterminées par la méthode de dosage par Spectrophotométrie d’absorption atomique. Les cendres ont été déterminées par la méthode AOAC (1993). L’humidité a été déterminée par la méthode l’ISO 712 :2009. Les teneurs en eau des variétés de sorgho fortifié varient de 8,20% à 8,76%. Les variétés de sorgho fortifiées étudiées avaient des teneurs qui varient en protéines (9,68% à 12,05%), thréonine (0,32% à 1,71%), lysine (0,93% à 2,64%), fer (5,37mg/100g à 8,05mg/100g) et zinc (1,46mg/100g à 1,67mg/100g).
La quantité d’eau pour la cuisson a varié suivant les variétés et de plats à préparer.
Les teneurs des grains non décortiqués ont été plus élevées en éléments nutritifs que celles des farines ayant subi le décorticage et les teneurs des aliments (tô) issus de ces transformations ont renfermé les plus faibles valeurs. Cela prouve que les sons de ces grains contiennent la grande partie des éléments nutritifs tels que la lysine, la thréonine, le fer, le zinc. Cela montre que le décorticage et les transformations impactent négativement sur la qualité du sorgho.
Le tô et le couscous de Doucouyiriwa et Saba nafantè ont été appréciés plus positivement par 73% des dégustateurs alors que le témoin Séguifa été apprécié bon par plus de 60% des dégustateurs.
Les résultats obtenus ont montré que les sorghos fortifiés étaient plus riches en éléments nutritifs que le sorgho témoin avant la transformation. Par contre au cours de la transformation, c’est le phénomène contraire qui a été constaté.
PRESIDENT DE JURY : M. KABORET Yalacé Yamba, Pr titulaire à l’E.I.S.M. V de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme CISSE Fatimata Diallo, Maitre de Recherche à l’IER de Bamako, MEMBRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr titulaire à l’EISMV de Dakar/M. SAWADOGO Germain Jérôme, Pr honoraire de l’EISMV de Dakar/M. AYESSOU Nicolas Cyrille Mensah, Pr titulaire à l’ESP-UCAD CO-DIRECTEUR : M. Khalifa Serigne Babacar, Maître de Conférences Agrégé à l’USSEIN de Kaolack DATE DE SOUTENANCE : 05/05/2023 PAYS : Mali Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5062 appréciation des caractéristiques physico-chimiques, nutritionnelles et sensorielles de trios variétés de sorgho fortifiées et de leurs dérivés au Mali (2022) [texte imprimé] / Koniba KONARE, Auteur . - Dakar : EISMV, 2023 . - 32p.
Langues : Français (fre)
Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2023 Mots-clés : ALIMENTATION DES ANIMAUX SORGHO MALI Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : Le sorgho est l’une des céréales la plus utilisée au Mali, mais pauvre en éléments nutritifs. La fortification du sorgho a vu le jour afin d’améliorer ses qualités nutritionnelles et technologiques. Le but de notre étude est de caractériser deux variétés fortifiées de sorgho (Saba nafantè, Doucouyiriwa) et d’une variété témoin (Séguifa). La caractérisation a porté sur la détermination de leurs caractéristiques physicochimiques, nutritionnelles et sensorielles ainsi que les caractéristiques organoleptiques et nutritionnelles de leurs produits transformés (tô et couscous). La teneur en protéines a été déterminée par la méthode de Kjeldahl. Les teneurs en lysine et thréonine ont été déterminées par la méthode AccQ-Fluor Reagent Kit. Les teneurs en fer et zinc ont été déterminées par la méthode de dosage par Spectrophotométrie d’absorption atomique. Les cendres ont été déterminées par la méthode AOAC (1993). L’humidité a été déterminée par la méthode l’ISO 712 :2009. Les teneurs en eau des variétés de sorgho fortifié varient de 8,20% à 8,76%. Les variétés de sorgho fortifiées étudiées avaient des teneurs qui varient en protéines (9,68% à 12,05%), thréonine (0,32% à 1,71%), lysine (0,93% à 2,64%), fer (5,37mg/100g à 8,05mg/100g) et zinc (1,46mg/100g à 1,67mg/100g).
La quantité d’eau pour la cuisson a varié suivant les variétés et de plats à préparer.
Les teneurs des grains non décortiqués ont été plus élevées en éléments nutritifs que celles des farines ayant subi le décorticage et les teneurs des aliments (tô) issus de ces transformations ont renfermé les plus faibles valeurs. Cela prouve que les sons de ces grains contiennent la grande partie des éléments nutritifs tels que la lysine, la thréonine, le fer, le zinc. Cela montre que le décorticage et les transformations impactent négativement sur la qualité du sorgho.
Le tô et le couscous de Doucouyiriwa et Saba nafantè ont été appréciés plus positivement par 73% des dégustateurs alors que le témoin Séguifa été apprécié bon par plus de 60% des dégustateurs.
Les résultats obtenus ont montré que les sorghos fortifiés étaient plus riches en éléments nutritifs que le sorgho témoin avant la transformation. Par contre au cours de la transformation, c’est le phénomène contraire qui a été constaté.
PRESIDENT DE JURY : M. KABORET Yalacé Yamba, Pr titulaire à l’E.I.S.M. V de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme CISSE Fatimata Diallo, Maitre de Recherche à l’IER de Bamako, MEMBRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr titulaire à l’EISMV de Dakar/M. SAWADOGO Germain Jérôme, Pr honoraire de l’EISMV de Dakar/M. AYESSOU Nicolas Cyrille Mensah, Pr titulaire à l’ESP-UCAD CO-DIRECTEUR : M. Khalifa Serigne Babacar, Maître de Conférences Agrégé à l’USSEIN de Kaolack DATE DE SOUTENANCE : 05/05/2023 PAYS : Mali Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5062 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité M377 MEM23-06 Mémoire Bibliothèque (SID) Mémoires de Master Disponible Documents numériques

MEM23-06Adobe Acrobat PDF
Titre : Brucellose bovine : Enquête, connaissances, attitudes, pratiques (CAP) et prévalence dans les fermes laitières périurbaines de Bamako (Mali) Type de document : texte imprimé Auteurs : Elisabeth Dembélé, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2018 Importance : 70 p. Langues : Français (fre) Mots-clés : BRUCELLOSE BOVIN FERME LAITIERE VACHE LAITIERE MALI Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : La brucellose bovine est une maladie infectieuse et contagieuse, mais aussi une importante zoonose sur le plan mondial. La maladie chez les bovins est due essentiellement à Brucella abortus, qui est très répandue en Afrique. La présente étude s’inscrit dans un partenariat nord-sud entre l’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires de Dakar (EISMV) et le Royal Veterinary Collège (RVC) ainsi que l’Animal and Plant Health Agency (APHA) pour ce qui est du
volet animal. Le projet (ZELS) cible le système des zones de production laitières péri-urbaines de Bamako. Cette étude s’est déroulée sur un an (2016-2017) dans la zone péri-urbaine de Bamako. Son objectif général a été de connaître l’état actuel de la brucellose bovine dans les fermes laitières péri-urbaines de Bamako. De façon spécifique, il s’agissait de déterminer la séroprévalence de la brucellose bovine dans les zones périphériques de Bamako. Pour atteindre cet objectif, un échantillon de 143 laits et de 402 sérums a été testé à l’Elisa indirect et au RB. De plus, 95 éleveurs ont été interviewés à l’aide d’un questionnaire sur une tablette, pour l’évaluation de l’état
de connaissance et les facteurs de transmission de la brucellose. Les résultats d’analyses de laboratoire ont révélés 26 cas positifs au RB, soit une séroprévalence globale de 6,47%. A l’iELISA (BRUCELISA M) fourni par le projet ZELS, 17 (28,33%) cas positifs ont été révélés à l’analyse du lait individuel sur les 5 axes. Cependant, aucun mâle n’a été révélé positif sur le test RB. Par ailleurs, 3 (33,33%) cas positifs dans les fermes modernes et 23 (29,51%) cas positifs dans les fermes traditionnelles ont été obtenus à l’analyse du lait de mélange ; il en ressort donc une prévalence globale de 31,33% pour ce dernier. La plupart des éleveurs interviewés, ignoraient la brucellose animale. Ils sont exposés à la maladie, d’une part par des manipulations des avortons ou des placentas et d’autre part par la consommation du lait cru. Des recommandations sont donc faites à l’endroit des autorités sanitaires et vétérinaires, des éleveurs et des chercheurs afin d’éradiquer la brucellose animale.PRESIDENT DE JURY : Mme N’Dèye Méry DIA BADIANE DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme Rianatou BADA ALAMBEDJI RAPPORTEUR : Mme Rianatou BADA ALAMBEDJI MEMBRE : M. Oubri Bassa GBATI CO-DIRECTEUR : M. Justin Ayayi AKAKPO/Dr Andrée Prisca Ndjoug NDOUR/M. Adama FANE DATE DE SOUTENANCE : 25/07/2018 PAYS : Mali Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=2058 Brucellose bovine : Enquête, connaissances, attitudes, pratiques (CAP) et prévalence dans les fermes laitières périurbaines de Bamako (Mali) [texte imprimé] / Elisabeth Dembélé, Auteur . - Dakar : EISMV, 2018 . - 70 p.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : BRUCELLOSE BOVIN FERME LAITIERE VACHE LAITIERE MALI Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : La brucellose bovine est une maladie infectieuse et contagieuse, mais aussi une importante zoonose sur le plan mondial. La maladie chez les bovins est due essentiellement à Brucella abortus, qui est très répandue en Afrique. La présente étude s’inscrit dans un partenariat nord-sud entre l’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires de Dakar (EISMV) et le Royal Veterinary Collège (RVC) ainsi que l’Animal and Plant Health Agency (APHA) pour ce qui est du
volet animal. Le projet (ZELS) cible le système des zones de production laitières péri-urbaines de Bamako. Cette étude s’est déroulée sur un an (2016-2017) dans la zone péri-urbaine de Bamako. Son objectif général a été de connaître l’état actuel de la brucellose bovine dans les fermes laitières péri-urbaines de Bamako. De façon spécifique, il s’agissait de déterminer la séroprévalence de la brucellose bovine dans les zones périphériques de Bamako. Pour atteindre cet objectif, un échantillon de 143 laits et de 402 sérums a été testé à l’Elisa indirect et au RB. De plus, 95 éleveurs ont été interviewés à l’aide d’un questionnaire sur une tablette, pour l’évaluation de l’état
de connaissance et les facteurs de transmission de la brucellose. Les résultats d’analyses de laboratoire ont révélés 26 cas positifs au RB, soit une séroprévalence globale de 6,47%. A l’iELISA (BRUCELISA M) fourni par le projet ZELS, 17 (28,33%) cas positifs ont été révélés à l’analyse du lait individuel sur les 5 axes. Cependant, aucun mâle n’a été révélé positif sur le test RB. Par ailleurs, 3 (33,33%) cas positifs dans les fermes modernes et 23 (29,51%) cas positifs dans les fermes traditionnelles ont été obtenus à l’analyse du lait de mélange ; il en ressort donc une prévalence globale de 31,33% pour ce dernier. La plupart des éleveurs interviewés, ignoraient la brucellose animale. Ils sont exposés à la maladie, d’une part par des manipulations des avortons ou des placentas et d’autre part par la consommation du lait cru. Des recommandations sont donc faites à l’endroit des autorités sanitaires et vétérinaires, des éleveurs et des chercheurs afin d’éradiquer la brucellose animale.PRESIDENT DE JURY : Mme N’Dèye Méry DIA BADIANE DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme Rianatou BADA ALAMBEDJI RAPPORTEUR : Mme Rianatou BADA ALAMBEDJI MEMBRE : M. Oubri Bassa GBATI CO-DIRECTEUR : M. Justin Ayayi AKAKPO/Dr Andrée Prisca Ndjoug NDOUR/M. Adama FANE DATE DE SOUTENANCE : 25/07/2018 PAYS : Mali Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=2058 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T1433 TD18-30 Thèse Bibliothèque (SID) Thèses Vétérinaires Disponible Documents numériques

TD18-30Adobe Acrobat PDF
Titre : Caractérisation des systèmes de production du bassin laitier de Kassela au Mali Type de document : texte imprimé Auteurs : Diahara Himeidou, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Importance : 94 p. Note générale : PAYS: Mali
DSOUT: 29/07/2015
Langues : Français (fre) Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2015 Mots-clés : BOVIN LAITIER LAIT BOVIN COMMERCIALISATION MALI Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : L’élevage et particulièrement la production du lait occupe une place prépondérante comme
facteur de réduction de la pauvreté et de croissance économique au Mali. La présente étude qui vise à
contribuer à l’élaboration de référentiels techniques des exploitations laitières dans le bassin laitier de
Kassela au Mali a été réalisée dans 28 sites laitiers préalablement répertoriés dans un rayon de 90
km de la capitale du Mali (Bamako). Un choix raisonné de 50% des élevages identifiés a permis
d’administrer le questionnaire à 100 éleveurs avec un effectif de 4 170 animaux dont 2 102 vaches en
reproduction et 827 vaches en lactantion. Les résultats ont montré trois types d’élevages (semi intensif,
pastoral sédentaire et agropastoral) sur la base des caractéristiques socio professionnelles des éleveurs
et zootechniques. En effet, les éleveurs possédaient un très petit nombre de vaches laitières (en
moyenne 8,81 % du cheptel bovin) tandis que les vaches en reproduction représentaient 21,08 % pour
un troupeau moyen de 42 têtes. Par contre, la production s’étalait sur toute l’année (35 et
36,5l/élevage/jour pendant l’hivernage et la saison sèche respectivement). La totalité du lait produit
(environ 1500l/Jour) était vendu frais en raison de la présence d’une mini laiterie et de quatre centres de
collecte. Par ailleurs, les Peulhs constituent l’ethnie majoritaire (52,52 %) et représentent 24 % des
agro-éleveurs sur un total de 36 % (Couronne 3) et 19 % des peulhs ne pratiquent que l’élevage
(Couronne 2). En outre 37 % des éleveurs sont des citadins résidant à Bamako et qui sont de
fonctionnaires, retraités et commerçant (couronne 1). Le mode d’alimentation est le pâturage mais 97%
des éleveurs disent apporter un supplément alimentaire. L’insémination artificielle est effectuée dans
45% des élevages avec 47 % de réussite et l’intervalle vêlage-vêlage d’environ 17 mois. L’âge moyen
de première mise à la reproduction était d’environ 3 ans et 4 ans pour la première mise-bas. Les
pathologies les plus dominantes sont la fièvre aphteuse (82 %) suivi de la trypanosomiase (58 %).
Cette étude révèle des contraintes qui nécessitent et exigent des actions concrètes à l’état malien visant
à la mise en place d’une plateforme performante, dynamique et durable, d’une usine de transformations
de lait local et un encadrement technique adéquat des agents terrain et des éleveurs.PRESIDENT DE JURY : M. CISSE Moussa Fafa, Pr à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. MISSOHOU Ayao, Pr à l’E.I.S.M.V de Dakar RAPPORTEUR : M. MISSOHOU Ayao, Pr à l’E.I.S.M.V de Dakar MEMBRE : M. ASSANE Moussa, Pr à l’E.I.S.M.V de Dakar CO-DIRECTEUR : M. OUOLOGUEM Bara, Chef du Programme Bovin du Centre Régional de la Recherche Agricole (CRRA) au Mali DATE DE SOUTENANCE : 29/07/2015 PAYS : MALI Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1889 Caractérisation des systèmes de production du bassin laitier de Kassela au Mali [texte imprimé] / Diahara Himeidou, Auteur . - Dakar : EISMV, [s.d.] . - 94 p.
PAYS: Mali
DSOUT: 29/07/2015
Langues : Français (fre)
Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2015 Mots-clés : BOVIN LAITIER LAIT BOVIN COMMERCIALISATION MALI Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : L’élevage et particulièrement la production du lait occupe une place prépondérante comme
facteur de réduction de la pauvreté et de croissance économique au Mali. La présente étude qui vise à
contribuer à l’élaboration de référentiels techniques des exploitations laitières dans le bassin laitier de
Kassela au Mali a été réalisée dans 28 sites laitiers préalablement répertoriés dans un rayon de 90
km de la capitale du Mali (Bamako). Un choix raisonné de 50% des élevages identifiés a permis
d’administrer le questionnaire à 100 éleveurs avec un effectif de 4 170 animaux dont 2 102 vaches en
reproduction et 827 vaches en lactantion. Les résultats ont montré trois types d’élevages (semi intensif,
pastoral sédentaire et agropastoral) sur la base des caractéristiques socio professionnelles des éleveurs
et zootechniques. En effet, les éleveurs possédaient un très petit nombre de vaches laitières (en
moyenne 8,81 % du cheptel bovin) tandis que les vaches en reproduction représentaient 21,08 % pour
un troupeau moyen de 42 têtes. Par contre, la production s’étalait sur toute l’année (35 et
36,5l/élevage/jour pendant l’hivernage et la saison sèche respectivement). La totalité du lait produit
(environ 1500l/Jour) était vendu frais en raison de la présence d’une mini laiterie et de quatre centres de
collecte. Par ailleurs, les Peulhs constituent l’ethnie majoritaire (52,52 %) et représentent 24 % des
agro-éleveurs sur un total de 36 % (Couronne 3) et 19 % des peulhs ne pratiquent que l’élevage
(Couronne 2). En outre 37 % des éleveurs sont des citadins résidant à Bamako et qui sont de
fonctionnaires, retraités et commerçant (couronne 1). Le mode d’alimentation est le pâturage mais 97%
des éleveurs disent apporter un supplément alimentaire. L’insémination artificielle est effectuée dans
45% des élevages avec 47 % de réussite et l’intervalle vêlage-vêlage d’environ 17 mois. L’âge moyen
de première mise à la reproduction était d’environ 3 ans et 4 ans pour la première mise-bas. Les
pathologies les plus dominantes sont la fièvre aphteuse (82 %) suivi de la trypanosomiase (58 %).
Cette étude révèle des contraintes qui nécessitent et exigent des actions concrètes à l’état malien visant
à la mise en place d’une plateforme performante, dynamique et durable, d’une usine de transformations
de lait local et un encadrement technique adéquat des agents terrain et des éleveurs.PRESIDENT DE JURY : M. CISSE Moussa Fafa, Pr à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. MISSOHOU Ayao, Pr à l’E.I.S.M.V de Dakar RAPPORTEUR : M. MISSOHOU Ayao, Pr à l’E.I.S.M.V de Dakar MEMBRE : M. ASSANE Moussa, Pr à l’E.I.S.M.V de Dakar CO-DIRECTEUR : M. OUOLOGUEM Bara, Chef du Programme Bovin du Centre Régional de la Recherche Agricole (CRRA) au Mali DATE DE SOUTENANCE : 29/07/2015 PAYS : MALI Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1889 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T1296 TD15-40 Thèse Bibliothèque (SID) Thèses Vétérinaires Disponible Documents numériques

TD15-40Adobe Acrobat PDFContribution à la dynamisation de la chaine de valeur lait dans le bassin laitier de Kassel au Mali / Ousmane Bagayoko (2016)

PermalinkPermalinkDétermination de quelques valeurs usuelles des paramètres biochimiques des ânes (Equus asinus) du Mali / Yacouba Kéménany (2015)

PermalinkLes dominantes pathologiques des équidés dans les zones suivies par la SPANA au Mali / Mama Traoré (2015)

PermalinkEtat du bien-être des équidés de trait dans les zones suivies par la SPANA au Mali. / Awa Sadio Yena (2017)

Permalink