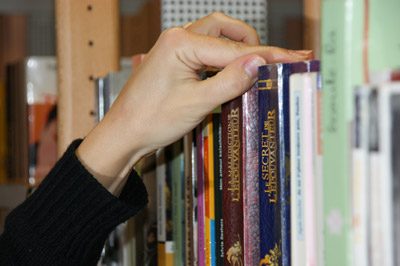EISMV DE DAKAR: Service d'Information et de Documentation
Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (57)

 Interroger des sources externes
Interroger des sources externesEffets de l’utilisation des phytobiotiques (moringa oleifera, zingiber officinale, citrus limon) comme alternatives aux antibiotiques et vitamines de synthèse sur les performances zootechnico-économiques du poulet de chair à Dakar, Sénégal / Zennaba ALLANDA (2024)

Titre : Effets de l’utilisation des phytobiotiques (moringa oleifera, zingiber officinale, citrus limon) comme alternatives aux antibiotiques et vitamines de synthèse sur les performances zootechnico-économiques du poulet de chair à Dakar, Sénégal Type de document : texte imprimé Auteurs : Zennaba ALLANDA, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2024 Importance : 79p. Langues : Français (fre) Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2024 Mots-clés : ANTIBIOTIQUE VITAMINE PHYTOBIOTIQUE PERFORMANCE POULET DE CHAIR DAKAR Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : Le développement de l’aviculture moderne ces dernières décennies en Afrique subsaharienne s’accompagne d’une utilisation des antistress à base des antibiotiques et de vitamines dans les élevages, et qui contribue sans doute à l’aggravation du phénomène de résistance aux antimicrobiens (RAM). Certes, l’administration des extraits naturels de certaines plantes (phytobiotiques) aux propriétés médicinales bien connues, constituerait une alternative intéressante pour limiter la RAM. Ce travail a été donc entrepris pour évaluer les effets des infusions de feuilles de Moringa oleifera, de Zingiber officinale et de Citrus limon, comme alternatives aux antistress chimiques, en eau de boisson sur les performances du poulet de chair. Conduit durant 7 semaines, de mars à mai 2024 dans la ferme de l’EISMV à Sangalkam, cet essai a porté sur 300 poussins chair, d’un jour, non sexés de souche Cobb 500, répartis de façon aléatoire en 4 lots de 75 sujets chacun avec 3 répétitions de 25 sujets, correspondant respectivement aux 4 traitements prophylactiques dont un témoin, TT (où les sujets ont eu per os de l’eau à raison de 0,5 g Tetracolivit®/L), I-MO (où ils recevaient une infusion de 30 g feuilles de M. oleifera/L), I-MOZO (où ils ont bu une infusion de 30 g feuilles de M. oleifera et de 5 g de Z. officinale/L) et I-MOCL (où ils ont été sous une infusion de 30 g feuilles de M. oleifera et de 5 ml de C. limon/L d’eau). Ces oiseaux ont été nourris durant les différentes phases d’essai avec un même aliment commercial et de l’eau de robinet à volonté en dehors des moments d’application des traitements. Les différentes données collectées ou calculées et enregistrées par traitement, ont été soumises à une ANOVA, complétée par le multiple range test de Ducan à l’aide du logiciel SPSS au seuil de 5%.
Il ressort des résultats que l’administration des phytobiotiques n’a engendré aucun effet néfaste sur la santé et la mortalité des sujets. Excepté la phase de démarrage où il a été noté une baisse significative, elle n’a engendré aucun effet négatif sur les poids vifs et les gains moyens quotidiens des poulets, qui sont globalement similaires entre traitements. Il en est de même pour les poids et rendements de carcasse, les poids du foie et du coeur. Contrairement aux indices de consommation qui sont restés similaires entre traitements phytobiotiques (1,92 - 1,97), mais significativement détériorés par rapport au témoin (1,83), les consommations alimentaires ont été semblables entre traitements, excepté le I-MO où les sujets ont une ingestion significativement plus faible que celle des témoins. Il en est de même pour la consommation d’eau qui a été identique entre les traitements, excepté celle des sujets de I-MOCL qui a été significativement plus faible. Au plan économique, les marges bénéficiaires brutes alimentaires par kg de poids carcasse n’ont pas été aussi négativement affectées avec le traitement I-MO qui est resté significativement le plus profitable. On y retient que ces phytobiotiques restent une alternative naturelle efficace aux antistress synthétiques pour maintenir des résultats optimaux en élevage du poulet de chair.PRESIDENT DE JURY : Mme SYLLA GUEYE Rokhaya, Pr Titulaire à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’odontologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. AYSSIWEDE Simplice Bosco Pr Titulaire à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : M. AYSSIWEDE Simplice Bosco Pr Titulaire à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. NTEME ELLA Gualbert S., Maître de Conférences Agregé à l’EISMV de Dakar/M. ATTINDEHOU Sabbas, Maître de Conférences Agrégé à l’UNA de Porto-Novo CO-ENCADRANT : M. ATCHIWASSA, Sodjinin, Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’EISMV de Dakar DATE DE SOUTENANCE : 13/12/2024 PAYS : Tchad Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5132 Effets de l’utilisation des phytobiotiques (moringa oleifera, zingiber officinale, citrus limon) comme alternatives aux antibiotiques et vitamines de synthèse sur les performances zootechnico-économiques du poulet de chair à Dakar, Sénégal [texte imprimé] / Zennaba ALLANDA, Auteur . - Dakar : EISMV, 2024 . - 79p.
Langues : Français (fre)
Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2024 Mots-clés : ANTIBIOTIQUE VITAMINE PHYTOBIOTIQUE PERFORMANCE POULET DE CHAIR DAKAR Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : Le développement de l’aviculture moderne ces dernières décennies en Afrique subsaharienne s’accompagne d’une utilisation des antistress à base des antibiotiques et de vitamines dans les élevages, et qui contribue sans doute à l’aggravation du phénomène de résistance aux antimicrobiens (RAM). Certes, l’administration des extraits naturels de certaines plantes (phytobiotiques) aux propriétés médicinales bien connues, constituerait une alternative intéressante pour limiter la RAM. Ce travail a été donc entrepris pour évaluer les effets des infusions de feuilles de Moringa oleifera, de Zingiber officinale et de Citrus limon, comme alternatives aux antistress chimiques, en eau de boisson sur les performances du poulet de chair. Conduit durant 7 semaines, de mars à mai 2024 dans la ferme de l’EISMV à Sangalkam, cet essai a porté sur 300 poussins chair, d’un jour, non sexés de souche Cobb 500, répartis de façon aléatoire en 4 lots de 75 sujets chacun avec 3 répétitions de 25 sujets, correspondant respectivement aux 4 traitements prophylactiques dont un témoin, TT (où les sujets ont eu per os de l’eau à raison de 0,5 g Tetracolivit®/L), I-MO (où ils recevaient une infusion de 30 g feuilles de M. oleifera/L), I-MOZO (où ils ont bu une infusion de 30 g feuilles de M. oleifera et de 5 g de Z. officinale/L) et I-MOCL (où ils ont été sous une infusion de 30 g feuilles de M. oleifera et de 5 ml de C. limon/L d’eau). Ces oiseaux ont été nourris durant les différentes phases d’essai avec un même aliment commercial et de l’eau de robinet à volonté en dehors des moments d’application des traitements. Les différentes données collectées ou calculées et enregistrées par traitement, ont été soumises à une ANOVA, complétée par le multiple range test de Ducan à l’aide du logiciel SPSS au seuil de 5%.
Il ressort des résultats que l’administration des phytobiotiques n’a engendré aucun effet néfaste sur la santé et la mortalité des sujets. Excepté la phase de démarrage où il a été noté une baisse significative, elle n’a engendré aucun effet négatif sur les poids vifs et les gains moyens quotidiens des poulets, qui sont globalement similaires entre traitements. Il en est de même pour les poids et rendements de carcasse, les poids du foie et du coeur. Contrairement aux indices de consommation qui sont restés similaires entre traitements phytobiotiques (1,92 - 1,97), mais significativement détériorés par rapport au témoin (1,83), les consommations alimentaires ont été semblables entre traitements, excepté le I-MO où les sujets ont une ingestion significativement plus faible que celle des témoins. Il en est de même pour la consommation d’eau qui a été identique entre les traitements, excepté celle des sujets de I-MOCL qui a été significativement plus faible. Au plan économique, les marges bénéficiaires brutes alimentaires par kg de poids carcasse n’ont pas été aussi négativement affectées avec le traitement I-MO qui est resté significativement le plus profitable. On y retient que ces phytobiotiques restent une alternative naturelle efficace aux antistress synthétiques pour maintenir des résultats optimaux en élevage du poulet de chair.PRESIDENT DE JURY : Mme SYLLA GUEYE Rokhaya, Pr Titulaire à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’odontologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. AYSSIWEDE Simplice Bosco Pr Titulaire à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : M. AYSSIWEDE Simplice Bosco Pr Titulaire à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. NTEME ELLA Gualbert S., Maître de Conférences Agregé à l’EISMV de Dakar/M. ATTINDEHOU Sabbas, Maître de Conférences Agrégé à l’UNA de Porto-Novo CO-ENCADRANT : M. ATCHIWASSA, Sodjinin, Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’EISMV de Dakar DATE DE SOUTENANCE : 13/12/2024 PAYS : Tchad Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5132 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T1770 TD24-53 Thèse Bibliothèque (SID) Thèses Vétérinaires Disponible Documents numériques

TD24-53Adobe Acrobat PDFTypologie des fermes laitières dans la zone péri-urbaine de Parakou (Bénin) / Esdra Olatoundji KANGALA (2024)

Titre : Typologie des fermes laitières dans la zone péri-urbaine de Parakou (Bénin) Type de document : texte imprimé Auteurs : Esdra Olatoundji KANGALA, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2024 Importance : 79p. Langues : Français (fre) Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2024 Mots-clés : FERME LAITIERE TYPOLOGIE PARAKOU BENIN Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : L'élevage joue un rôle crucial dans l'économie et dans la société en contribuant non seulement à la sécurité alimentaire, mais aussi à la génération de revenus pour de nombreuses familles rurales.
Cette thèse vise à contribuer à l'évolution de la filière laitière béninoise à travers une étude typologique des exploitations laitières situées dans les zones périurbaines de Parakou. L'objectif principal est d'analyser le secteur, d'identifier les contraintes rencontrées par les éleveurs et de proposer des recommandations pour améliorer les politiques laitières du pays.
Pour atteindre ces objectifs, une enquête a été réalisée entre décembre 2023 et Avril 2024 sur 45 exploitations laitières.
Les résultats montrent que 97,77 % des éleveurs sont des hommes, avec une majorité d'entre eux âgés de 23 à 40 ans (37,8 %). La population des éleveurs est majoritairement issue du groupe ethnique Peulh (78,26 %). En termes d'éducation, 80 % des éleveurs ne sont pas scolarisés. La gestion des fermes est principalement assurée par les propriétaires eux-mêmes (56,52 %), et la taille moyenne des exploitations est de 7,4 hectares.
Concernant l'élevage, 97,77 % des exploitations pratiquent la monte naturelle et 78 % se nourrissent principalement au pâturage naturel. La production de lait est manuelle et en moyenne, chaque exploitation produit environ 11,27 litres par jour. Les résultats soulignent également des défis majeurs tels que les problèmes de santé animale et les difficultés d'abreuvement.
L'analyse typologique a permis d'identifier trois types d'élevages : le premier type I, représentant 68,89 % des fermes, dominé par l'ethnie Peulh (75,75 %) et reposant sur des pratiques traditionnelles avec une alimentation 100 % sur parcours intégral, sans contrôle laitier pour 96,96 % des cas. Le Type II, qui constitue 28,89 % des fermes, inclut principalement des exploitations privées et présente un effectif de bétail moyen de 50 à 100 bêtes, avec une gestion plus contrôlée et 38,46 % de contrôle laitier. Enfin, le Type III qui ne représente que 2,2 % des fermes, avec plus de 300 bêtes et une production laitière de 20 litres par jour, combinant monte naturelle et insémination artificielle dans un cadre intensif et institutionnel.
Cette étude met en lumière non seulement les caractéristiques et défis du secteur laitier béninois mais aussi les opportunités pour son développement. Il est crucial que des politiques adaptées soient mises en place pour soutenir ces éleveurs dans l'amélioration de leur production laitière.PRESIDENT DE JURY : M. SY Papa Mady, Maitre de Conférences Agrégé à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. MISSOHOU Ayao, Pr Titulaire à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : M. AYSSIWEDE Simplice Bosco, Pr Titulaire à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. LAPO Rock Allister, Maitre de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar DATE DE SOUTENANCE : 05/05/2025 PAYS : Bénin Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5134 Typologie des fermes laitières dans la zone péri-urbaine de Parakou (Bénin) [texte imprimé] / Esdra Olatoundji KANGALA, Auteur . - Dakar : EISMV, 2024 . - 79p.
Langues : Français (fre)
Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2024 Mots-clés : FERME LAITIERE TYPOLOGIE PARAKOU BENIN Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : L'élevage joue un rôle crucial dans l'économie et dans la société en contribuant non seulement à la sécurité alimentaire, mais aussi à la génération de revenus pour de nombreuses familles rurales.
Cette thèse vise à contribuer à l'évolution de la filière laitière béninoise à travers une étude typologique des exploitations laitières situées dans les zones périurbaines de Parakou. L'objectif principal est d'analyser le secteur, d'identifier les contraintes rencontrées par les éleveurs et de proposer des recommandations pour améliorer les politiques laitières du pays.
Pour atteindre ces objectifs, une enquête a été réalisée entre décembre 2023 et Avril 2024 sur 45 exploitations laitières.
Les résultats montrent que 97,77 % des éleveurs sont des hommes, avec une majorité d'entre eux âgés de 23 à 40 ans (37,8 %). La population des éleveurs est majoritairement issue du groupe ethnique Peulh (78,26 %). En termes d'éducation, 80 % des éleveurs ne sont pas scolarisés. La gestion des fermes est principalement assurée par les propriétaires eux-mêmes (56,52 %), et la taille moyenne des exploitations est de 7,4 hectares.
Concernant l'élevage, 97,77 % des exploitations pratiquent la monte naturelle et 78 % se nourrissent principalement au pâturage naturel. La production de lait est manuelle et en moyenne, chaque exploitation produit environ 11,27 litres par jour. Les résultats soulignent également des défis majeurs tels que les problèmes de santé animale et les difficultés d'abreuvement.
L'analyse typologique a permis d'identifier trois types d'élevages : le premier type I, représentant 68,89 % des fermes, dominé par l'ethnie Peulh (75,75 %) et reposant sur des pratiques traditionnelles avec une alimentation 100 % sur parcours intégral, sans contrôle laitier pour 96,96 % des cas. Le Type II, qui constitue 28,89 % des fermes, inclut principalement des exploitations privées et présente un effectif de bétail moyen de 50 à 100 bêtes, avec une gestion plus contrôlée et 38,46 % de contrôle laitier. Enfin, le Type III qui ne représente que 2,2 % des fermes, avec plus de 300 bêtes et une production laitière de 20 litres par jour, combinant monte naturelle et insémination artificielle dans un cadre intensif et institutionnel.
Cette étude met en lumière non seulement les caractéristiques et défis du secteur laitier béninois mais aussi les opportunités pour son développement. Il est crucial que des politiques adaptées soient mises en place pour soutenir ces éleveurs dans l'amélioration de leur production laitière.PRESIDENT DE JURY : M. SY Papa Mady, Maitre de Conférences Agrégé à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. MISSOHOU Ayao, Pr Titulaire à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : M. AYSSIWEDE Simplice Bosco, Pr Titulaire à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. LAPO Rock Allister, Maitre de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar DATE DE SOUTENANCE : 05/05/2025 PAYS : Bénin Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5134 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T1768 TD24-51 Thèse Bibliothèque (SID) Thèses Vétérinaires Disponible Documents numériques

TD24-51Adobe Acrobat PDFGestion des déchets biomédicaux dans les cabinets vétérinaires de la région de Dakar en 2024 / Kadjogbe Eustache Sheriff ESSE (2024)

Titre : Gestion des déchets biomédicaux dans les cabinets vétérinaires de la région de Dakar en 2024 Type de document : texte imprimé Auteurs : Kadjogbe Eustache Sheriff ESSE, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2024 Importance : 77p. Langues : Français (fre) Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2024 Mots-clés : DECHET BIOMEDICAL DECHET CABINET VETERINAIRE DAKAR SENEGAL Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : Les cabinets vétérinaires ont longtemps été négligés au profit des centres hospitaliers en ce qui concerne la production de DBM. Pourtant, ces cabinets se multiplient à proximité des habitations, et par leur production de DBM, ils constituent un danger permanent pour la santé humaine, animale et environnementale. C’est pour contribuer à l'amélioration de la santé publique en optimisant la gestion des DBM dans les cabinets vétérinaires que nous avons mené une enquête auprès de 28 cabinets vétérinaires répartis dans les cinq départements de la région de Dakar, sur une période allant de février à juillet 2024. À partir d'un questionnaire basé sur des travaux antérieurs et les textes réglementaires en vigueur, nous avons dressé un état des lieux de tous les aspects de la GDBM dans ces cabinets. Nous avons également évalué les connaissances des acteurs sur les normes existantes, les contraintes rencontrées, ainsi que leurs propositions de solutions.
Notre étude a révélé que les DBM produits par ces cabinets se composent de déchets radioactifs et génotoxiques dans 1 % des cas, de déchets chimiques et pharmaceutiques dans 26% des cas, de déchets infectieux dans 36 %, et d'objets pointus et tranchants dans 37% des cas. En termes de quantité hebdomadaire, 4 % des cabinets produisent plus de 10 kg de DBM, 25 % en produisent entre 5 et 10 kg, et 71 % en produisent moins de 5 kg. Tous les cabinets effectuent un tri des DBM de manière aléatoire, non conforme aux réglementations en vigueur, et seulement 75 % utilisent des gants. Parmi ceux qui trient les déchets, 53,57 % utilisent des poubelles distinctes selon le type de déchet, tandis que les autres, y compris ceux qui ne trient pas, stockent les DBM dans des bennes ordinaires et dans des lieux non conformes aux normes. La collecte et le transport des DBM sont réalisés exclusivement à la main dans tous les cabinets. Pour le transport ex-situ, 67,86 % des cabinets le font également à la main, tandis que les autres utilisent des chariots et des véhicules spécifiques. En matière d’élimination, 56,76 % des cabinets confient leurs déchets à l'UCG, une structure communale de gestion des déchets. Parmi les autres méthodes d'élimination, 18,99 % des cabinets incinèrent leurs déchets à l'air libre, 10,81 % les jettent sur des tas d'ordures, 8,11 % les enfouissent sur place, et 5,46 % les enfouissent dans des zones non habitées.
Des accidents liés à la manipulation des DBM ont été signalés, dont 60
% de piqûres et 40 % de coupures, souvent causées par des objets tranchants ou des récipients cassés. De plus, 64,29 % du personnel des cabinets vétérinaires n'est pas informé sur la gestion des DBM, et parmi les 35,71 % qui déclarent être informés, aucun ne respecte les normes en vigueur. Près de 89,29 % des cabinets rencontrent des difficultés dans la gestion de ces déchets et tous confirment l'absence de structures dédiées spécifiquement à la gestion des DBM, conduisant à des pratiques de gestion aléatoires.
Pour améliorer la situation, 57,78 % des cabinets souhaitent la création d'une structure dédiée à la gestion des DBM, 37,78 % demandent à être formés sur les bonnes pratiques, et 4,44 % souhaitent recevoir des outils adéquats (équipements de protection individuelle, incinérateurs, etc.).
Au vu de ces constats, nous avons formulé des recommandations à l’intention des différents acteurs pour une meilleure gestion des DBM.PRESIDENT DE JURY : M. FALL Alioune Dior, Pr Titulaire à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme KADJA WONOU Mireille Catherine, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : Mme KADJA WONOU Mireille Catherine, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. GBATI Oubri Bassa, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar ENCADRANT : M. SOUROKOU SABI Souahibou, Clinicien Vacataire à l’EISMV DATE DE SOUTENANCE : 12/12/2024 PAYS : Bénin Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5138 Gestion des déchets biomédicaux dans les cabinets vétérinaires de la région de Dakar en 2024 [texte imprimé] / Kadjogbe Eustache Sheriff ESSE, Auteur . - Dakar : EISMV, 2024 . - 77p.
Langues : Français (fre)
Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2024 Mots-clés : DECHET BIOMEDICAL DECHET CABINET VETERINAIRE DAKAR SENEGAL Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : Les cabinets vétérinaires ont longtemps été négligés au profit des centres hospitaliers en ce qui concerne la production de DBM. Pourtant, ces cabinets se multiplient à proximité des habitations, et par leur production de DBM, ils constituent un danger permanent pour la santé humaine, animale et environnementale. C’est pour contribuer à l'amélioration de la santé publique en optimisant la gestion des DBM dans les cabinets vétérinaires que nous avons mené une enquête auprès de 28 cabinets vétérinaires répartis dans les cinq départements de la région de Dakar, sur une période allant de février à juillet 2024. À partir d'un questionnaire basé sur des travaux antérieurs et les textes réglementaires en vigueur, nous avons dressé un état des lieux de tous les aspects de la GDBM dans ces cabinets. Nous avons également évalué les connaissances des acteurs sur les normes existantes, les contraintes rencontrées, ainsi que leurs propositions de solutions.
Notre étude a révélé que les DBM produits par ces cabinets se composent de déchets radioactifs et génotoxiques dans 1 % des cas, de déchets chimiques et pharmaceutiques dans 26% des cas, de déchets infectieux dans 36 %, et d'objets pointus et tranchants dans 37% des cas. En termes de quantité hebdomadaire, 4 % des cabinets produisent plus de 10 kg de DBM, 25 % en produisent entre 5 et 10 kg, et 71 % en produisent moins de 5 kg. Tous les cabinets effectuent un tri des DBM de manière aléatoire, non conforme aux réglementations en vigueur, et seulement 75 % utilisent des gants. Parmi ceux qui trient les déchets, 53,57 % utilisent des poubelles distinctes selon le type de déchet, tandis que les autres, y compris ceux qui ne trient pas, stockent les DBM dans des bennes ordinaires et dans des lieux non conformes aux normes. La collecte et le transport des DBM sont réalisés exclusivement à la main dans tous les cabinets. Pour le transport ex-situ, 67,86 % des cabinets le font également à la main, tandis que les autres utilisent des chariots et des véhicules spécifiques. En matière d’élimination, 56,76 % des cabinets confient leurs déchets à l'UCG, une structure communale de gestion des déchets. Parmi les autres méthodes d'élimination, 18,99 % des cabinets incinèrent leurs déchets à l'air libre, 10,81 % les jettent sur des tas d'ordures, 8,11 % les enfouissent sur place, et 5,46 % les enfouissent dans des zones non habitées.
Des accidents liés à la manipulation des DBM ont été signalés, dont 60
% de piqûres et 40 % de coupures, souvent causées par des objets tranchants ou des récipients cassés. De plus, 64,29 % du personnel des cabinets vétérinaires n'est pas informé sur la gestion des DBM, et parmi les 35,71 % qui déclarent être informés, aucun ne respecte les normes en vigueur. Près de 89,29 % des cabinets rencontrent des difficultés dans la gestion de ces déchets et tous confirment l'absence de structures dédiées spécifiquement à la gestion des DBM, conduisant à des pratiques de gestion aléatoires.
Pour améliorer la situation, 57,78 % des cabinets souhaitent la création d'une structure dédiée à la gestion des DBM, 37,78 % demandent à être formés sur les bonnes pratiques, et 4,44 % souhaitent recevoir des outils adéquats (équipements de protection individuelle, incinérateurs, etc.).
Au vu de ces constats, nous avons formulé des recommandations à l’intention des différents acteurs pour une meilleure gestion des DBM.PRESIDENT DE JURY : M. FALL Alioune Dior, Pr Titulaire à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme KADJA WONOU Mireille Catherine, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : Mme KADJA WONOU Mireille Catherine, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. GBATI Oubri Bassa, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar ENCADRANT : M. SOUROKOU SABI Souahibou, Clinicien Vacataire à l’EISMV DATE DE SOUTENANCE : 12/12/2024 PAYS : Bénin Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5138 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T1767 TD24-50 Thèse Bibliothèque (SID) Thèses Vétérinaires Disponible Documents numériques

TD24-50Adobe Acrobat PDFSéroprévalence et facteurs associés à l’infection par le virus de l’influenza D chez les bovins dans les élevages de la zone péri-urbaine de Dakar et Thiès (Sénégal) en 2024 / Daouda OUEDRAOGO (2024)

Titre : Séroprévalence et facteurs associés à l’infection par le virus de l’influenza D chez les bovins dans les élevages de la zone péri-urbaine de Dakar et Thiès (Sénégal) en 2024 Type de document : texte imprimé Auteurs : Daouda OUEDRAOGO Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2024 Importance : 76p. Langues : Français (fre) Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2024 Mots-clés : INFLUENZA AVIAIRE VIRUS SEROPREVALENCE BOVIN SENEGAL Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : Le virus de l'influenza D a été identifié pour la première fois en 2011 aux États-Unis
d’Amérique dans des échantillons de porcs présentant des symptômes grippaux. Il est le
quatrième genre de la famille des Orthomyxoviridae (deltainfluenzavirus). Les infections dues
au virus de l’influenza D provoquent généralement une maladie bénigne chez les bovins, mais
peut aussi toucher diverses espèces comme les ovins, les caprins, les porcins, les camélidés,
les volailles y compris l’homme. Depuis sa découverte, le virus de l'influenza D circule dans
plusieurs régions du monde, et est de plus en plus reconnu pour son rôle pathogène dans les
maladies respiratoires des bovins surtout en Europe et aux USA. En Afrique très peu d’études
existent sur le virus et les prévalences observées sont relativement faibles par rapport aux
autres continents. L’absence d’étude sur le virus au Sénégal corrélée au fort pouvoir de
mutation des virus influenza ont motivé la présente étude. Ainsi 168 sérums de bovins ont été
prélevés dans 18 exploitations de la zone péri-urbaine de Dakar et Thiès selon un
échantillonnage aléatoire simple. Le test de l’inhibition de l’hémagglutination a été utilisé
pour les analyses de laboratoire avec comme antigène la souche virale
D/bovine/France/5920/2014. Les résultats ont révélé une prévalence globale de 31,5%
repartie comme suit : 32,2% dans la région de Dakar et 30,8% dans la région de Thiès, et la
prévalence troupeau de 94,4%. Les plus fortes prévalences ont été observées dans les élevages
à grand effectif (>50 bovins) (41,1%), ainsi que chez les animaux de race locale, exotique et
métissée nés au Sénégal (53,3%). L’effectif du cheptel, l’origine de l’animal, et la race ont été
identifiés comme des potentiels facteurs associés à l’infection au virus de l’influenza D. Au
regard de ces résultats, des recommandations ont été formulées à l’endroit des décideurs, des
vétérinaires privés et des éleveurs.PRESIDENT DE JURY : M. FALL Mamadou, Pr à la faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de l’UCAD DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme KADJA Mireille Catherine, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : Mme KADJA Mireille Catherine, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar MEMBRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar CO-DIRECTEUR : M.DAHOUROU Laibané Dieudonné, Maître de Conférences à l’Université Daniel Ouezzin Coulibaly (UDOC), Burkina Faso DATE DE SOUTENANCE : 04/11/2024 PAYS : Burkina faso Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5143 Séroprévalence et facteurs associés à l’infection par le virus de l’influenza D chez les bovins dans les élevages de la zone péri-urbaine de Dakar et Thiès (Sénégal) en 2024 [texte imprimé] / Daouda OUEDRAOGO . - Dakar : EISMV, 2024 . - 76p.
Langues : Français (fre)
Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2024 Mots-clés : INFLUENZA AVIAIRE VIRUS SEROPREVALENCE BOVIN SENEGAL Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : Le virus de l'influenza D a été identifié pour la première fois en 2011 aux États-Unis
d’Amérique dans des échantillons de porcs présentant des symptômes grippaux. Il est le
quatrième genre de la famille des Orthomyxoviridae (deltainfluenzavirus). Les infections dues
au virus de l’influenza D provoquent généralement une maladie bénigne chez les bovins, mais
peut aussi toucher diverses espèces comme les ovins, les caprins, les porcins, les camélidés,
les volailles y compris l’homme. Depuis sa découverte, le virus de l'influenza D circule dans
plusieurs régions du monde, et est de plus en plus reconnu pour son rôle pathogène dans les
maladies respiratoires des bovins surtout en Europe et aux USA. En Afrique très peu d’études
existent sur le virus et les prévalences observées sont relativement faibles par rapport aux
autres continents. L’absence d’étude sur le virus au Sénégal corrélée au fort pouvoir de
mutation des virus influenza ont motivé la présente étude. Ainsi 168 sérums de bovins ont été
prélevés dans 18 exploitations de la zone péri-urbaine de Dakar et Thiès selon un
échantillonnage aléatoire simple. Le test de l’inhibition de l’hémagglutination a été utilisé
pour les analyses de laboratoire avec comme antigène la souche virale
D/bovine/France/5920/2014. Les résultats ont révélé une prévalence globale de 31,5%
repartie comme suit : 32,2% dans la région de Dakar et 30,8% dans la région de Thiès, et la
prévalence troupeau de 94,4%. Les plus fortes prévalences ont été observées dans les élevages
à grand effectif (>50 bovins) (41,1%), ainsi que chez les animaux de race locale, exotique et
métissée nés au Sénégal (53,3%). L’effectif du cheptel, l’origine de l’animal, et la race ont été
identifiés comme des potentiels facteurs associés à l’infection au virus de l’influenza D. Au
regard de ces résultats, des recommandations ont été formulées à l’endroit des décideurs, des
vétérinaires privés et des éleveurs.PRESIDENT DE JURY : M. FALL Mamadou, Pr à la faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de l’UCAD DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme KADJA Mireille Catherine, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : Mme KADJA Mireille Catherine, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar MEMBRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar CO-DIRECTEUR : M.DAHOUROU Laibané Dieudonné, Maître de Conférences à l’Université Daniel Ouezzin Coulibaly (UDOC), Burkina Faso DATE DE SOUTENANCE : 04/11/2024 PAYS : Burkina faso Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5143 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T1752 TD24-35 Thèse Bibliothèque (SID) Thèses Vétérinaires Disponible Documents numériques

TD24-35Adobe Acrobat PDFAnalyse des échecs de reproduction chez les petits ruminants au mali (régions de Sikasso, Koutiala, Ségou) / Awa BERTHE (2024)

Titre : Analyse des échecs de reproduction chez les petits ruminants au mali (régions de Sikasso, Koutiala, Ségou) Type de document : texte imprimé Auteurs : Awa BERTHE, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2024 Importance : 103p. Langues : Français (fre) Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2024 Mots-clés : PETIT RUMINANT REPRODUCTION SIKASSO KOUTIALA MALI Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : L’élevage de petits ruminants occupe une place importante dans l’économie du Mali et constitue un facteur de réduction de la pauvreté. Mais force est de constater que cet élevage rencontre de nombreuses difficultés pour son essor. Parmi elles, les difficultés liées à la reproduction. La présente étude effectuée au Mali avait pour objectif général de faire l’état des lieux des problèmes liés aux échecs de la reproduction des petits ruminants dans les régions de Sikasso, Koutiala et Ségou. Nous avons réalisé une enquête auprès de 167 éleveurs de petits ruminants à l’aide d’un questionnaire pour la collecte d’information au niveau des exploitations ciblées.
Les résultats ont montré que la population enquêtée était constituée majoritairement des hommes (95,21%) et avait pour la plupart une tranche d’âge compris entre 36 et 60 ans. L’agriculture était la principale activité des enquêtés (66,67%) et près de la moitié était sans éducation formelle (49, 7%). L’ethnie Senoufos était la plus dominante des enquêtés. En ce qui concerne les espèces de petits ruminants dans les trois régions enquêtées, celle des ovins était la plus élevée dans la région de Sikasso et celle des caprins dans la région de Ségou. La proportion de l’espèce ovine était plus élevée par rapport à celle des caprins chez les enquêtés de la région de Koutiala. Chez les deux espèces, la pratique d’accouplement libre était la plus importante à Sikasso et Ségou. L’accouplement assisté était plus noté à Koutiala et Ségou. Selon les enquêtés, le nombre de cas d’avortement était plus élevée à Sikasso par rapport aux deux autres régions chez les petits ruminants. En ce qui concerne les conséquences liées aux échecs de reproduction la proportion de mammites et d’orchites (plus de 30%) était importante à Sikasso. Le pourcentage des cas de dystocie était considérable avec un pourcentage de plus de 20% dans les trois régions enquêtées chez les deux espèces. Parmi les facteurs qui augmentent le risque d’apparition des échecs de reproductions, les pourcentages du facteur alimentaire chez les deux espèces étaient très importants (plus de 20%) dans les régions de Sikasso contrairement à celles observées dans la région de Ségou. Les pourcentages du facteur infectieux étaient représentés par plus de 20% chez les deux espèces. Les pourcentages du facteur parasitaire étaient assez remarquables (plus de 20%) dans les trois régions enquêtées (sauf pour la mammite et l’échec d’accouplement où le pourcentage était absent chez les caprins). Le nombre de cas d’échec de reproduction dû au facteur traumatique était assez faible dans les trois régions.
Cette étude révèle des contraintes auxquelles il parait opportun d’entreprendre des mesures telles que la mise en place des programmes destinées à l’encadrement des éleveurs et la réalisation des enquêtes sérologiques afin de déterminer avec précision les pathologies engendrant les échecs de reproductions dans nos élevages de petits ruminants.PRESIDENT DE JURY : Mme SYLLA GUEYE Rokhaya, Pr à la Faculté de la Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. MISSOHOU Ayao, Pr Titulaire à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : M. AYSSIWEDE Simplice Bosco, Pr Titulaire à l’EISMV de Dakar MEMBRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr Titulaire à l’EISMV de Dakar ENCADRANT : Dr. DIONE Michel (ILRI)/Dr. ZANNOU Olivier (ILRI)/Dr. SOW Ahmadou (ILRI) DATE DE SOUTENANCE : 15/11/2024 PAYS : Mali Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5144 Analyse des échecs de reproduction chez les petits ruminants au mali (régions de Sikasso, Koutiala, Ségou) [texte imprimé] / Awa BERTHE, Auteur . - Dakar : EISMV, 2024 . - 103p.
Langues : Français (fre)
Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2024 Mots-clés : PETIT RUMINANT REPRODUCTION SIKASSO KOUTIALA MALI Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : L’élevage de petits ruminants occupe une place importante dans l’économie du Mali et constitue un facteur de réduction de la pauvreté. Mais force est de constater que cet élevage rencontre de nombreuses difficultés pour son essor. Parmi elles, les difficultés liées à la reproduction. La présente étude effectuée au Mali avait pour objectif général de faire l’état des lieux des problèmes liés aux échecs de la reproduction des petits ruminants dans les régions de Sikasso, Koutiala et Ségou. Nous avons réalisé une enquête auprès de 167 éleveurs de petits ruminants à l’aide d’un questionnaire pour la collecte d’information au niveau des exploitations ciblées.
Les résultats ont montré que la population enquêtée était constituée majoritairement des hommes (95,21%) et avait pour la plupart une tranche d’âge compris entre 36 et 60 ans. L’agriculture était la principale activité des enquêtés (66,67%) et près de la moitié était sans éducation formelle (49, 7%). L’ethnie Senoufos était la plus dominante des enquêtés. En ce qui concerne les espèces de petits ruminants dans les trois régions enquêtées, celle des ovins était la plus élevée dans la région de Sikasso et celle des caprins dans la région de Ségou. La proportion de l’espèce ovine était plus élevée par rapport à celle des caprins chez les enquêtés de la région de Koutiala. Chez les deux espèces, la pratique d’accouplement libre était la plus importante à Sikasso et Ségou. L’accouplement assisté était plus noté à Koutiala et Ségou. Selon les enquêtés, le nombre de cas d’avortement était plus élevée à Sikasso par rapport aux deux autres régions chez les petits ruminants. En ce qui concerne les conséquences liées aux échecs de reproduction la proportion de mammites et d’orchites (plus de 30%) était importante à Sikasso. Le pourcentage des cas de dystocie était considérable avec un pourcentage de plus de 20% dans les trois régions enquêtées chez les deux espèces. Parmi les facteurs qui augmentent le risque d’apparition des échecs de reproductions, les pourcentages du facteur alimentaire chez les deux espèces étaient très importants (plus de 20%) dans les régions de Sikasso contrairement à celles observées dans la région de Ségou. Les pourcentages du facteur infectieux étaient représentés par plus de 20% chez les deux espèces. Les pourcentages du facteur parasitaire étaient assez remarquables (plus de 20%) dans les trois régions enquêtées (sauf pour la mammite et l’échec d’accouplement où le pourcentage était absent chez les caprins). Le nombre de cas d’échec de reproduction dû au facteur traumatique était assez faible dans les trois régions.
Cette étude révèle des contraintes auxquelles il parait opportun d’entreprendre des mesures telles que la mise en place des programmes destinées à l’encadrement des éleveurs et la réalisation des enquêtes sérologiques afin de déterminer avec précision les pathologies engendrant les échecs de reproductions dans nos élevages de petits ruminants.PRESIDENT DE JURY : Mme SYLLA GUEYE Rokhaya, Pr à la Faculté de la Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. MISSOHOU Ayao, Pr Titulaire à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : M. AYSSIWEDE Simplice Bosco, Pr Titulaire à l’EISMV de Dakar MEMBRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr Titulaire à l’EISMV de Dakar ENCADRANT : Dr. DIONE Michel (ILRI)/Dr. ZANNOU Olivier (ILRI)/Dr. SOW Ahmadou (ILRI) DATE DE SOUTENANCE : 15/11/2024 PAYS : Mali Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5144 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T1760 TD24-43 Thèse Bibliothèque (SID) Thèses Vétérinaires Disponible Documents numériques

TD24-43Adobe Acrobat PDFEvaluation des causes des interventions chirurgicales dans les élevages d’ovins et de leur prise en charge dans les cabinets vétérinaires de la région de Dakar au Sénégal / Lybi DOSSOL (2024)

PermalinkAnalyse épidémiologique des pathologies respiratoires dans les élevages de poulets de chair dans la zone périurbaine des régions de Dakar et de Thiès (Sénégal) en 2023 / Abdoul-Kader CISSE (2024)

PermalinkEffets de l’application des implants de melatonine et des eponges vaginales (acetate de flugestone) sur les Paramètres de reproduction des ovins élevés en station dans La région de dakar (senegal) / Djawad Adjibade Alade FASSASSI (2024)

PermalinkEvaluation socio-economique de l’exploitation des chevaux dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) en 2024 / Kambè-Ammuel DAKUYO (2024)

PermalinkPrévalence et facteurs de risque associes a la dermatose nodulaire contagieuse bovine dans la région du Poro, en Côte d’Ivoire en 2024 / Yemienguigna Nougnon COULIBALY (2024)

PermalinkEtude rétrospective des cas cliniques de ruminants vus en consultation médicale a la clinique vétérinaire Fann de l'E.I.S.M.V. de Dakar (Sénégal) de 2018 à 2024 / Juliano Honore Homonloke BOKO (2024)

PermalinkDétection moléculaire d’agents pathogènes associés aux principales infections respiratoires chez les poules pondeuses en zones périurbaines des régions de Dakar et Thiès / Ido Apollinaire BAKO B. (2024)

PermalinkDétermination des valeurs usuelles de quelques paramètres biochimiques chez les chiens domestiques de la région de Dakar (Sénégal) / Abdoul karimoun ABOUBACAR MAHAMADOU (2024)

PermalinkRecherche par la méthode de charm test II des résidus d’antibiotiques dans le lait cru produit dans les régions de Diourbel, Kaolack, Kaffrine et Saint-Louis (Sénégal) en 2023. / Aïcha ANADIF ABAKAR (2024)

PermalinkValeur nutritive et digestibilité du typha australis et de ration le contenant chez les ovins dans la région de Dakar au Sénégal / Taohide Akpado LAWANI (2024)

Permalink