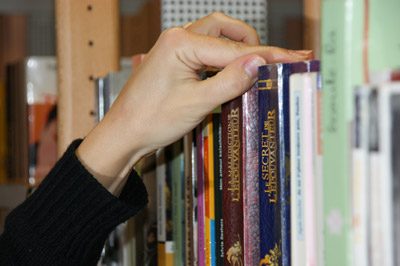EISMV DE DAKAR: Service d'Information et de Documentation
Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (70)

 Interroger des sources externes
Interroger des sources externesAnalyse de l'alimentation des collégiens et lycéens en rapport avec les nutriments préoccupants pour la santé publique : étude de cas dans une situation scolaire à Dakar/Sénégal / Khadidiatou Kane (2021)

Titre : Analyse de l'alimentation des collégiens et lycéens en rapport avec les nutriments préoccupants pour la santé publique : étude de cas dans une situation scolaire à Dakar/Sénégal Type de document : texte imprimé Auteurs : Khadidiatou Kane, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2021 Importance : 82 p. Langues : Français (fre) Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2021 Mots-clés : SANTE PUBLIQUE SECURITE SANITAIRE institution scolaire ECOLE ALIMENTATION SENEGAL Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : A l’ère de l’industrialisation et de la mondialisation des modifications du système alimentaire ont été observées et sont désignées sous le terme de «transition alimentaire ». A cela s’ajoute le fait que les activités professionnelles sont telles que les populations ont tendance à manger hors de leur domicile. Or, une alimentation hors domicile équivaut à un apport calorifique plus élevé, une plus grande consommation de graisses saturées et un apport plus élevé en sel, constituant des facteurs alimentaires pouvant entraîner les MNT telles que le diabète, le surpoids et l’obésité. Ces modifications d’ordre alimentaire et comportemental n’excluent aucunement les adolescents. Il est donc nécessaire d’évaluer le style alimentaire de ces derniers afin de prévenir et de mettre en place une stratégie de riposte contre les MNT. C’est dans cet ordre d’idée, que cette présente étude a été effectuée au sein d’une institution scolaire afin d’évaluer le style alimentaire des adolescents qui s’y trouvent et d’établir le lien entre ce dernier et les MNT. La démarche
méthodologique a été basée sur une enquête effectuée à l’aide d’un questionnaire distribué à cent quatre-vingt-douze (192) adolescents, de séances de focus groupe et d’un guide d’entretien distribué aux responsables de points de vente privés au nombre de cinq (5), au responsable de la cantine scolaire et à vingt-et-une personnes (21) ressources travaillant au sein de l’établissement. Les données recueillies ont été saisies, dépouillées et analysées à l’aide des logiciels Sphinx plus2 version 5, Excel de Microsoft Windows 10. Les résultats ont montré que, l’âge moyen est de 14,74 (±2.22) ans avec un minima de 11ans et un maxima de 19ans. Cinquante (50) adolescents prennent le petit déjeuner chez eux contre cent quarante-deux (142) qui ne mangent pas avant de sortir de chez eux. De même pour le déjeuner, 6.77% retournent chez eux pour manger à l’heure du déjeuner contre 93.23% qui mangent soit à l’école ou aux alentours. Parmi les 93.23%, 70.83% mangent au niveau des sandwicheries et points de vente et le reste au niveau du restaurant de l’établissement. De plus 53.65% prennent au moins une boisson par jour. A cela s’ajoutent le fait que 46.9% n’ont aucune activité sportive extra-scolaire. La friture est le mode principal de cuisson au niveau des points de vente privés contrairement au restaurant où elle est rarement effectuée. le poids moyen est de cinquante-huit (58) kq et la taille moyenne est d’un mètre cinquante-quatre, ce qui donne un IMC moyen de 21.56kg/m2. Dans notre échantillon 5.73% sont obèses, 20.31% sont en surpoids et 73.96% ont un poids normal. Ces informations ont permis d’établir des recommandations.PRESIDENT DE JURY : M. DIOP Amadou, Pr à la faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme MUSABYEMARIYA Bellancille, Maitre de conférences Agrégée à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : Mme MUSABYEMARIYA Bellancille, Maitre de conférences Agrégée à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. MISSOHOU Ayao, Pr titulaire à l’EISMV de Dakar DATE DE SOUTENANCE : 12/08/2021 PAYS : Sénégal Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=4663 Analyse de l'alimentation des collégiens et lycéens en rapport avec les nutriments préoccupants pour la santé publique : étude de cas dans une situation scolaire à Dakar/Sénégal [texte imprimé] / Khadidiatou Kane, Auteur . - Dakar : EISMV, 2021 . - 82 p.
Langues : Français (fre)
Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2021 Mots-clés : SANTE PUBLIQUE SECURITE SANITAIRE institution scolaire ECOLE ALIMENTATION SENEGAL Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : A l’ère de l’industrialisation et de la mondialisation des modifications du système alimentaire ont été observées et sont désignées sous le terme de «transition alimentaire ». A cela s’ajoute le fait que les activités professionnelles sont telles que les populations ont tendance à manger hors de leur domicile. Or, une alimentation hors domicile équivaut à un apport calorifique plus élevé, une plus grande consommation de graisses saturées et un apport plus élevé en sel, constituant des facteurs alimentaires pouvant entraîner les MNT telles que le diabète, le surpoids et l’obésité. Ces modifications d’ordre alimentaire et comportemental n’excluent aucunement les adolescents. Il est donc nécessaire d’évaluer le style alimentaire de ces derniers afin de prévenir et de mettre en place une stratégie de riposte contre les MNT. C’est dans cet ordre d’idée, que cette présente étude a été effectuée au sein d’une institution scolaire afin d’évaluer le style alimentaire des adolescents qui s’y trouvent et d’établir le lien entre ce dernier et les MNT. La démarche
méthodologique a été basée sur une enquête effectuée à l’aide d’un questionnaire distribué à cent quatre-vingt-douze (192) adolescents, de séances de focus groupe et d’un guide d’entretien distribué aux responsables de points de vente privés au nombre de cinq (5), au responsable de la cantine scolaire et à vingt-et-une personnes (21) ressources travaillant au sein de l’établissement. Les données recueillies ont été saisies, dépouillées et analysées à l’aide des logiciels Sphinx plus2 version 5, Excel de Microsoft Windows 10. Les résultats ont montré que, l’âge moyen est de 14,74 (±2.22) ans avec un minima de 11ans et un maxima de 19ans. Cinquante (50) adolescents prennent le petit déjeuner chez eux contre cent quarante-deux (142) qui ne mangent pas avant de sortir de chez eux. De même pour le déjeuner, 6.77% retournent chez eux pour manger à l’heure du déjeuner contre 93.23% qui mangent soit à l’école ou aux alentours. Parmi les 93.23%, 70.83% mangent au niveau des sandwicheries et points de vente et le reste au niveau du restaurant de l’établissement. De plus 53.65% prennent au moins une boisson par jour. A cela s’ajoutent le fait que 46.9% n’ont aucune activité sportive extra-scolaire. La friture est le mode principal de cuisson au niveau des points de vente privés contrairement au restaurant où elle est rarement effectuée. le poids moyen est de cinquante-huit (58) kq et la taille moyenne est d’un mètre cinquante-quatre, ce qui donne un IMC moyen de 21.56kg/m2. Dans notre échantillon 5.73% sont obèses, 20.31% sont en surpoids et 73.96% ont un poids normal. Ces informations ont permis d’établir des recommandations.PRESIDENT DE JURY : M. DIOP Amadou, Pr à la faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme MUSABYEMARIYA Bellancille, Maitre de conférences Agrégée à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : Mme MUSABYEMARIYA Bellancille, Maitre de conférences Agrégée à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. MISSOHOU Ayao, Pr titulaire à l’EISMV de Dakar DATE DE SOUTENANCE : 12/08/2021 PAYS : Sénégal Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=4663 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T1543 TD21-47 Thèse Bibliothèque (SID) Thèses Vétérinaires Disponible Documents numériques

TD21-47Adobe Acrobat PDFAnalyse du dispositif multisectoriel de contrôle de la rage à Dakar (Sénégal) / Fatima Amadou Ba (2021)

Titre : Analyse du dispositif multisectoriel de contrôle de la rage à Dakar (Sénégal) Type de document : texte imprimé Auteurs : Fatima Amadou Ba, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2021 Importance : 87 p. Langues : Français (fre) Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2021 Mots-clés : RAGE SANTE PUBLIQUE SENEGAL Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : La rage est l’une des zoonoses les plus graves et les plus craintes dans le monde. Elle affecte tous les mammifères dont l'homme et est responsable d'une encéphalomyélite mortelle. Cette maladie est largement répandue dans le monde et demeure sous notifiée surtout en Afrique. Malgré l’application des programmes de lutte, on assiste à une persistance de la maladie au Sénégal. Cette étude vise à faire une ANALYSE DU DISPOSITIF MULTISECTORIEL DE CONTRÔLE DE LA RAGE A DAKAR (SENEGAL). Les données ont été collecté s principalement auprès des acteurs des trois principaux secteurs impliqués dans la lutte contre la rage à savoir : les secteurs de la santé animale, humaine et de l’environnement. Les données collectées ont été saisies et analysées à l’aide des Logiciels Excel 2016. Les résultats ont montré que les trois principaux secteurs sont impliqués dans la lutte contre la rage au Sénégal à travers diverses actions menées. Il s’agissait principalement de la sensibilisation et de la vaccination pour le secteur de la santé animale (81,25%), de la sensibilisation (76,9%) pour la santé humaine et de la notification des cas de morsure (75%) pour l’environnement. En ce qui concerne les acteurs, la non fréquence d’une formation continue sur la rage dans le secteur de la santé humaine était marquant. En termes de Prophylaxie Post Exposition (P.P.E) il faut souligner le manque de centre de traitement antirabique mais aussi de moyens financiers des patients pour la prise en charge. En effet, la P.P.E a été complète seulement dans 6,2% des cas selon les acteurs de la santé humaine. Différentes raisons ont été avancées pour expliquer la non-observance du protocole de la PPE par les patients: perte de vue de ces derniers, la méconnaissance des patients de la gravité de la maladie, la survie de l’animal mordeur au-delà de la mise en observation et le coût de la PPE qui était à la charge du patient (prix des vaccins et frais de déplacement). Pour la collecte et la gestion des données, l’ensemble des services techniques concernés élaboraient des rapports d’activités (annuel, mensuel, hebdomadaire ou circonstanciel). La transmission des informations relatives à la gestion de la rage se faisait dans la totalité suivant la voie hiérarchique. L’existence de collaboration multisectorielle entre les différents secteurs dans la lutte contre la rage a été confirmée par 56,25% des acteurs de la santé animale, 56% des acteurs de la santé humaine et 75% des acteurs de l’environnement. Ces différents constats expliqueraient l’inefficacité du dispositif sanitaire de lutte contre la rage au Sénégal et par conséquent la persistance de la maladie et le risque important de transmission. Le bon équipement des structures de santé, la création d’autres centres de traitement antirabique, la vaccination de masse des carnivores, la sensibilisation des populations et la gestion efficace des chiens errants à travers l’assainissement de l’environnement pourraient permettre un meilleur contrôle de la rage. PRESIDENT DE JURY : Mme DIOP NYAFOUNA Sylvie Audrey, Pr à l’UFR Santé, Université de Thiès DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar MEMBRE : MonsieurM. GBATI Oubri Bassa, Maitre de Conférences agrégé à l’EISMV de Dakar CO-DIRECTEUR : Mme DIOP NYAFOUNA Sylvie Audrey, Pr à l’UFR Santé, Université de Thiès DATE DE SOUTENANCE : 26/11/2021 PAYS : Sénégal Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=4670 Analyse du dispositif multisectoriel de contrôle de la rage à Dakar (Sénégal) [texte imprimé] / Fatima Amadou Ba, Auteur . - Dakar : EISMV, 2021 . - 87 p.
Langues : Français (fre)
Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2021 Mots-clés : RAGE SANTE PUBLIQUE SENEGAL Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : La rage est l’une des zoonoses les plus graves et les plus craintes dans le monde. Elle affecte tous les mammifères dont l'homme et est responsable d'une encéphalomyélite mortelle. Cette maladie est largement répandue dans le monde et demeure sous notifiée surtout en Afrique. Malgré l’application des programmes de lutte, on assiste à une persistance de la maladie au Sénégal. Cette étude vise à faire une ANALYSE DU DISPOSITIF MULTISECTORIEL DE CONTRÔLE DE LA RAGE A DAKAR (SENEGAL). Les données ont été collecté s principalement auprès des acteurs des trois principaux secteurs impliqués dans la lutte contre la rage à savoir : les secteurs de la santé animale, humaine et de l’environnement. Les données collectées ont été saisies et analysées à l’aide des Logiciels Excel 2016. Les résultats ont montré que les trois principaux secteurs sont impliqués dans la lutte contre la rage au Sénégal à travers diverses actions menées. Il s’agissait principalement de la sensibilisation et de la vaccination pour le secteur de la santé animale (81,25%), de la sensibilisation (76,9%) pour la santé humaine et de la notification des cas de morsure (75%) pour l’environnement. En ce qui concerne les acteurs, la non fréquence d’une formation continue sur la rage dans le secteur de la santé humaine était marquant. En termes de Prophylaxie Post Exposition (P.P.E) il faut souligner le manque de centre de traitement antirabique mais aussi de moyens financiers des patients pour la prise en charge. En effet, la P.P.E a été complète seulement dans 6,2% des cas selon les acteurs de la santé humaine. Différentes raisons ont été avancées pour expliquer la non-observance du protocole de la PPE par les patients: perte de vue de ces derniers, la méconnaissance des patients de la gravité de la maladie, la survie de l’animal mordeur au-delà de la mise en observation et le coût de la PPE qui était à la charge du patient (prix des vaccins et frais de déplacement). Pour la collecte et la gestion des données, l’ensemble des services techniques concernés élaboraient des rapports d’activités (annuel, mensuel, hebdomadaire ou circonstanciel). La transmission des informations relatives à la gestion de la rage se faisait dans la totalité suivant la voie hiérarchique. L’existence de collaboration multisectorielle entre les différents secteurs dans la lutte contre la rage a été confirmée par 56,25% des acteurs de la santé animale, 56% des acteurs de la santé humaine et 75% des acteurs de l’environnement. Ces différents constats expliqueraient l’inefficacité du dispositif sanitaire de lutte contre la rage au Sénégal et par conséquent la persistance de la maladie et le risque important de transmission. Le bon équipement des structures de santé, la création d’autres centres de traitement antirabique, la vaccination de masse des carnivores, la sensibilisation des populations et la gestion efficace des chiens errants à travers l’assainissement de l’environnement pourraient permettre un meilleur contrôle de la rage. PRESIDENT DE JURY : Mme DIOP NYAFOUNA Sylvie Audrey, Pr à l’UFR Santé, Université de Thiès DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar MEMBRE : MonsieurM. GBATI Oubri Bassa, Maitre de Conférences agrégé à l’EISMV de Dakar CO-DIRECTEUR : Mme DIOP NYAFOUNA Sylvie Audrey, Pr à l’UFR Santé, Université de Thiès DATE DE SOUTENANCE : 26/11/2021 PAYS : Sénégal Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=4670 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T1548 TD21-52 Thèse Bibliothèque (SID) Thèses Vétérinaires Disponible Documents numériques

TD21-52Adobe Acrobat PDFAnalyse financière d'une clinique et pharmacie veterinaires : cas de "Gana Ngom 1er" de Koungheul-Sénégal / Mamadou Sougou Dikouma (2021)

Titre : Analyse financière d'une clinique et pharmacie veterinaires : cas de "Gana Ngom 1er" de Koungheul-Sénégal Type de document : texte imprimé Auteurs : Mamadou Sougou Dikouma, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2021 Importance : 89 p. Langues : Français (fre) Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2021 Mots-clés : PHARMACIE VETERINAIRE ANALYSE ECONOMIQUE SENEGAL Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : L’avènement de la privatisation au Sénégal a touché tous les secteurs clés de l’économie, notamment la profession vétérinaire qui s’est plus développée en milieu urbain que rural. La présente étude de cas vise à faire une analyse financière d’une clinique et pharmacie vétérinaire en milieu rural, dans le département de Koungheul, au sud du Sénégal. Pour y parvenir, un questionnaire d’enquête par interview directe a été utilisé pour identifier le personnel et leur perception sur les finances de l’entreprise. Les documents de gestion de la clinique et pharmacie vétérinaire de 2019 ont été consultés. L’approche comptable a été utilisée pour traiter et analyser les données obtenues à partir du tableur Excel 2016 sous Windows 7. L’analyse SWOT y a été associée. Il ressort de cette étude que la clinique et pharmacie Gana Ngom 1er a des activités très diversifiées telles que la vente de médicaments vétérinaires, le conseil, les prestations cliniques, la vente de matériel médical, la vente de poussins, la vente d’aliments volaille et ruminant. Ces principales activités (vente de médicaments et prestation clinique) génèrent 79 % du chiffre d’affaires qui est estimé à 70 millions de F CFA. Ce chiffre d’affaire varie par mois en fonction de la présence des transhumants, d’épidémies ou encore de la récolte agricole. La clinique s’approvisionne auprès de divers fournisseurs dont le principal concentre 71,52 % de ses commandes en spécialités vétérinaires. Les forces de la clinique et pharmacie vétérinaire Gana Ngom 1er sont, entre autres, la disponibilité dans la mesure où elle est ouverte 351 jours / 365 (10h/24), la forte mobilité, les prix abordables des prestations de service. Les faiblesses concernent essentiellement l’insuffisance du personnel et la gestion inefficace du stock qui limitent les ventes et ne favorisent pas la fidélisation de la clientèle. Les menaces qui guettent la clinique sont la présence d’autres acteurs impliqués dans la santé animale, le coût des soins moindre chez les para-professionnels. Les opportunités de la clinique résident dans le fait que le département est doté d’un cheptel important d’animaux et le nombre limité de clinique et pharmacie vétérinaire privé actuellement opérant dans le département (2). Pour améliorer les performances de l’entreprise, nous avons formulé des recommandations allant dans le sens d’une meilleure gestion de la comptabilité, de la caisse, du stock de médicaments, et par le renforcement des ressources humaines. PRESIDENT DE JURY : M. DIOP Amadou, Pr à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de Dakar. DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. OSSEBI Walter, Maître-Assistant à l’EISMV RAPPORTEUR : M. AYSSIWEDE Simplice Bosco, Maitre de Conférences agrégé à l’EISMV MEMBRE : M. GBATI Oubri Bassa, Maitre de Conférences agrégé à l’EISMV DATE DE SOUTENANCE : 05/05/2021 PAYS : Sénegal Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=4703 Analyse financière d'une clinique et pharmacie veterinaires : cas de "Gana Ngom 1er" de Koungheul-Sénégal [texte imprimé] / Mamadou Sougou Dikouma, Auteur . - Dakar : EISMV, 2021 . - 89 p.
Langues : Français (fre)
Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2021 Mots-clés : PHARMACIE VETERINAIRE ANALYSE ECONOMIQUE SENEGAL Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : L’avènement de la privatisation au Sénégal a touché tous les secteurs clés de l’économie, notamment la profession vétérinaire qui s’est plus développée en milieu urbain que rural. La présente étude de cas vise à faire une analyse financière d’une clinique et pharmacie vétérinaire en milieu rural, dans le département de Koungheul, au sud du Sénégal. Pour y parvenir, un questionnaire d’enquête par interview directe a été utilisé pour identifier le personnel et leur perception sur les finances de l’entreprise. Les documents de gestion de la clinique et pharmacie vétérinaire de 2019 ont été consultés. L’approche comptable a été utilisée pour traiter et analyser les données obtenues à partir du tableur Excel 2016 sous Windows 7. L’analyse SWOT y a été associée. Il ressort de cette étude que la clinique et pharmacie Gana Ngom 1er a des activités très diversifiées telles que la vente de médicaments vétérinaires, le conseil, les prestations cliniques, la vente de matériel médical, la vente de poussins, la vente d’aliments volaille et ruminant. Ces principales activités (vente de médicaments et prestation clinique) génèrent 79 % du chiffre d’affaires qui est estimé à 70 millions de F CFA. Ce chiffre d’affaire varie par mois en fonction de la présence des transhumants, d’épidémies ou encore de la récolte agricole. La clinique s’approvisionne auprès de divers fournisseurs dont le principal concentre 71,52 % de ses commandes en spécialités vétérinaires. Les forces de la clinique et pharmacie vétérinaire Gana Ngom 1er sont, entre autres, la disponibilité dans la mesure où elle est ouverte 351 jours / 365 (10h/24), la forte mobilité, les prix abordables des prestations de service. Les faiblesses concernent essentiellement l’insuffisance du personnel et la gestion inefficace du stock qui limitent les ventes et ne favorisent pas la fidélisation de la clientèle. Les menaces qui guettent la clinique sont la présence d’autres acteurs impliqués dans la santé animale, le coût des soins moindre chez les para-professionnels. Les opportunités de la clinique résident dans le fait que le département est doté d’un cheptel important d’animaux et le nombre limité de clinique et pharmacie vétérinaire privé actuellement opérant dans le département (2). Pour améliorer les performances de l’entreprise, nous avons formulé des recommandations allant dans le sens d’une meilleure gestion de la comptabilité, de la caisse, du stock de médicaments, et par le renforcement des ressources humaines. PRESIDENT DE JURY : M. DIOP Amadou, Pr à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de Dakar. DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. OSSEBI Walter, Maître-Assistant à l’EISMV RAPPORTEUR : M. AYSSIWEDE Simplice Bosco, Maitre de Conférences agrégé à l’EISMV MEMBRE : M. GBATI Oubri Bassa, Maitre de Conférences agrégé à l’EISMV DATE DE SOUTENANCE : 05/05/2021 PAYS : Sénegal Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=4703 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T1525 TD21-29 Thèse Bibliothèque (SID) Thèses Vétérinaires Disponible Documents numériques

TD21-29.pdfAdobe Acrobat PDFCampagnes d'assainissement du marché des médicaments vétérinaires au Burkina Faso de 2015 à 2017 : bilan et perspectives / Abdoul Aziz Tiama

Titre : Campagnes d'assainissement du marché des médicaments vétérinaires au Burkina Faso de 2015 à 2017 : bilan et perspectives Type de document : texte imprimé Auteurs : Abdoul Aziz Tiama, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Importance : 96 p. Langues : Français (fre) Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2021 Mots-clés : MÉDICAMENT MARCHE CAMPAGNE D'ASSAINISSEMENT BURKINA FASO Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : La présente étude effectuée au Burkina Faso a pour objectif général de dresser le bilan des campagnes d’assainissements du marché des médicaments vétérinaires au Burkina Faso de 2015 à 2017. L’approche adoptée a consisté d’une part à une enquête exploratoire sur les textes réglementaires en vigueur portant sur la pharmacie vétérinaire au Burkina Faso, les textes réglementaires communautaires en vigueur portant sur la pharmacie vétérinaire dans l’espace UEMOA, les rapports des campagnes d’assainissements du marché des médicaments vétérinaires au Burkina Faso de 2015 à 2017 et enfin le rapport de l’atelier régional d’évaluation des Campagnes d’Assainissement du Marché des Médicaments Vétérinaires (CAMMVET) et de définition des stratégies de lutte contre la vente illicite des médicaments vétérinaires dans les États membres de L’UEMOA du 17 au 19 octobre 2017. D’autre part, elle a consisté à un entretien avec les inspecteurs du médicament vétérinaire au Burkina Faso ainsi qu’un représentant du Département de l’Agriculture, des Ressources en Eau et de l’Environnement (DAREN) en des CAMMVETs. Ceci nous a permis d’avoir d’une part un aperçu des activités réalisées lors des campagnes d’assainissement du marché des médicaments vétérinaires au Burkina Faso de 2015 à 2017, d’autre part le déroulement des différentes activités chaque campagne. Enfin un guide d’entrétien a été élaboré afin de récueillir l’avis des acteurs privés sur l’efficacité des actions du pouvoir public. Les résultats montrent que la CAMMVET de 2015 a permis le recensement des noms déposés de médicaments vétérinaires dans le circuit officiel, ainsi que des acteurs impliqués dans leur distribution au Burkina Faso. Sur cent soixante-deux (162) noms déposés de médicaments vétérinaires recensés dans le circuit officiel, 83,95 % possédaient l’AMM communautaire et 16,05 % n’avaient que l’AMM national. Pour la distribution des médicaments vétérinaires dans le circuit officiel au Burkina Faso, dix (10) établissements grossistes répartiteurs et trente-quatre (34) cliniques et pharmacies vétérinaires ont été recensés. Sur les cinquante-deux (52) cabinets de soins vétérinaires ayant l’agrément officiel d’ouverture, seuls 63,46 % fonctionnaient en réalité lors du recensement. Les activités des CAMMVETs de 2016 et de 2017 sont similaires. Cependant durant ces campagnes, il a été mené d’une part la sensibilisation sur les textes règlementaires nationaux et communautaires portant sur la pharmacie vétérinaire et d’autre part de fermer des établissements de ventes des médicaments vétérinaires tenus par les non ayants droits. Cette sensibilisation a touché au total sept cent (700) personnes dans les dix (10) régions couvertes. Quant à la fermeture des établissements de ventes illicites des médicaments vétérinaires, deux (02) cabinets de soins vétérinaires et deux (02) points de ventes de médicaments vétérinaires illicites ont été fermés. Au cours des contrôles et d’inspections inopinés dans le circuit officiel et illicite de distribution des médicaments vétérinaires, les inspecteurs ont saisi au total des médicaments vétérinaires illicites d’une valeur de 215 000 000 F CFA. Le recueil des avis des acteurs privés du marché officiel sur l’efficacité des actions des autorités en charge des médicaments vétérinaires a permis de relever des insuffisances dans les actions des autorités en charge du médicament vétérinaire. Des améliorataions doivent être apportés pour une lutte efficace du marché illicite. Le marché burkinabé des médicaments vétérinaires constitue un enjeu économique majeur. Son assainissement qui passe par le contrôle de la qualité et l’enregistrement des produits y circulant, doit être une priorité pour tous les acteurs de la filière, en vue d’un développement durable de l’élevage en Afrique en général et au Burkina Faso en particulier. PRESIDENT DE JURY : M. NDIAYE Bara, Pr à la Faculté de Médecine de Pharmacie et d'Odontologie de Dakar. RAPPORTEUR : M. GBATI Oubri Bassa, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar MEMBRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar. CO-DIRECTEUR : M. TEKO-AGBO Assiongbon, Chargé de Recherche à l’EISMV de Dakar DATE DE SOUTENANCE : 30/01/2021 PAYS : Burkina Faso Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=4651 Campagnes d'assainissement du marché des médicaments vétérinaires au Burkina Faso de 2015 à 2017 : bilan et perspectives [texte imprimé] / Abdoul Aziz Tiama, Auteur . - Dakar : EISMV, [s.d.] . - 96 p.
Langues : Français (fre)
Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2021 Mots-clés : MÉDICAMENT MARCHE CAMPAGNE D'ASSAINISSEMENT BURKINA FASO Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : La présente étude effectuée au Burkina Faso a pour objectif général de dresser le bilan des campagnes d’assainissements du marché des médicaments vétérinaires au Burkina Faso de 2015 à 2017. L’approche adoptée a consisté d’une part à une enquête exploratoire sur les textes réglementaires en vigueur portant sur la pharmacie vétérinaire au Burkina Faso, les textes réglementaires communautaires en vigueur portant sur la pharmacie vétérinaire dans l’espace UEMOA, les rapports des campagnes d’assainissements du marché des médicaments vétérinaires au Burkina Faso de 2015 à 2017 et enfin le rapport de l’atelier régional d’évaluation des Campagnes d’Assainissement du Marché des Médicaments Vétérinaires (CAMMVET) et de définition des stratégies de lutte contre la vente illicite des médicaments vétérinaires dans les États membres de L’UEMOA du 17 au 19 octobre 2017. D’autre part, elle a consisté à un entretien avec les inspecteurs du médicament vétérinaire au Burkina Faso ainsi qu’un représentant du Département de l’Agriculture, des Ressources en Eau et de l’Environnement (DAREN) en des CAMMVETs. Ceci nous a permis d’avoir d’une part un aperçu des activités réalisées lors des campagnes d’assainissement du marché des médicaments vétérinaires au Burkina Faso de 2015 à 2017, d’autre part le déroulement des différentes activités chaque campagne. Enfin un guide d’entrétien a été élaboré afin de récueillir l’avis des acteurs privés sur l’efficacité des actions du pouvoir public. Les résultats montrent que la CAMMVET de 2015 a permis le recensement des noms déposés de médicaments vétérinaires dans le circuit officiel, ainsi que des acteurs impliqués dans leur distribution au Burkina Faso. Sur cent soixante-deux (162) noms déposés de médicaments vétérinaires recensés dans le circuit officiel, 83,95 % possédaient l’AMM communautaire et 16,05 % n’avaient que l’AMM national. Pour la distribution des médicaments vétérinaires dans le circuit officiel au Burkina Faso, dix (10) établissements grossistes répartiteurs et trente-quatre (34) cliniques et pharmacies vétérinaires ont été recensés. Sur les cinquante-deux (52) cabinets de soins vétérinaires ayant l’agrément officiel d’ouverture, seuls 63,46 % fonctionnaient en réalité lors du recensement. Les activités des CAMMVETs de 2016 et de 2017 sont similaires. Cependant durant ces campagnes, il a été mené d’une part la sensibilisation sur les textes règlementaires nationaux et communautaires portant sur la pharmacie vétérinaire et d’autre part de fermer des établissements de ventes des médicaments vétérinaires tenus par les non ayants droits. Cette sensibilisation a touché au total sept cent (700) personnes dans les dix (10) régions couvertes. Quant à la fermeture des établissements de ventes illicites des médicaments vétérinaires, deux (02) cabinets de soins vétérinaires et deux (02) points de ventes de médicaments vétérinaires illicites ont été fermés. Au cours des contrôles et d’inspections inopinés dans le circuit officiel et illicite de distribution des médicaments vétérinaires, les inspecteurs ont saisi au total des médicaments vétérinaires illicites d’une valeur de 215 000 000 F CFA. Le recueil des avis des acteurs privés du marché officiel sur l’efficacité des actions des autorités en charge des médicaments vétérinaires a permis de relever des insuffisances dans les actions des autorités en charge du médicament vétérinaire. Des améliorataions doivent être apportés pour une lutte efficace du marché illicite. Le marché burkinabé des médicaments vétérinaires constitue un enjeu économique majeur. Son assainissement qui passe par le contrôle de la qualité et l’enregistrement des produits y circulant, doit être une priorité pour tous les acteurs de la filière, en vue d’un développement durable de l’élevage en Afrique en général et au Burkina Faso en particulier. PRESIDENT DE JURY : M. NDIAYE Bara, Pr à la Faculté de Médecine de Pharmacie et d'Odontologie de Dakar. RAPPORTEUR : M. GBATI Oubri Bassa, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar MEMBRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar. CO-DIRECTEUR : M. TEKO-AGBO Assiongbon, Chargé de Recherche à l’EISMV de Dakar DATE DE SOUTENANCE : 30/01/2021 PAYS : Burkina Faso Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=4651 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T1503 TD21-7 Thèse Bibliothèque (SID) Thèses Vétérinaires Disponible Documents numériques

TD21-7.pdfAdobe Acrobat PDFConnaissances, aptitudes et pratiques des ménages relatives à la rage et écologie canine à Mbour, Sénégal en 2020 / Abdou Fall (2021)

Titre : Connaissances, aptitudes et pratiques des ménages relatives à la rage et écologie canine à Mbour, Sénégal en 2020 Type de document : texte imprimé Auteurs : Abdou Fall, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2021 Importance : 84 p. Langues : Français (fre) Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2021 Mots-clés : RAGE ECOLOGIE CHAT CHIEN SENEGAL Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : La rage est une maladie virale mortelle, causant entre 59 000 et 70 000 décès humains dans le monde chaque année. Elle est principalement transmise à l'homme par les morsures de chiens infectés. Depuis plusieurs décennies, de nombreuses mesures de lutte basées essentiellement sur la réduction de la population canine ont été mises en œuvre au Sénégal. Néanmoins, la rage y est toujours endémique. Par ailleurs, des données empiriques montrent que le contrôle de la rage passe par la vaccination d’au moins 70% de la population canine. Par conséquent, la connaissance de la taille de la population de chien est nécessaire pour planifier et atteindre cet objectif. La présente étude a été conduite pour décrire l’écologie canine et les connaissances, attitudes et pratiques des ménages. Elle a consisté à une collecte de données avec l’application mobile WVS, auprès des ménages et une observation directe des chiens errants dans les rues, au cours d’une enquête transversale dans le département de Mbour, du 04 octobre au 04 novembre 2019. Les résultats relatifs à l’estimation de la taille et la distribution de la population canine montrent que, les chiens dans le département de Mbour, ont été estimés à 155 920 dont 22,5% soit 35 099 chiens étaient errants (sans propriétaires). En outre, 58,9% de cette population se trouve en milieu urbain. La majorité des chiens errants recensés soit 43,4% de ces chiens avaient une bonne note d’état corporel et plus de la moitié (54,3%) était en bonne santé physique. Les mâles étaient numériquement plus importants que les femelles dans la population canine errante. Nous avons pu également déterminer que 88, 5% des 131 ménages interrogés possédaient au moins un chien et le ratio chien domestique à propriétaire/Homme était de 1/7. En plus, 56% de la population canine domestique à propriétaire était en libre circulation, particulièrement en milieu rural où cette proportion de semi-errance atteignait 66%. Ce qui confirme la présence du risque rabique dans le département de Mbour. Quant à l’enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques des ménages sur la rage, 88,8% des participants avaient entendu parler de la rage. En revanche, plus des 2/3 avaient des connaissances erronées et insuffisantes sur la source de contamination et les signes de la rage. La conduite à tenir pour le chien, si ce dernier mordait quelqu’un n’était pas connue par 58% des enquêtés ; tandis que le tiers des personnes interrogées préconisaient d’abattre les animaux suspects de rage. De même, pour la conduite à tenir pour la victime de morsure, seulement 1/4 des répondants conseillaient le lavage de la plaie à l’eau et au savon, à la suite d’une agression par un chien avant de se rendre à l’hôpital. Tout ceci traduit un faible niveau d’information et de sensibilisation sur la rage, malgré sa gravité. Le taux de couverture vaccinale des chiens détenus par les ménages est de 19%. Les raisons de la non-vaccination de leurs chiens étaient, pour la plupart des propriétaires par simple ignorance (60%), la négligence pour 30%, et le manque de moyens financiers pour les 10% restants. Au regard de ces résultats, une réorientation de la stratégie de lutte contre la rage s’avère impérative au Sénégal. Par conséquent, des recommandations à l’endroit des différents acteurs du pays ont été formulées. Principalement, pour les populations d’adopter le lavage des plaies de morsures, de consulter aussitôt les services de santé en cas d’agression par un carnivore, que celui-ci soit vacciné ou non et de ne pas abattre les chiens mordeurs ou à défaut d’amener leurs cadavres au niveau du service vétérinaire de la zone pour le diagnostic. Nous avons également préconisé aux services vétérinaires d’instituer des campagnes de vaccination de masse périodiques des chiens errants et possédés ainsi que le contrôle de la population canine errante par la stérilisation des chiennes. PRESIDENT DE JURY : Mme DIOP NYAFOUNA Sylvie Audrey, Pr à l’UFR Santé, Université de Thiès DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. AYIH-AKAKPO Ayayi Justin, Pr à l’EISMV de Dakar CO-ENCADRANT : M. OYETOLA Wilfried Délé, Attaché Temporaire d’Enseignement et de recherche à l’EISMV de Dakar/Mme Jordana L. Burdon Bailey, Administratrice du projet Mission Rabies DATE DE SOUTENANCE : 17/03/2021 PAYS : Sénégal Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=4692 Connaissances, aptitudes et pratiques des ménages relatives à la rage et écologie canine à Mbour, Sénégal en 2020 [texte imprimé] / Abdou Fall, Auteur . - Dakar : EISMV, 2021 . - 84 p.
Langues : Français (fre)
Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2021 Mots-clés : RAGE ECOLOGIE CHAT CHIEN SENEGAL Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : La rage est une maladie virale mortelle, causant entre 59 000 et 70 000 décès humains dans le monde chaque année. Elle est principalement transmise à l'homme par les morsures de chiens infectés. Depuis plusieurs décennies, de nombreuses mesures de lutte basées essentiellement sur la réduction de la population canine ont été mises en œuvre au Sénégal. Néanmoins, la rage y est toujours endémique. Par ailleurs, des données empiriques montrent que le contrôle de la rage passe par la vaccination d’au moins 70% de la population canine. Par conséquent, la connaissance de la taille de la population de chien est nécessaire pour planifier et atteindre cet objectif. La présente étude a été conduite pour décrire l’écologie canine et les connaissances, attitudes et pratiques des ménages. Elle a consisté à une collecte de données avec l’application mobile WVS, auprès des ménages et une observation directe des chiens errants dans les rues, au cours d’une enquête transversale dans le département de Mbour, du 04 octobre au 04 novembre 2019. Les résultats relatifs à l’estimation de la taille et la distribution de la population canine montrent que, les chiens dans le département de Mbour, ont été estimés à 155 920 dont 22,5% soit 35 099 chiens étaient errants (sans propriétaires). En outre, 58,9% de cette population se trouve en milieu urbain. La majorité des chiens errants recensés soit 43,4% de ces chiens avaient une bonne note d’état corporel et plus de la moitié (54,3%) était en bonne santé physique. Les mâles étaient numériquement plus importants que les femelles dans la population canine errante. Nous avons pu également déterminer que 88, 5% des 131 ménages interrogés possédaient au moins un chien et le ratio chien domestique à propriétaire/Homme était de 1/7. En plus, 56% de la population canine domestique à propriétaire était en libre circulation, particulièrement en milieu rural où cette proportion de semi-errance atteignait 66%. Ce qui confirme la présence du risque rabique dans le département de Mbour. Quant à l’enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques des ménages sur la rage, 88,8% des participants avaient entendu parler de la rage. En revanche, plus des 2/3 avaient des connaissances erronées et insuffisantes sur la source de contamination et les signes de la rage. La conduite à tenir pour le chien, si ce dernier mordait quelqu’un n’était pas connue par 58% des enquêtés ; tandis que le tiers des personnes interrogées préconisaient d’abattre les animaux suspects de rage. De même, pour la conduite à tenir pour la victime de morsure, seulement 1/4 des répondants conseillaient le lavage de la plaie à l’eau et au savon, à la suite d’une agression par un chien avant de se rendre à l’hôpital. Tout ceci traduit un faible niveau d’information et de sensibilisation sur la rage, malgré sa gravité. Le taux de couverture vaccinale des chiens détenus par les ménages est de 19%. Les raisons de la non-vaccination de leurs chiens étaient, pour la plupart des propriétaires par simple ignorance (60%), la négligence pour 30%, et le manque de moyens financiers pour les 10% restants. Au regard de ces résultats, une réorientation de la stratégie de lutte contre la rage s’avère impérative au Sénégal. Par conséquent, des recommandations à l’endroit des différents acteurs du pays ont été formulées. Principalement, pour les populations d’adopter le lavage des plaies de morsures, de consulter aussitôt les services de santé en cas d’agression par un carnivore, que celui-ci soit vacciné ou non et de ne pas abattre les chiens mordeurs ou à défaut d’amener leurs cadavres au niveau du service vétérinaire de la zone pour le diagnostic. Nous avons également préconisé aux services vétérinaires d’instituer des campagnes de vaccination de masse périodiques des chiens errants et possédés ainsi que le contrôle de la population canine errante par la stérilisation des chiennes. PRESIDENT DE JURY : Mme DIOP NYAFOUNA Sylvie Audrey, Pr à l’UFR Santé, Université de Thiès DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. AYIH-AKAKPO Ayayi Justin, Pr à l’EISMV de Dakar CO-ENCADRANT : M. OYETOLA Wilfried Délé, Attaché Temporaire d’Enseignement et de recherche à l’EISMV de Dakar/Mme Jordana L. Burdon Bailey, Administratrice du projet Mission Rabies DATE DE SOUTENANCE : 17/03/2021 PAYS : Sénégal Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=4692 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T1514 TD21-18 Thèse Bibliothèque (SID) Thèses Vétérinaires Disponible Documents numériques

TD21-18.pdfAdobe Acrobat PDFDominantes pathologiques des carnivores domestiques prises en charge dans un cabinet vétérinaire à Casablanca au Maroc / Benchekroun, Mehdi (2021)

PermalinkDominantes pathologiques des équidés prises en charge dans le département de Koumpetoum au Sénégal / Djiby Ka (2021)

PermalinkDominantes pathologiques des équidés prises en charge dans le département de Nioro, région de Kaolack (Sénégal) / Mamadou Fall (2021)

PermalinkEffet de coxosan oral ND sur les coccidioses chez le poulet de chair à Dakar (Sénégal) / N'cho Panèle Asseu (2021)

PermalinkEffet de l'incorporation du tourteau de graines de baobab africain (adansoniadigitata,I.) dans l'aliment, du démarrage à la croissance, sur les performances zootechnico-économiques chez les poulets de chair dans la région de Dakar / Cherif Ali Abdelkarim (2021)

PermalinkEffet de la présentation de l'aliment sur les performance de croissance au poulet de chair au Sénégal / Sagar Ndiaye (2021)

PermalinkEffet de la substitution totale de la farine de poisson par la farine de tenebriomolitor dans l'alimentation sur les performances du poulet de chair au Sénégal / Enguerrand René Pierre Gelinet (2021)

PermalinkEffet du "type de granulation de l'aliment de démarrage vermicelle" sur les performances zootechniques des poulets de chair élevés au Sénégal / Mouhamadou Moustapha Gueye (2021)

PermalinkEffets de l’aliments pré-starter sur les performances zootechniques du poulet de chair au Sénégal / Ibrahim Ali Abdelmadjid (2021)

Permalink