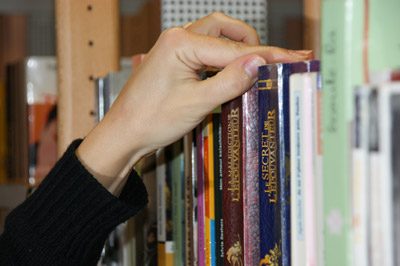EISMV DE DAKAR: Service d'Information et de Documentation
Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (26)


 Interroger des sources externes
Interroger des sources externesEtude des coûts de production du lait dans les systèmes d’exploitation laitière au Sénégal / Fatou Sarr (2011)

Titre : Etude des coûts de production du lait dans les systèmes d’exploitation laitière au Sénégal Type de document : texte imprimé Auteurs : Fatou Sarr, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2011 Importance : 74 p. Langues : Français (fre) Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2011 Mots-clés : LAIT PRODUCTION LAITIERE COMMERCIALISATION SENEGAL Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : Au Sénégal, la consommation de lait de la population a été estimée à 434 800 000 litres d’équivalent lait en 2008. Cette même année, les importations en produits laitiers ont atteint 202 396 000 équivalents litres de lait (DIREL). Soit prés de 46 % de la consommation nationale issue des importations de lait. Cette situation s’explique d’une part par des modes de production majoritairement extensif ou semi-intensif. D’autre part, l’organisation de la filière à tous les niveaux (production, collecte, transformation et distribution) n’est pas maitrisée. La présente étude a porté sur la production plus particulièrement sur les coûts de production du lait dans les différents systèmes de productions existants au Sénégal. Elle a été menée auprès de 103 producteurs répartis dans les quatre zones agro-écologiques du pays. Elle a montré que l’alimentation reste le principal poste de dépense avec 30 à 70% des charges de production. Puis arrivent les autres charges comme les amortissements (bâtiments, étables, et matériels) qui nécessitent de gros investissements de départ dans les fermes intensives. La main d’œuvre si elle existe est aussi un poste de dépense très important et peut atteindre 30% des charges dans les fermes. Ces variations des coûts de production sont fonction des systèmes de production mise en place. Les coûts les plus faibles observés dans le système extensif cachent une faible capacité d’augmentation de la production. La saisonnalité de la production est un autre facteur limitant de la production dans ce système. Alors que pour le système intensif les coûts élevés se justifient par une intensification du système d’alimentation ainsi que des investissements énormes de départ. Dans la zone des Niayes, le coût de production du lait des fermes intensives varie de 284 à 410 F CFA. Alors que pour les fermes extensives, le coût de production du lait est de 105 F CFA. Le prix de revient quant à lui varie de 258 à 338 FCFA pour les fermes intensives alors qu’il est de -73 F CFA pour les fermes extensives. Ce signe négatif montre que la vente des animaux couvre toutes les charges de production des exploitations extensives. Au nord (Richard Toll), les coûts de production du lait varient de 98 à 114 F CFA. Au sud (Kolda), le coût de production du lait est de 110 FCFA. Enfin dans le bassin arachidier (Kaolack), les exploitations extensives ont un coût de production de 155 F CFA. Dans les exploitations en stabulation le coût de production du lait varie de 268 à 390 F CFA, pour un prix de revient qui varie de 107 à 230 F CFA. Dans chacune des zones étudiées, l’évolution des méthodes de production est envisageable ; ce qui permettra d’assurer aujourd’hui une production laitière plus soutenue. Il faut l’encadrement des éleveurs traditionnels (système extensif), ce qui permettra, là où les conditions agro-écologiques et sanitaires le permettent, d’avoir des volumes conséquents sans investissement massif. L’amélioration de la production laitière doit être aussi soutenue par la connexion avec un système de collecte et de transformation du lait. Il reste à accomplir un travail important sur plusieurs années, d’encadrement et de suivi de tous les acteurs pour que le lait importé soit peu à peu remplacé par le lait local. PRESIDENT DE JURY : M. NDIAYE Mouhamadou, Pr à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-Stomatologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. PUEJEAN Bruno, Assistant Technique àl’E.I.S.M.V. de Dakar RAPPORTEUR : M. MISSOHOU Ayao, Pr à l’E.I.S.M.V. de Dakar MEMBRE : M. ASSANE Moussa, Pr titulaire à l’EISMV de Dakar /M. DIOP Papa El Hassan, Pr à l’E.I.S.M.V. de Dakar DATE DE SOUTENANCE : 30/04/2011 PAYS : Sénégal Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1691 Etude des coûts de production du lait dans les systèmes d’exploitation laitière au Sénégal [texte imprimé] / Fatou Sarr, Auteur . - Dakar : EISMV, 2011 . - 74 p.
Langues : Français (fre)
Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2011 Mots-clés : LAIT PRODUCTION LAITIERE COMMERCIALISATION SENEGAL Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : Au Sénégal, la consommation de lait de la population a été estimée à 434 800 000 litres d’équivalent lait en 2008. Cette même année, les importations en produits laitiers ont atteint 202 396 000 équivalents litres de lait (DIREL). Soit prés de 46 % de la consommation nationale issue des importations de lait. Cette situation s’explique d’une part par des modes de production majoritairement extensif ou semi-intensif. D’autre part, l’organisation de la filière à tous les niveaux (production, collecte, transformation et distribution) n’est pas maitrisée. La présente étude a porté sur la production plus particulièrement sur les coûts de production du lait dans les différents systèmes de productions existants au Sénégal. Elle a été menée auprès de 103 producteurs répartis dans les quatre zones agro-écologiques du pays. Elle a montré que l’alimentation reste le principal poste de dépense avec 30 à 70% des charges de production. Puis arrivent les autres charges comme les amortissements (bâtiments, étables, et matériels) qui nécessitent de gros investissements de départ dans les fermes intensives. La main d’œuvre si elle existe est aussi un poste de dépense très important et peut atteindre 30% des charges dans les fermes. Ces variations des coûts de production sont fonction des systèmes de production mise en place. Les coûts les plus faibles observés dans le système extensif cachent une faible capacité d’augmentation de la production. La saisonnalité de la production est un autre facteur limitant de la production dans ce système. Alors que pour le système intensif les coûts élevés se justifient par une intensification du système d’alimentation ainsi que des investissements énormes de départ. Dans la zone des Niayes, le coût de production du lait des fermes intensives varie de 284 à 410 F CFA. Alors que pour les fermes extensives, le coût de production du lait est de 105 F CFA. Le prix de revient quant à lui varie de 258 à 338 FCFA pour les fermes intensives alors qu’il est de -73 F CFA pour les fermes extensives. Ce signe négatif montre que la vente des animaux couvre toutes les charges de production des exploitations extensives. Au nord (Richard Toll), les coûts de production du lait varient de 98 à 114 F CFA. Au sud (Kolda), le coût de production du lait est de 110 FCFA. Enfin dans le bassin arachidier (Kaolack), les exploitations extensives ont un coût de production de 155 F CFA. Dans les exploitations en stabulation le coût de production du lait varie de 268 à 390 F CFA, pour un prix de revient qui varie de 107 à 230 F CFA. Dans chacune des zones étudiées, l’évolution des méthodes de production est envisageable ; ce qui permettra d’assurer aujourd’hui une production laitière plus soutenue. Il faut l’encadrement des éleveurs traditionnels (système extensif), ce qui permettra, là où les conditions agro-écologiques et sanitaires le permettent, d’avoir des volumes conséquents sans investissement massif. L’amélioration de la production laitière doit être aussi soutenue par la connexion avec un système de collecte et de transformation du lait. Il reste à accomplir un travail important sur plusieurs années, d’encadrement et de suivi de tous les acteurs pour que le lait importé soit peu à peu remplacé par le lait local. PRESIDENT DE JURY : M. NDIAYE Mouhamadou, Pr à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-Stomatologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. PUEJEAN Bruno, Assistant Technique àl’E.I.S.M.V. de Dakar RAPPORTEUR : M. MISSOHOU Ayao, Pr à l’E.I.S.M.V. de Dakar MEMBRE : M. ASSANE Moussa, Pr titulaire à l’EISMV de Dakar /M. DIOP Papa El Hassan, Pr à l’E.I.S.M.V. de Dakar DATE DE SOUTENANCE : 30/04/2011 PAYS : Sénégal Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1691 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T1123 TD11-3 Thèse Bibliothèque (SID) Thèses Vétérinaires Disponible Documents numériques

TD11-3Adobe Acrobat PDFEtude diagnostique des conditions de préparation et d’inspection des viandes de boucherie aux abattoirs du District d’Abidjan / Karamoko Abdoul Diarrassouba (2011)

Titre : Etude diagnostique des conditions de préparation et d’inspection des viandes de boucherie aux abattoirs du District d’Abidjan Type de document : texte imprimé Auteurs : Karamoko Abdoul Diarrassouba, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2011 Importance : 165 p. Langues : Français (fre) Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2011 Mots-clés : INSPECTION DES VIANDES CONTROLE DE QUALITE VIANDE HYGIENE DE LA VIANDE ABATTOIR COTE D’IVOIRE Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : Lieu de préparation des animaux de boucherie, l’abattoir joue un rôle prépondérant au regard de la santé publique par l’inspection et la certification de la qualité sanitaire des viandes qui en sont issues. L’étude diagnostique des conditions de préparation et d’inspection des viandes de boucherie aux abattoirs du district d’Abidjan a permis de révéler que 265.081 bovins et 141.784 petits ruminants ont été abattus de 2007 à 2009, ce qui représente environs 40.291.625,3 kg de viande. Malgré cet important niveau d’activité, les locaux de ces abattoirs sont vétustes et les conditions de préparation des viandes y sont très peu hygiéniques. La présence des services vétérinaires permet néanmoins de prévenir les, risques liés à la mise sur le marché de produits potentiellement dangereux pour les populations abidjanaises. Sur les trois années d’étude, au total 67.569 organes et 254 carcasses ont été saisis et détruits. Les motifs varient suivants les espèces mais la tuberculose et la distomatose sont les plus souvent mis en cause ; les organes les plus saisis sont bien évidemment les poumons et les foies. PRESIDENT DE JURY : M. CISSE Moussa Fafa, Pr à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-Stomatologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. SEYDI Malang, Pr à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : M. SEYDI Malang, Pr à l’EISMV de Dakar MEMBRE : Mme. ALEMBEDJI Rianatou B, Pr à l’EISMV de Dakar /M. KABORET Yalacé Yamba, Pr à l’EISMV de Dakar CO-DIRECTEUR : Dr KALLO Vessaly, Sous-directeur de l’Hygiène Alimentaire aux abattoirs du district d’Abidjan DATE DE SOUTENANCE : 23/07/2011 PAYS : Côte d’Ivoire Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1706 Etude diagnostique des conditions de préparation et d’inspection des viandes de boucherie aux abattoirs du District d’Abidjan [texte imprimé] / Karamoko Abdoul Diarrassouba, Auteur . - Dakar : EISMV, 2011 . - 165 p.
Langues : Français (fre)
Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2011 Mots-clés : INSPECTION DES VIANDES CONTROLE DE QUALITE VIANDE HYGIENE DE LA VIANDE ABATTOIR COTE D’IVOIRE Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : Lieu de préparation des animaux de boucherie, l’abattoir joue un rôle prépondérant au regard de la santé publique par l’inspection et la certification de la qualité sanitaire des viandes qui en sont issues. L’étude diagnostique des conditions de préparation et d’inspection des viandes de boucherie aux abattoirs du district d’Abidjan a permis de révéler que 265.081 bovins et 141.784 petits ruminants ont été abattus de 2007 à 2009, ce qui représente environs 40.291.625,3 kg de viande. Malgré cet important niveau d’activité, les locaux de ces abattoirs sont vétustes et les conditions de préparation des viandes y sont très peu hygiéniques. La présence des services vétérinaires permet néanmoins de prévenir les, risques liés à la mise sur le marché de produits potentiellement dangereux pour les populations abidjanaises. Sur les trois années d’étude, au total 67.569 organes et 254 carcasses ont été saisis et détruits. Les motifs varient suivants les espèces mais la tuberculose et la distomatose sont les plus souvent mis en cause ; les organes les plus saisis sont bien évidemment les poumons et les foies. PRESIDENT DE JURY : M. CISSE Moussa Fafa, Pr à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-Stomatologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. SEYDI Malang, Pr à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : M. SEYDI Malang, Pr à l’EISMV de Dakar MEMBRE : Mme. ALEMBEDJI Rianatou B, Pr à l’EISMV de Dakar /M. KABORET Yalacé Yamba, Pr à l’EISMV de Dakar CO-DIRECTEUR : Dr KALLO Vessaly, Sous-directeur de l’Hygiène Alimentaire aux abattoirs du district d’Abidjan DATE DE SOUTENANCE : 23/07/2011 PAYS : Côte d’Ivoire Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1706 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T1136 TD11-16 Thèse Bibliothèque (SID) Thèses Vétérinaires Disponible Documents numériques

TD11-16Adobe Acrobat PDFEvaluation de l’efficacité de la gestion de la reproduction dans la ferme laitière Past-Agri au Sénégal / Sagbo Damien Michoagan (2011)

Titre : Evaluation de l’efficacité de la gestion de la reproduction dans la ferme laitière Past-Agri au Sénégal Type de document : texte imprimé Auteurs : Sagbo Damien Michoagan, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2011 Importance : 113 p. Langues : Français (fre) Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2011 Mots-clés : BOVIN REPRODUCTION ALIMENTATION DES ANIMAUX BOVIN LAITIER PRODUCTION LAITIERE SENEGAL Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : La demande croissante en lait et produit laitier rend le Sénégal dépendant des importations et l’incite à promouvoir l’augmentation de la production locale. Cependant, la gestion de la reproduction reste un outil incontournable pour une meilleure rentabilité de la production. L’objectif de ce travail est d’évaluer l’efficacité de la gestion des la reproduction dans la ferme laitière PAST-AGRI de 2005 à 2010. Cette évaluation a portée sur 211 vaches Holstein et normande. Outre, les paramètres de reproduction, la gestion sanitaire et l’efficacité de la ration distribuée ont été évalué. L’analyse des résultats montrent que les races Holstein sont plus précoces que les races Normande. Cependant, les intervalles vêlage-première insémination, intervalle vêlageinsémination fécondante et intervalles vêlage-vêlage sont plus long chez les races Holstein que chez les races Normande. En outre une amélioration de la fertilité des vaches a été constatée les années 2005 et 2010. Sur le plan sanitaire, les fréquences des pathologies majeures constatées sont supérieures à la norme recommandée. La conduite alimentaire de la ferme est satisfaisante. Nos recommandations vont à l’endroit de toutes les fermes laitières en particulier la ferme PAST-AGRI, de faire de la gestion de reproduction une priorité pour une meilleure rentabilité afin de contribuer à l’atteinte des objectifs d’autosuffisance en lait et en viande au Sénégal. PRESIDENT DE JURY : M. SAMB Abdoulaye, Pr à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-Stomatologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Dr. WALADJO Alain Richi KAMGA, Maître Assistant à l’E.I.S.M.V. de Dakar RAPPORTEUR : M. BAKOU Serge Niangoran, Maître de Conférences agrégé à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. PANGUI Louis Joseph, Pr à l’EISMV de Dakar /M. ASSANE Moussa, Pr titulaire à l’EISMV de Dakar CO-DIRECTEUR : Dr NDOYE Ndiagne, Dr Vétérinaire PAST-AGRI DATE DE SOUTENANCE : 29/07/2011 PAYS : Bénin Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1712 Evaluation de l’efficacité de la gestion de la reproduction dans la ferme laitière Past-Agri au Sénégal [texte imprimé] / Sagbo Damien Michoagan, Auteur . - Dakar : EISMV, 2011 . - 113 p.
Langues : Français (fre)
Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2011 Mots-clés : BOVIN REPRODUCTION ALIMENTATION DES ANIMAUX BOVIN LAITIER PRODUCTION LAITIERE SENEGAL Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : La demande croissante en lait et produit laitier rend le Sénégal dépendant des importations et l’incite à promouvoir l’augmentation de la production locale. Cependant, la gestion de la reproduction reste un outil incontournable pour une meilleure rentabilité de la production. L’objectif de ce travail est d’évaluer l’efficacité de la gestion des la reproduction dans la ferme laitière PAST-AGRI de 2005 à 2010. Cette évaluation a portée sur 211 vaches Holstein et normande. Outre, les paramètres de reproduction, la gestion sanitaire et l’efficacité de la ration distribuée ont été évalué. L’analyse des résultats montrent que les races Holstein sont plus précoces que les races Normande. Cependant, les intervalles vêlage-première insémination, intervalle vêlageinsémination fécondante et intervalles vêlage-vêlage sont plus long chez les races Holstein que chez les races Normande. En outre une amélioration de la fertilité des vaches a été constatée les années 2005 et 2010. Sur le plan sanitaire, les fréquences des pathologies majeures constatées sont supérieures à la norme recommandée. La conduite alimentaire de la ferme est satisfaisante. Nos recommandations vont à l’endroit de toutes les fermes laitières en particulier la ferme PAST-AGRI, de faire de la gestion de reproduction une priorité pour une meilleure rentabilité afin de contribuer à l’atteinte des objectifs d’autosuffisance en lait et en viande au Sénégal. PRESIDENT DE JURY : M. SAMB Abdoulaye, Pr à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-Stomatologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Dr. WALADJO Alain Richi KAMGA, Maître Assistant à l’E.I.S.M.V. de Dakar RAPPORTEUR : M. BAKOU Serge Niangoran, Maître de Conférences agrégé à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. PANGUI Louis Joseph, Pr à l’EISMV de Dakar /M. ASSANE Moussa, Pr titulaire à l’EISMV de Dakar CO-DIRECTEUR : Dr NDOYE Ndiagne, Dr Vétérinaire PAST-AGRI DATE DE SOUTENANCE : 29/07/2011 PAYS : Bénin Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1712 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T1142 TD11-22 Thèse Bibliothèque (SID) Thèses Vétérinaires Disponible Documents numériques

TD11-22Adobe Acrobat PDFIdentification des facteurs de risque et estimation de la séroprévalence de la peste porcine africaine dans la région de Thiès / Mathias Constantin Yandia (2011)

Titre : Identification des facteurs de risque et estimation de la séroprévalence de la peste porcine africaine dans la région de Thiès Type de document : texte imprimé Auteurs : Mathias Constantin Yandia, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2011 Importance : 104 p. Langues : Français (fre) Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2011 Mots-clés : PESTE PORCINE AFRICAINE PORC MALADIE DES ANIMAUX SENEGAL Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : La demande croissante en protéines animales interpelle les pays du tiers monde, en particulier le Sénégal à s’orienter vers l’élevage des animaux à cycle court notamment l’élevage du porc. L’élevage du porc au Sénégal est cependant confronté à une contrainte majeure représentée par des pathologies à l’instar de la PPA qui cause des pertes allant jusqu’à 100 % du cheptel. Cette étude a permis de réaliser une enquête de type transversale et des prélèvements sanguins dans la population porcine de Thiès. Au total, 92 élevages ont été visités, les résultats obtenus ont permis de décrire les caractéristiques de l’élevage porcin et de déterminer la séroprévalence de la maladie. Les bâtiments semi-modernes en moyenne représentent 65,2% ; les bâtiments traditionnels représentent 19,56%. La race locale est la plus exploitée avec un pourcentage moyen de 92,25 %. Elle est beaucoup plus présente à Thiès centre avec une proportion de 98 % contre 85 % à Diayane. En moyenne, 52,17% d’éleveurs soit 48 élevages déclarent avoir eu des cas de PPA, et observé des symptômes caractéristiques de cette pathologie. Les cas de suspicion ont une proportion élevée à Diayane qu’à Thiès avec 57,5% contre 47%. L’analyse sérologique par la technique ELISA indirect de 204 prélèvements de sérums de porcs issus des deux localités Thiès centre et Diayane nous a permis de trouver des résultats suivants : Sur les 204 sérums, trois (03) seulement sont positifs et 201 sont négatifs soit une séroprévalence globale de 1,47 %. C’est la localité de Diayane qui est affectée avec 03 positifs. soit une prévalence de 2,97%. Ceci confirme la suspicion des cas de PPA par 57,5 % d’éleveurs. Les élevages sont bel et bien en contact avec le virus. Il ressort de cette étude que la conduite d’élevage constituerait un des facteurs favorisant l’introduction de la PPA dans les élevages, de sa dissémination et de sa persistance. Toutefois, ces résultats doivent être renforcés par une étude virologique. PRESIDENT DE JURY : M. BASSENE Emmanuel, Pr à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto – Stomatologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme ALAMBEDJI Rianatou BADA, Pr à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : Mme ALAMBEDJI Rianatou BADA, Pr à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. MISSOHOU Ayao, Pr à l’EISMV de Dakar /M. KANE Yaghouba, Maître de Conférences Agrégé à l’E.I.S.M.V de Dakar- Sénégal CO-DIRECTEUR : Dr THIONGANE Yaya, Directeur du LNERV à l ISRA DATE DE SOUTENANCE : 29/07/2011 PAYS : Centrafrique Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1713 Identification des facteurs de risque et estimation de la séroprévalence de la peste porcine africaine dans la région de Thiès [texte imprimé] / Mathias Constantin Yandia, Auteur . - Dakar : EISMV, 2011 . - 104 p.
Langues : Français (fre)
Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2011 Mots-clés : PESTE PORCINE AFRICAINE PORC MALADIE DES ANIMAUX SENEGAL Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : La demande croissante en protéines animales interpelle les pays du tiers monde, en particulier le Sénégal à s’orienter vers l’élevage des animaux à cycle court notamment l’élevage du porc. L’élevage du porc au Sénégal est cependant confronté à une contrainte majeure représentée par des pathologies à l’instar de la PPA qui cause des pertes allant jusqu’à 100 % du cheptel. Cette étude a permis de réaliser une enquête de type transversale et des prélèvements sanguins dans la population porcine de Thiès. Au total, 92 élevages ont été visités, les résultats obtenus ont permis de décrire les caractéristiques de l’élevage porcin et de déterminer la séroprévalence de la maladie. Les bâtiments semi-modernes en moyenne représentent 65,2% ; les bâtiments traditionnels représentent 19,56%. La race locale est la plus exploitée avec un pourcentage moyen de 92,25 %. Elle est beaucoup plus présente à Thiès centre avec une proportion de 98 % contre 85 % à Diayane. En moyenne, 52,17% d’éleveurs soit 48 élevages déclarent avoir eu des cas de PPA, et observé des symptômes caractéristiques de cette pathologie. Les cas de suspicion ont une proportion élevée à Diayane qu’à Thiès avec 57,5% contre 47%. L’analyse sérologique par la technique ELISA indirect de 204 prélèvements de sérums de porcs issus des deux localités Thiès centre et Diayane nous a permis de trouver des résultats suivants : Sur les 204 sérums, trois (03) seulement sont positifs et 201 sont négatifs soit une séroprévalence globale de 1,47 %. C’est la localité de Diayane qui est affectée avec 03 positifs. soit une prévalence de 2,97%. Ceci confirme la suspicion des cas de PPA par 57,5 % d’éleveurs. Les élevages sont bel et bien en contact avec le virus. Il ressort de cette étude que la conduite d’élevage constituerait un des facteurs favorisant l’introduction de la PPA dans les élevages, de sa dissémination et de sa persistance. Toutefois, ces résultats doivent être renforcés par une étude virologique. PRESIDENT DE JURY : M. BASSENE Emmanuel, Pr à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto – Stomatologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme ALAMBEDJI Rianatou BADA, Pr à l’EISMV de Dakar RAPPORTEUR : Mme ALAMBEDJI Rianatou BADA, Pr à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. MISSOHOU Ayao, Pr à l’EISMV de Dakar /M. KANE Yaghouba, Maître de Conférences Agrégé à l’E.I.S.M.V de Dakar- Sénégal CO-DIRECTEUR : Dr THIONGANE Yaya, Directeur du LNERV à l ISRA DATE DE SOUTENANCE : 29/07/2011 PAYS : Centrafrique Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1713 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T1143 TD11-23 Thèse Bibliothèque (SID) Thèses Vétérinaires Disponible Documents numériques

TD11-23Adobe Acrobat PDFInfluence de la nature des litières utilisées en Région périurbaine de Dakar (Sénégal) sur les performances de croissance du poulet de chair / Adama Faye (2011)

Titre : Influence de la nature des litières utilisées en Région périurbaine de Dakar (Sénégal) sur les performances de croissance du poulet de chair Type de document : texte imprimé Auteurs : Adama Faye, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2011 Importance : 92 p. Langues : Français (fre) Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2011 Mots-clés : LITIERE POUR ANIMAUX POULET POULET DE CHAIR SENEGAL Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : Ce travail qui vise à étudier l’influence de la nature des litières utilisées en région périurbaines de Dakar, sur les performances de croissance du poulet de chair s’est effectué en deux phases. Une enquéte sur le terrain portant sur vingt-cinq élevages et une étude expérimentale qui s’est déroulée du 28 janvier au 12 Mars 2011 au sein de l’EISMV de Dakar. Elle s’est terminée par l’analyse chimique et microbiologique de trois types de litières prélevées en fin de bande. Trois types de litières à savoir le copeau de bois, la coque d’arachide et la paille de riz étaient utilisés. Ainsi, l’essai a porté sur 195 poulets cobb500 âgés de 11 jours et répartis en trois lots de 65 sujets. Les lots A, B, et C sont respectivement composés de poulets élevés sur des litières à base de copeau de bois, de la coque d’arachide et de la paille de riz. Les résultats obtenus montrent que : ¾ -La consommation alimentaire individuelle des différents lots n’est pas significativement différente (p > 0) . ¾ - les poids vif respectifs à 44 jours par poulets ont été de 2998,62 g pour le lot A, 2800,30 g pour le lot B et 2671,77 g pour LE LOT C. Le GMQ a évolué dans le même sens que le poids vif avec respectivement un GMQ cumulé de 406,34 g pour le lot A, 378,49 g pour le lot B et 358,30 g pour le lot C. ¾ - le meilleur rendement carcasse est donné par le lot B, il est de 85,19% contre 84,89% pour le lot A et 84,45% pour le lot C. ¾ Le taux de mortalité a été plus élevé chez le lot C avec 12,31% . ¾ Le copeau de bois a dégagé peu d’azotes total et ammoniacal avec une forte contamination par les ASR et faible par les FMAT. Contrairement à la coque d’arachide et la palle de riz qui présente les données inverses. ¾ La nature de litière a un impact sur la rentabilité économique. Le lot A est plus rentable avec un gain de 1624,75 F par carcasse de poulet, suivi du lot B 1380,25 F et enfin le lot C 1178,81 F par poulet. En résumé, la nature de la litière a une influence sur les performances de croissances qui déterminent la rentabilité chez le poulet de chair PRESIDENT DE JURY : M. DIOP Bernard Marcel, Pr à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-Stomatologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. ASSANE Moussa, Pr à l’E.I.S.M.V de Dakar. RAPPORTEUR : M. ASSANE Moussa, Pr à l’E.I.S.M.V de Dakar. MEMBRE : M. SAWADOGO Germain Jérôme, Pr à l’EISMV de Dakar /M. BAKOU Serge Niangoran, Pr à l’EISMV de Dakar CO-DIRECTEUR : Dr.SENE Malick, Dir Qualité et Développement. NMA-Sanders DATE DE SOUTENANCE : 23/07/2011 PAYS : Sénégal Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1699 Influence de la nature des litières utilisées en Région périurbaine de Dakar (Sénégal) sur les performances de croissance du poulet de chair [texte imprimé] / Adama Faye, Auteur . - Dakar : EISMV, 2011 . - 92 p.
Langues : Français (fre)
Catégories : THESES DE MEDECINE VETERINAIRE:2011 Mots-clés : LITIERE POUR ANIMAUX POULET POULET DE CHAIR SENEGAL Index. décimale : TD-THESE DE DOCTORAT Résumé : Ce travail qui vise à étudier l’influence de la nature des litières utilisées en région périurbaines de Dakar, sur les performances de croissance du poulet de chair s’est effectué en deux phases. Une enquéte sur le terrain portant sur vingt-cinq élevages et une étude expérimentale qui s’est déroulée du 28 janvier au 12 Mars 2011 au sein de l’EISMV de Dakar. Elle s’est terminée par l’analyse chimique et microbiologique de trois types de litières prélevées en fin de bande. Trois types de litières à savoir le copeau de bois, la coque d’arachide et la paille de riz étaient utilisés. Ainsi, l’essai a porté sur 195 poulets cobb500 âgés de 11 jours et répartis en trois lots de 65 sujets. Les lots A, B, et C sont respectivement composés de poulets élevés sur des litières à base de copeau de bois, de la coque d’arachide et de la paille de riz. Les résultats obtenus montrent que : ¾ -La consommation alimentaire individuelle des différents lots n’est pas significativement différente (p > 0) . ¾ - les poids vif respectifs à 44 jours par poulets ont été de 2998,62 g pour le lot A, 2800,30 g pour le lot B et 2671,77 g pour LE LOT C. Le GMQ a évolué dans le même sens que le poids vif avec respectivement un GMQ cumulé de 406,34 g pour le lot A, 378,49 g pour le lot B et 358,30 g pour le lot C. ¾ - le meilleur rendement carcasse est donné par le lot B, il est de 85,19% contre 84,89% pour le lot A et 84,45% pour le lot C. ¾ Le taux de mortalité a été plus élevé chez le lot C avec 12,31% . ¾ Le copeau de bois a dégagé peu d’azotes total et ammoniacal avec une forte contamination par les ASR et faible par les FMAT. Contrairement à la coque d’arachide et la palle de riz qui présente les données inverses. ¾ La nature de litière a un impact sur la rentabilité économique. Le lot A est plus rentable avec un gain de 1624,75 F par carcasse de poulet, suivi du lot B 1380,25 F et enfin le lot C 1178,81 F par poulet. En résumé, la nature de la litière a une influence sur les performances de croissances qui déterminent la rentabilité chez le poulet de chair PRESIDENT DE JURY : M. DIOP Bernard Marcel, Pr à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-Stomatologie de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. ASSANE Moussa, Pr à l’E.I.S.M.V de Dakar. RAPPORTEUR : M. ASSANE Moussa, Pr à l’E.I.S.M.V de Dakar. MEMBRE : M. SAWADOGO Germain Jérôme, Pr à l’EISMV de Dakar /M. BAKOU Serge Niangoran, Pr à l’EISMV de Dakar CO-DIRECTEUR : Dr.SENE Malick, Dir Qualité et Développement. NMA-Sanders DATE DE SOUTENANCE : 23/07/2011 PAYS : Sénégal Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1699 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T1130 TD11-10 Thèse Bibliothèque (SID) Thèses Vétérinaires Disponible Documents numériques

TD11-10Adobe Acrobat PDFInfluence de la qualité de l’eau de boisson distribuée dans les élevages avicoles de la région périurbaine de Dakar sur l’efficacité de la vaccination contre la maladie de Gumboro chez le poulet de chair. / Claire Brice Valery Senin (2011)

PermalinkPathologie comparée chez le lion d’Afrique (Panthera Leo) et le tigre (Panthera tigris) / Mbaye Estelle Kruger (2011)

PermalinkPerception du bien être animal par les acteurs de la communauté de l’EISMV de Dakar / Koffi Jean François Adje (2011)
PermalinkPermalinkProjet pilote de production d’œufs de consommation à petite échelle comme outil de réduction de la pauvreté au Sénégal / Ziekpoho Coulibaly (2011)

PermalinkPermalink