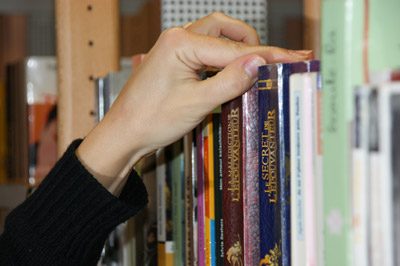EISMV DE DAKAR: Service d'Information et de Documentation
Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (14)


 Interroger des sources externes
Interroger des sources externes
Titre : Conditions de production et qualité du lait cru produit au Burundi Type de document : texte imprimé Auteurs : Gérard Niyonsaba, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2023 Importance : 25p. Langues : Français (fre) Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2023 Mots-clés : LAIT CRU PRODUCTION QUALITE BURUNDI Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : Au Burundi, malgré l’importance socio-économique et l’impact sanitaire du lait et produits laitiers, peu de chercheurs s’intéressent à cette filière. Le peu d’études concernant la filière sont en rapport avec l’augmentation de la productivité des vaches laitières. Or, parmi, toutes les actions qui favorisent le développement du secteur laitier, l’amélioration de la qualité des produits laitiers constitue une valeur ajoutée. C’est dans ce contexte que nous avons entrepris cette étude dans le but de connaître les conditions de production et la qualité du lait cru produit dans les communes des provinces Kayanza, Ngozi et Bubanza et au point de réception de l’industrie Modern Dairy Burundi. A cet effet, nous avons mené des enquêtes au sein des 40 exploitations laitières et réalisé des mesures physico-chimiques sur 84 échantillons de lait cru.
L’analyse des résultats a révélé une hygiène satisfaisante dans les 40 exploitations suivies. La teneur moyenne en en matière grasse était de 46 ± 4g/l, le pH moyen de 6,7±0,07, la densité : 1,031±0,006 et l’acidité Dornic de 16,63
±0,92oD. En outre, des résidus d’antibiotiques ont été retrouvés dans 09 échantillons sur les 84 analysés et 4 échantillons sur 84 étaient positifs au test d’alcool.PRESIDENT DE JURY : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr titulaire à l’E.I.S.M.V de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme MUSABYEMARIYA Bellancille,Maître de conférences agrégé à l’E.I.S.M.V de Dakar MEMBRE : M. Germain Jérôme, Pr Honoraire de l’E.I.S.M.V de Dakar / M. Abdoulaye DIAWARA Spécialiste de la Sécurité sanitaire et de la Qualité des aliments (PhD) au MEPA, Sénégal CO-DIRECTEUR : M. IRIBAGIZA Albert, Enseignant-chercheur à l’Université du Burundi DATE DE SOUTENANCE : 04/08/2023 PAYS : BURUNDI Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5246 Conditions de production et qualité du lait cru produit au Burundi [texte imprimé] / Gérard Niyonsaba, Auteur . - Dakar : EISMV, 2023 . - 25p.
Langues : Français (fre)
Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2023 Mots-clés : LAIT CRU PRODUCTION QUALITE BURUNDI Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : Au Burundi, malgré l’importance socio-économique et l’impact sanitaire du lait et produits laitiers, peu de chercheurs s’intéressent à cette filière. Le peu d’études concernant la filière sont en rapport avec l’augmentation de la productivité des vaches laitières. Or, parmi, toutes les actions qui favorisent le développement du secteur laitier, l’amélioration de la qualité des produits laitiers constitue une valeur ajoutée. C’est dans ce contexte que nous avons entrepris cette étude dans le but de connaître les conditions de production et la qualité du lait cru produit dans les communes des provinces Kayanza, Ngozi et Bubanza et au point de réception de l’industrie Modern Dairy Burundi. A cet effet, nous avons mené des enquêtes au sein des 40 exploitations laitières et réalisé des mesures physico-chimiques sur 84 échantillons de lait cru.
L’analyse des résultats a révélé une hygiène satisfaisante dans les 40 exploitations suivies. La teneur moyenne en en matière grasse était de 46 ± 4g/l, le pH moyen de 6,7±0,07, la densité : 1,031±0,006 et l’acidité Dornic de 16,63
±0,92oD. En outre, des résidus d’antibiotiques ont été retrouvés dans 09 échantillons sur les 84 analysés et 4 échantillons sur 84 étaient positifs au test d’alcool.PRESIDENT DE JURY : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr titulaire à l’E.I.S.M.V de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme MUSABYEMARIYA Bellancille,Maître de conférences agrégé à l’E.I.S.M.V de Dakar MEMBRE : M. Germain Jérôme, Pr Honoraire de l’E.I.S.M.V de Dakar / M. Abdoulaye DIAWARA Spécialiste de la Sécurité sanitaire et de la Qualité des aliments (PhD) au MEPA, Sénégal CO-DIRECTEUR : M. IRIBAGIZA Albert, Enseignant-chercheur à l’Université du Burundi DATE DE SOUTENANCE : 04/08/2023 PAYS : BURUNDI Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5246 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité M385 MEM23-14 Mémoire Bibliothèque (SID) Mémoires de Master Disponible Documents numériques

MEM23-14Adobe Acrobat PDFConnaissances des risques liés à la gestion du fumier sur la santé publique dans les ménages de la région de Sikasso au Mali / Awa Sadio Yena (2023)

Titre : Connaissances des risques liés à la gestion du fumier sur la santé publique dans les ménages de la région de Sikasso au Mali Type de document : texte imprimé Auteurs : Awa Sadio Yena, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2023 Importance : 23p Langues : Français (fre) Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2023 Mots-clés : FUMIER SANTE PUBLIQUE SIKASSO MALI Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : L’élevage contribue à l’augmentation de la production des cultures vivrières et de rentes à travers la traction animale et la production de fumure. Malgré ces atouts, l’élevage peut avoir des impacts sanitaires et environnementaux négatifs liés notamment à la cohabitation entre l’animal et l’homme et à la mauvaise gestion des déchets tel que la fumure. En effet, les populations sont souvent exposées à des risques de santé à travers des pratiques comme la divagation des animaux, leur promiscuité avec les populations, leur entretien, le stockage et l’épandage du fumier. Que ce soit les parasites ou microbes, les mauvaises odeurs, la pollution de l’eau et des sols, la contribution à l’augmentation des gaz à effet de serre, la gestion du fumier au sein des ménages entraine de nombreuses nuisances.
La présente étude avait alors pour but de déterminer les pratiques de gestion du fumier au niveau des ménages et identifier les risques potentiels générés par les pratiques de gestion du fumier sur la santé les communautés qui détiennent ces animaux. A cet effet, une enquête descriptive a été menée au sein de 300 ménages dans deux cercles au Mali, à savoir celui de Sikasso et de Koutiala.
Les répondants au questionnaire étaient majoritairement des hommes (98,7%) analphabètes (54,3%). Parmi eux, 97,8% utilisaient un lieu de confinement pour la garde des animaux (petits ruminants et volaille). Ce sont les clôtures sans toit ou des attaches aux piquets qui ont le plus été rencontrées (50,8%). L’étude a permis de constater que certaines pratiques de gestion du fumier peuvent constituer des risques pour la santé publique et environnementale. Ce sont notamment : la garde des animaux au sein d’une clôture sans toit ou attachés à un piquet dans les concessions (50,8%), l’absence de plancher au sein des lieux de confinement (1,3%), le non ramassage du fumier des animaux en divagation (74,3%), l’utilisation des enfants (40,3%) et des femmes (33,3%) comme main d’œuvre pour le nettoyage du lieu de confinement et l’entretien des animaux, le stockage en tas du fumier (80,1%) sans couverture, ni plancher étanche favorisant les risques de pollutions environnementales (90,8%), le défaut d’utilisation des équipements de protection individuelle lors de la manipulation du fumier. Malgré ces pratiques, l’étude a également permis de s’apercevoir qu’un très faible constat de maladies qui selon les répondants pourraient être dues à la gestion du fumier a été fait.
À la lumière des résultats de cette étude et de la discussion relative à la thématique, des recommandations ont été formulées afin d’améliorer la gestion optimale du fumier. Notamment, la formation, le conseil, le suivi, les démonstrations sur les techniques de gestion du fumier auprès des agro-éleveurs et l’initiation d’autres études plus approfondies sur la thématique.PRESIDENT DE JURY : Mr Y.KABORET Yalacé, Pr à l’EISMV de Dakar MEMBRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr titulaire à l’EISMV de Dakar/M. SAWADOGO Germain Jérôme, Pr Honoraire de l’EISMV/M. BEDEKELABOU Pouewedeou André, Epidémiologiste à la Direction de l’élevage du Togo DATE DE SOUTENANCE : 22/11/2023 PAYS : MALI Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5254 Connaissances des risques liés à la gestion du fumier sur la santé publique dans les ménages de la région de Sikasso au Mali [texte imprimé] / Awa Sadio Yena, Auteur . - Dakar : EISMV, 2023 . - 23p.
Langues : Français (fre)
Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2023 Mots-clés : FUMIER SANTE PUBLIQUE SIKASSO MALI Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : L’élevage contribue à l’augmentation de la production des cultures vivrières et de rentes à travers la traction animale et la production de fumure. Malgré ces atouts, l’élevage peut avoir des impacts sanitaires et environnementaux négatifs liés notamment à la cohabitation entre l’animal et l’homme et à la mauvaise gestion des déchets tel que la fumure. En effet, les populations sont souvent exposées à des risques de santé à travers des pratiques comme la divagation des animaux, leur promiscuité avec les populations, leur entretien, le stockage et l’épandage du fumier. Que ce soit les parasites ou microbes, les mauvaises odeurs, la pollution de l’eau et des sols, la contribution à l’augmentation des gaz à effet de serre, la gestion du fumier au sein des ménages entraine de nombreuses nuisances.
La présente étude avait alors pour but de déterminer les pratiques de gestion du fumier au niveau des ménages et identifier les risques potentiels générés par les pratiques de gestion du fumier sur la santé les communautés qui détiennent ces animaux. A cet effet, une enquête descriptive a été menée au sein de 300 ménages dans deux cercles au Mali, à savoir celui de Sikasso et de Koutiala.
Les répondants au questionnaire étaient majoritairement des hommes (98,7%) analphabètes (54,3%). Parmi eux, 97,8% utilisaient un lieu de confinement pour la garde des animaux (petits ruminants et volaille). Ce sont les clôtures sans toit ou des attaches aux piquets qui ont le plus été rencontrées (50,8%). L’étude a permis de constater que certaines pratiques de gestion du fumier peuvent constituer des risques pour la santé publique et environnementale. Ce sont notamment : la garde des animaux au sein d’une clôture sans toit ou attachés à un piquet dans les concessions (50,8%), l’absence de plancher au sein des lieux de confinement (1,3%), le non ramassage du fumier des animaux en divagation (74,3%), l’utilisation des enfants (40,3%) et des femmes (33,3%) comme main d’œuvre pour le nettoyage du lieu de confinement et l’entretien des animaux, le stockage en tas du fumier (80,1%) sans couverture, ni plancher étanche favorisant les risques de pollutions environnementales (90,8%), le défaut d’utilisation des équipements de protection individuelle lors de la manipulation du fumier. Malgré ces pratiques, l’étude a également permis de s’apercevoir qu’un très faible constat de maladies qui selon les répondants pourraient être dues à la gestion du fumier a été fait.
À la lumière des résultats de cette étude et de la discussion relative à la thématique, des recommandations ont été formulées afin d’améliorer la gestion optimale du fumier. Notamment, la formation, le conseil, le suivi, les démonstrations sur les techniques de gestion du fumier auprès des agro-éleveurs et l’initiation d’autres études plus approfondies sur la thématique.PRESIDENT DE JURY : Mr Y.KABORET Yalacé, Pr à l’EISMV de Dakar MEMBRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr titulaire à l’EISMV de Dakar/M. SAWADOGO Germain Jérôme, Pr Honoraire de l’EISMV/M. BEDEKELABOU Pouewedeou André, Epidémiologiste à la Direction de l’élevage du Togo DATE DE SOUTENANCE : 22/11/2023 PAYS : MALI Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5254 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité M387 MEM23-16 Mémoire Bibliothèque (SID) Mémoires de Master Disponible Documents numériques

MEM23-16Adobe Acrobat PDFSéropositivité et facteurs de risque d’infection par le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo chez les bovins et les ovins dans la région de Mopti au Mali, 2021 / Mohamed Adama DIAKITE (2023)

Titre : Séropositivité et facteurs de risque d’infection par le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo chez les bovins et les ovins dans la région de Mopti au Mali, 2021 Type de document : texte imprimé Auteurs : Mohamed Adama DIAKITE, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2023 Importance : 23p. Langues : Français (fre) Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2023 Mots-clés : EPIDEMOLOGIE FIEVRE HEMORRAGIQUE CRIMEE-CONGO BOVIN OVIN MALI Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : La fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC) est une arbovirose zoonotique, provoquée par un virus de la famille des Bunyaviridae du genre Orthonairovirus transmis par la piqure de tiques. Le virus provoque une infection subclinique chez l’animal et une maladie hémorragique virale sévère, avec un taux de létalité de 10 à 40% chez l’homme.
Entre janvier et février 2020, 18 cas humains de FHCC dont 9 décès sont enregistrés dans le district sanitaire de la région de Mopti au Mali. Face à ce problème de santé publique majeure, la présente étude est initiée afin de déterminer la séropositivité de la FHCC chez les bovins et les ovins et identifier les facteurs de risques associés à la présence d’anticorps chez les bovins et les ovins dans la région de Mopti. Une enquête transversale descriptive est menée sur un total de 200 bovins et ovins échantillonnés dans les localités de Konna et de Mopti zone urbaine. La technique de l’ELISA sandwich à double antigène a permis d’établir une séropositivité globale réelle de 43,8% (IC à 95% : 36,9 - 50,6) dont des séropositivités de 40% (IC à 95 : 30,4 - 49,6) à Konna et 45,5% (IC à 95% : 35,2 - 54,8) à Sévaré. Selon l’espèce, la séropositivité est de 58,6% (IC à 95% : 48,3 - 67,7) chez les bovins et 27% (IC à 95% : 18,3 - 35,7) chez les ovins dans les deux localités.
L’analyse biostatistique montre que le risque d’apparition de l’infection par le virus de la FHCC est plus élevé chez les bovins (OR=3,77 ; IC à 95% : 2,07 – 6,87) que les ovins.
Cette étude démontre la circulation du virus chez les animaux et la nécessité de conduire des actions pour le contrôle de cette zoonose.PRESIDENT DE JURY : M. KABORET Yalacé Yamba, Pr à l’EISMV de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme BADA-ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l‟EISMV de Dakar MEMBRE : Mme BADA -ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar/M. J.SAWADOGO Germain, Pr Honoraire de l‟EISMV de Dakar/M. DIOUF Nicolas Djighnoum, Maitre-assistant à l‟UGB de Saint-Louis/M. DAHOUROU Laibané Dieudonné, Maitre-assistant à l‟Université de Dédougou / Burkina Faso CO-DIRECTEUR : Dr DAHOUROU Laibané Dieudonné, Maitre-assistant à l‟Université de Dédougou / Burkina Faso DATE DE SOUTENANCE : 04/11/2023 PAYS : MALI Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5256 Séropositivité et facteurs de risque d’infection par le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo chez les bovins et les ovins dans la région de Mopti au Mali, 2021 [texte imprimé] / Mohamed Adama DIAKITE, Auteur . - Dakar : EISMV, 2023 . - 23p.
Langues : Français (fre)
Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2023 Mots-clés : EPIDEMOLOGIE FIEVRE HEMORRAGIQUE CRIMEE-CONGO BOVIN OVIN MALI Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : La fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC) est une arbovirose zoonotique, provoquée par un virus de la famille des Bunyaviridae du genre Orthonairovirus transmis par la piqure de tiques. Le virus provoque une infection subclinique chez l’animal et une maladie hémorragique virale sévère, avec un taux de létalité de 10 à 40% chez l’homme.
Entre janvier et février 2020, 18 cas humains de FHCC dont 9 décès sont enregistrés dans le district sanitaire de la région de Mopti au Mali. Face à ce problème de santé publique majeure, la présente étude est initiée afin de déterminer la séropositivité de la FHCC chez les bovins et les ovins et identifier les facteurs de risques associés à la présence d’anticorps chez les bovins et les ovins dans la région de Mopti. Une enquête transversale descriptive est menée sur un total de 200 bovins et ovins échantillonnés dans les localités de Konna et de Mopti zone urbaine. La technique de l’ELISA sandwich à double antigène a permis d’établir une séropositivité globale réelle de 43,8% (IC à 95% : 36,9 - 50,6) dont des séropositivités de 40% (IC à 95 : 30,4 - 49,6) à Konna et 45,5% (IC à 95% : 35,2 - 54,8) à Sévaré. Selon l’espèce, la séropositivité est de 58,6% (IC à 95% : 48,3 - 67,7) chez les bovins et 27% (IC à 95% : 18,3 - 35,7) chez les ovins dans les deux localités.
L’analyse biostatistique montre que le risque d’apparition de l’infection par le virus de la FHCC est plus élevé chez les bovins (OR=3,77 ; IC à 95% : 2,07 – 6,87) que les ovins.
Cette étude démontre la circulation du virus chez les animaux et la nécessité de conduire des actions pour le contrôle de cette zoonose.PRESIDENT DE JURY : M. KABORET Yalacé Yamba, Pr à l’EISMV de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme BADA-ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l‟EISMV de Dakar MEMBRE : Mme BADA -ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar/M. J.SAWADOGO Germain, Pr Honoraire de l‟EISMV de Dakar/M. DIOUF Nicolas Djighnoum, Maitre-assistant à l‟UGB de Saint-Louis/M. DAHOUROU Laibané Dieudonné, Maitre-assistant à l‟Université de Dédougou / Burkina Faso CO-DIRECTEUR : Dr DAHOUROU Laibané Dieudonné, Maitre-assistant à l‟Université de Dédougou / Burkina Faso DATE DE SOUTENANCE : 04/11/2023 PAYS : MALI Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5256 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité M386 MEM23-15 Mémoire Bibliothèque (SID) Mémoires de Master Disponible Documents numériques

MEM23-15Adobe Acrobat PDFappréciation des caractéristiques physico-chimiques, nutritionnelles et sensorielles de trios variétés de sorgho fortifiées et de leurs dérivés au Mali (2022) / Koniba KONARE (2023)

Titre : appréciation des caractéristiques physico-chimiques, nutritionnelles et sensorielles de trios variétés de sorgho fortifiées et de leurs dérivés au Mali (2022) Type de document : texte imprimé Auteurs : Koniba KONARE, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2023 Importance : 32p. Langues : Français (fre) Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2023 Mots-clés : ALIMENTATION DES ANIMAUX SORGHO MALI Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : Le sorgho est l’une des céréales la plus utilisée au Mali, mais pauvre en éléments nutritifs. La fortification du sorgho a vu le jour afin d’améliorer ses qualités nutritionnelles et technologiques. Le but de notre étude est de caractériser deux variétés fortifiées de sorgho (Saba nafantè, Doucouyiriwa) et d’une variété témoin (Séguifa). La caractérisation a porté sur la détermination de leurs caractéristiques physicochimiques, nutritionnelles et sensorielles ainsi que les caractéristiques organoleptiques et nutritionnelles de leurs produits transformés (tô et couscous). La teneur en protéines a été déterminée par la méthode de Kjeldahl. Les teneurs en lysine et thréonine ont été déterminées par la méthode AccQ-Fluor Reagent Kit. Les teneurs en fer et zinc ont été déterminées par la méthode de dosage par Spectrophotométrie d’absorption atomique. Les cendres ont été déterminées par la méthode AOAC (1993). L’humidité a été déterminée par la méthode l’ISO 712 :2009. Les teneurs en eau des variétés de sorgho fortifié varient de 8,20% à 8,76%. Les variétés de sorgho fortifiées étudiées avaient des teneurs qui varient en protéines (9,68% à 12,05%), thréonine (0,32% à 1,71%), lysine (0,93% à 2,64%), fer (5,37mg/100g à 8,05mg/100g) et zinc (1,46mg/100g à 1,67mg/100g).
La quantité d’eau pour la cuisson a varié suivant les variétés et de plats à préparer.
Les teneurs des grains non décortiqués ont été plus élevées en éléments nutritifs que celles des farines ayant subi le décorticage et les teneurs des aliments (tô) issus de ces transformations ont renfermé les plus faibles valeurs. Cela prouve que les sons de ces grains contiennent la grande partie des éléments nutritifs tels que la lysine, la thréonine, le fer, le zinc. Cela montre que le décorticage et les transformations impactent négativement sur la qualité du sorgho.
Le tô et le couscous de Doucouyiriwa et Saba nafantè ont été appréciés plus positivement par 73% des dégustateurs alors que le témoin Séguifa été apprécié bon par plus de 60% des dégustateurs.
Les résultats obtenus ont montré que les sorghos fortifiés étaient plus riches en éléments nutritifs que le sorgho témoin avant la transformation. Par contre au cours de la transformation, c’est le phénomène contraire qui a été constaté.
PRESIDENT DE JURY : M. KABORET Yalacé Yamba, Pr titulaire à l’E.I.S.M. V de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme CISSE Fatimata Diallo, Maitre de Recherche à l’IER de Bamako, MEMBRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr titulaire à l’EISMV de Dakar/M. SAWADOGO Germain Jérôme, Pr honoraire de l’EISMV de Dakar/M. AYESSOU Nicolas Cyrille Mensah, Pr titulaire à l’ESP-UCAD CO-DIRECTEUR : M. Khalifa Serigne Babacar, Maître de Conférences Agrégé à l’USSEIN de Kaolack DATE DE SOUTENANCE : 05/05/2023 PAYS : Mali Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5062 appréciation des caractéristiques physico-chimiques, nutritionnelles et sensorielles de trios variétés de sorgho fortifiées et de leurs dérivés au Mali (2022) [texte imprimé] / Koniba KONARE, Auteur . - Dakar : EISMV, 2023 . - 32p.
Langues : Français (fre)
Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2023 Mots-clés : ALIMENTATION DES ANIMAUX SORGHO MALI Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : Le sorgho est l’une des céréales la plus utilisée au Mali, mais pauvre en éléments nutritifs. La fortification du sorgho a vu le jour afin d’améliorer ses qualités nutritionnelles et technologiques. Le but de notre étude est de caractériser deux variétés fortifiées de sorgho (Saba nafantè, Doucouyiriwa) et d’une variété témoin (Séguifa). La caractérisation a porté sur la détermination de leurs caractéristiques physicochimiques, nutritionnelles et sensorielles ainsi que les caractéristiques organoleptiques et nutritionnelles de leurs produits transformés (tô et couscous). La teneur en protéines a été déterminée par la méthode de Kjeldahl. Les teneurs en lysine et thréonine ont été déterminées par la méthode AccQ-Fluor Reagent Kit. Les teneurs en fer et zinc ont été déterminées par la méthode de dosage par Spectrophotométrie d’absorption atomique. Les cendres ont été déterminées par la méthode AOAC (1993). L’humidité a été déterminée par la méthode l’ISO 712 :2009. Les teneurs en eau des variétés de sorgho fortifié varient de 8,20% à 8,76%. Les variétés de sorgho fortifiées étudiées avaient des teneurs qui varient en protéines (9,68% à 12,05%), thréonine (0,32% à 1,71%), lysine (0,93% à 2,64%), fer (5,37mg/100g à 8,05mg/100g) et zinc (1,46mg/100g à 1,67mg/100g).
La quantité d’eau pour la cuisson a varié suivant les variétés et de plats à préparer.
Les teneurs des grains non décortiqués ont été plus élevées en éléments nutritifs que celles des farines ayant subi le décorticage et les teneurs des aliments (tô) issus de ces transformations ont renfermé les plus faibles valeurs. Cela prouve que les sons de ces grains contiennent la grande partie des éléments nutritifs tels que la lysine, la thréonine, le fer, le zinc. Cela montre que le décorticage et les transformations impactent négativement sur la qualité du sorgho.
Le tô et le couscous de Doucouyiriwa et Saba nafantè ont été appréciés plus positivement par 73% des dégustateurs alors que le témoin Séguifa été apprécié bon par plus de 60% des dégustateurs.
Les résultats obtenus ont montré que les sorghos fortifiés étaient plus riches en éléments nutritifs que le sorgho témoin avant la transformation. Par contre au cours de la transformation, c’est le phénomène contraire qui a été constaté.
PRESIDENT DE JURY : M. KABORET Yalacé Yamba, Pr titulaire à l’E.I.S.M. V de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme CISSE Fatimata Diallo, Maitre de Recherche à l’IER de Bamako, MEMBRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr titulaire à l’EISMV de Dakar/M. SAWADOGO Germain Jérôme, Pr honoraire de l’EISMV de Dakar/M. AYESSOU Nicolas Cyrille Mensah, Pr titulaire à l’ESP-UCAD CO-DIRECTEUR : M. Khalifa Serigne Babacar, Maître de Conférences Agrégé à l’USSEIN de Kaolack DATE DE SOUTENANCE : 05/05/2023 PAYS : Mali Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5062 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité M377 MEM23-06 Mémoire Bibliothèque (SID) Mémoires de Master Disponible Documents numériques

MEM23-06Adobe Acrobat PDFCONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES EN HYGIENE DES ALIMENTS CHEZ LES ETUDIANTS DE L’UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR (UCAD), SENEGAL (2021) / Ousseynou Kébé (2023)

Titre : CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES EN HYGIENE DES ALIMENTS CHEZ LES ETUDIANTS DE L’UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR (UCAD), SENEGAL (2021) Type de document : texte imprimé Auteurs : Ousseynou Kébé, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2023 Importance : 26p. Langues : Français (fre) Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2023 Mots-clés : HYGIENE DES ALIMENTS INSPECTION DES ALIMENTS,COUD SENEGAL Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les aliments impropres à la consommation rendent malade une personne sur dix (10) et en tuent 420.000 chaque année. Les aliments et/ou l’eau contaminé (e)s par divers agents biologiques pathogènes, des prions et/ou de toxines sont responsables de plus de 200 formes de maladies allant des simples diarrhées à divers types de cancers. Les principales victimes de ces affections sont les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et celles souffrant de maladie chronique. Au Sénégal, ces dernières décennies, à la suite de l’instauration de la journée continue dans la fonction publique et à la massification des effectifs dans les établissements universitaires, la restauration collective plus particulièrement celle de rue a connu une envolée importante surtout à Dakar. Dans les établissements de restauration, les conditions d’hygiène laissent souvent à désirer ce qui expose les clients à des toxi-infections alimentaires pouvant être sévères et mener le consommateur à l’hospitalisation. Fort de ce constat et au regard du flux de fréquentation des restaurants universitaires et de rue, se pose la question à savoir si les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) sont informés et sensibilisés sur les maladies transmissibles d’origine alimentaire. Pour ce faire, d’août à décembre 2021, une étude descriptive transversale a été menée auprès de 420 étudiants choisis dans les différentes facultés, instituts et grandes écoles de l’UCAD à l’aide d’un échantillonnage en boule de neige tout en tenant compte des proportions des différentes entités. Un questionnaire structuré a été établi pour collecter des données sur les connaissances en hygiène des aliments, les attitudes, les pratiques et l’impact sanitaire et économique associés à la restauration de rue. A l’UCAD, 66,45% des participants ignorent la procédure adéquate de nettoyage des cuisines. Seuls 38,37% des étudiants savent qu’il ne faut jamais recongeler les denrées (viande, poisson, volaille) une fois décongelées et chaudes. Environ, 55% des étudiants méconnaissent la vraie raison pour laquelle il est interdit d’ouvrir fréquemment le congélateur. En termes de connaissances, attitudes et pratiques, les étudiants ont obtenu un score moyen global de 17,8 sur 30. Ce score moyen est à mettre en rapport avec les mesures préventives rigoureusement appliquées, depuis 2020, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Face à l’absence de programme d’éducation et de sensibilisation durant tout leur cursus académique et afin d’améliorer leurs connaissances, des modules d’hygiène du personnel et d’hygiène des aliments devraient être donc inclus dans les curricula d’enseignement, et ce dès le collège. Les services étatiques devront susciter l’intérêt dans la recherche et la promotion de l’hygiène des aliments en mettant en place des structures dont le rôle serait la formation/sensibilisation des consommateurs sur les risques associés aux mauvaises pratiques d’hygiène et les moyens d’atténuer ces risques. PRESIDENT DE JURY : M. KABORET Yalacé Yamba, Pr à l’EISMV de Dakar, Sénégal DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme MUSABYEMARIYA Bellancille, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar, Sénégal MEMBRE : M. SAWADOGO Germain Jérôme, Pr honoraire à l’EISMV de Dakar, Sénégal/Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar, Sénégal CO-DIRECTEUR : Mme NDOUR Andrée Prisca Ndjoug, DVM, MSc, PhD ; Vacataire à l’EISMV de Dakar/M. OROU SEKO Malik, DVM, MSc, PhD, ATER à l’EISMV de Dakar, Sénégal DATE DE SOUTENANCE : 19/05/2023 PAYS : Sénégal Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5065 CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES EN HYGIENE DES ALIMENTS CHEZ LES ETUDIANTS DE L’UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR (UCAD), SENEGAL (2021) [texte imprimé] / Ousseynou Kébé, Auteur . - Dakar : EISMV, 2023 . - 26p.
Langues : Français (fre)
Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2023 Mots-clés : HYGIENE DES ALIMENTS INSPECTION DES ALIMENTS,COUD SENEGAL Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les aliments impropres à la consommation rendent malade une personne sur dix (10) et en tuent 420.000 chaque année. Les aliments et/ou l’eau contaminé (e)s par divers agents biologiques pathogènes, des prions et/ou de toxines sont responsables de plus de 200 formes de maladies allant des simples diarrhées à divers types de cancers. Les principales victimes de ces affections sont les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et celles souffrant de maladie chronique. Au Sénégal, ces dernières décennies, à la suite de l’instauration de la journée continue dans la fonction publique et à la massification des effectifs dans les établissements universitaires, la restauration collective plus particulièrement celle de rue a connu une envolée importante surtout à Dakar. Dans les établissements de restauration, les conditions d’hygiène laissent souvent à désirer ce qui expose les clients à des toxi-infections alimentaires pouvant être sévères et mener le consommateur à l’hospitalisation. Fort de ce constat et au regard du flux de fréquentation des restaurants universitaires et de rue, se pose la question à savoir si les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) sont informés et sensibilisés sur les maladies transmissibles d’origine alimentaire. Pour ce faire, d’août à décembre 2021, une étude descriptive transversale a été menée auprès de 420 étudiants choisis dans les différentes facultés, instituts et grandes écoles de l’UCAD à l’aide d’un échantillonnage en boule de neige tout en tenant compte des proportions des différentes entités. Un questionnaire structuré a été établi pour collecter des données sur les connaissances en hygiène des aliments, les attitudes, les pratiques et l’impact sanitaire et économique associés à la restauration de rue. A l’UCAD, 66,45% des participants ignorent la procédure adéquate de nettoyage des cuisines. Seuls 38,37% des étudiants savent qu’il ne faut jamais recongeler les denrées (viande, poisson, volaille) une fois décongelées et chaudes. Environ, 55% des étudiants méconnaissent la vraie raison pour laquelle il est interdit d’ouvrir fréquemment le congélateur. En termes de connaissances, attitudes et pratiques, les étudiants ont obtenu un score moyen global de 17,8 sur 30. Ce score moyen est à mettre en rapport avec les mesures préventives rigoureusement appliquées, depuis 2020, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Face à l’absence de programme d’éducation et de sensibilisation durant tout leur cursus académique et afin d’améliorer leurs connaissances, des modules d’hygiène du personnel et d’hygiène des aliments devraient être donc inclus dans les curricula d’enseignement, et ce dès le collège. Les services étatiques devront susciter l’intérêt dans la recherche et la promotion de l’hygiène des aliments en mettant en place des structures dont le rôle serait la formation/sensibilisation des consommateurs sur les risques associés aux mauvaises pratiques d’hygiène et les moyens d’atténuer ces risques. PRESIDENT DE JURY : M. KABORET Yalacé Yamba, Pr à l’EISMV de Dakar, Sénégal DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Mme MUSABYEMARIYA Bellancille, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar, Sénégal MEMBRE : M. SAWADOGO Germain Jérôme, Pr honoraire à l’EISMV de Dakar, Sénégal/Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar, Sénégal CO-DIRECTEUR : Mme NDOUR Andrée Prisca Ndjoug, DVM, MSc, PhD ; Vacataire à l’EISMV de Dakar/M. OROU SEKO Malik, DVM, MSc, PhD, ATER à l’EISMV de Dakar, Sénégal DATE DE SOUTENANCE : 19/05/2023 PAYS : Sénégal Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=5065 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité M379 MEM23-08 Mémoire Bibliothèque (SID) Mémoires de Master Disponible Documents numériques

MEM23-08Adobe Acrobat PDFConnaissances et pratiques du personnel d’abattoirs de Dakar et des éleveurs de Pout sur la tuberculose bovine au Sénégal en 2022 / Abdoul Mahidou Ousmane Hamid (2023)

PermalinkEffets de la supplémentation des huiles essentielles d’ail (Allium sativum) dans l’eau de boisson sur la nutrition des poulets de chair au Sénégal 2022. / Assitan SANGARE (2023)

PermalinkEtude du niveau de mécanisation de la traite dans les fermes laitières en zone péri-urbaine de Bamako en 2021 / Moussa BERTHE (2023)

PermalinkEtude sur les caractéristiques de la consommation du haricot commun sec (Phaseolus vulgaris L.) cultivé au Mali en 2022. / Sidi DAO (2023)

PermalinkNiveau de contamination par l’aflatoxine M1 du lait de vaches nourries avec l’aliment industriel dans trois fermes de la zone périurbaine de Dakar (Sénégal) en 2022 / Omar SECK (2023)

PermalinkPerformances de production laitière et caractéristiques physico-chimiques du lait des croisées (½ et ¾ sang) issues du croisement entre races locales et Montbéliardes dans la commune du Mandé-Bamako (Mali) en 2021 / Ilyase Sidi DJIRE (2023)

PermalinkPrévalence des souches de escherichia coli productrices de betalactamases a spectre étendu (BLSE) d’origine animale dans la région de Dakar en 2022 / Christian Diène Faye (2023)

PermalinkRôle du porc des élevages traditionnels dans l’épidémiologie de la toxoplasmose dans le sud-est de la côte d’ivoire en 2019 / Gbohounou Fabrice Gnali (2023)

PermalinkSéroprévalence et facteurs de risque associés à la Fièvre de la Vallée du Rift chez les ruminants dans le département de Tassara, région de Tahoua au Niger, en 2022 / Nana Barira LAMINOU ZABEIROU (2023)

Permalink