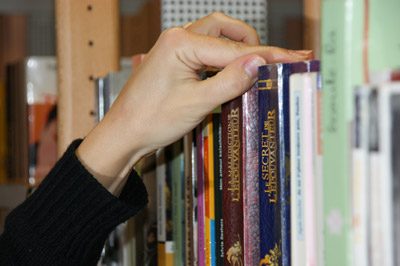EISMV DE DAKAR: Service d'Information et de Documentation
Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (25)


 Interroger des sources externes
Interroger des sources externesAnalyse socioéconomique de l’utilisation des biodigesteurs dans les petits élevages laitiers de la région de Kaolack (Sénégal) / Nicaise Akaffou Akaffou (2014)

Titre : Analyse socioéconomique de l’utilisation des biodigesteurs dans les petits élevages laitiers de la région de Kaolack (Sénégal) Type de document : texte imprimé Auteurs : Nicaise Akaffou Akaffou, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2014 Importance : 30 p. Langues : Français (fre) Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2014 Mots-clés : PRODUCTION LAITIERE LAIT BIOGAZ BOVIN SENEGAL Résumé : Ce travail vise à poser un diagnostic des bio-digesteurs installés dans la région de
Kaolack et faire une analyse socio-économique comparative du biogaz produit
avec des ménages témoins qui utilisent le bois de chauffe. Ce sont au total 56
installations et 30 ménages témoins utilisant le bois de chauffe qui ont été
enquêtés.
La principale motivation des bénéficiaires est l'allègement des tâches ménagères.
La plupart des bio-digesteurs installés sont non fonctionnels, soit 64,29% du fait
des défauts de construction et l’approvisionnement en bouses fraîches. La
capacité moyenne des digesteurs installés est de 7,63 m3. Ce qui est insuffisant au
regard de la taille moyenne des ménages qui est de 15, 66 ± 10 (N=14 m3 pour 16
personnes). La production de biogaz s'accompagne d'une production moyenne de
compost équivalant 3,522 ± 1 tonne utilisé par la majorité des récipiendaires pour
la culture de l'arachide. Le coût annuel d'achat de bois de chauffe dans les
ménages sans bio-digesteur est de 83 832 ± 38 376 FCFA soit 25 966 FCFA de
plus qu’un ménage avec bio-digesteur soit 57 866 FCFA pour un digesteur de 10
m3. Le fertilisant produit a une valeur monétaire estimée 422 640 ± 120 240
FCFA. Au vu de ce qui précède, l'utilisation de biogaz contribue au bien être des
ménages ruraux.PRESIDENT DE JURY : M. PANGUI Louis Joseph, Pr à l’EISMV de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. SAWADOGO Germain Jérôme, Pr à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. BAKOU Serge Niangoran, Maître de conférences agrégé à l'EISMV de Dakar /M. TOGUEBAYE Bhen Sikina, Pr à la FST de l’UCAD/M. NDIAYE Amadou, Enseignant chercheur (PhD) à l’UBG de Saint-Louis CO-DIRECTEUR : M. SOW Adama, Maître-assistant à l'EISMV de Dakar (Sénégal)/M. MOUICHE Moctar, Enseignant à ESMV de Gaoundéré (Cameroun) DATE DE SOUTENANCE : 19/12/2014 PAYS : Côte d’Ivoire Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1253 Analyse socioéconomique de l’utilisation des biodigesteurs dans les petits élevages laitiers de la région de Kaolack (Sénégal) [texte imprimé] / Nicaise Akaffou Akaffou, Auteur . - Dakar : EISMV, 2014 . - 30 p.
Langues : Français (fre)
Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2014 Mots-clés : PRODUCTION LAITIERE LAIT BIOGAZ BOVIN SENEGAL Résumé : Ce travail vise à poser un diagnostic des bio-digesteurs installés dans la région de
Kaolack et faire une analyse socio-économique comparative du biogaz produit
avec des ménages témoins qui utilisent le bois de chauffe. Ce sont au total 56
installations et 30 ménages témoins utilisant le bois de chauffe qui ont été
enquêtés.
La principale motivation des bénéficiaires est l'allègement des tâches ménagères.
La plupart des bio-digesteurs installés sont non fonctionnels, soit 64,29% du fait
des défauts de construction et l’approvisionnement en bouses fraîches. La
capacité moyenne des digesteurs installés est de 7,63 m3. Ce qui est insuffisant au
regard de la taille moyenne des ménages qui est de 15, 66 ± 10 (N=14 m3 pour 16
personnes). La production de biogaz s'accompagne d'une production moyenne de
compost équivalant 3,522 ± 1 tonne utilisé par la majorité des récipiendaires pour
la culture de l'arachide. Le coût annuel d'achat de bois de chauffe dans les
ménages sans bio-digesteur est de 83 832 ± 38 376 FCFA soit 25 966 FCFA de
plus qu’un ménage avec bio-digesteur soit 57 866 FCFA pour un digesteur de 10
m3. Le fertilisant produit a une valeur monétaire estimée 422 640 ± 120 240
FCFA. Au vu de ce qui précède, l'utilisation de biogaz contribue au bien être des
ménages ruraux.PRESIDENT DE JURY : M. PANGUI Louis Joseph, Pr à l’EISMV de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. SAWADOGO Germain Jérôme, Pr à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. BAKOU Serge Niangoran, Maître de conférences agrégé à l'EISMV de Dakar /M. TOGUEBAYE Bhen Sikina, Pr à la FST de l’UCAD/M. NDIAYE Amadou, Enseignant chercheur (PhD) à l’UBG de Saint-Louis CO-DIRECTEUR : M. SOW Adama, Maître-assistant à l'EISMV de Dakar (Sénégal)/M. MOUICHE Moctar, Enseignant à ESMV de Gaoundéré (Cameroun) DATE DE SOUTENANCE : 19/12/2014 PAYS : Côte d’Ivoire Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1253 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité M210 MEM14-23 Mémoire Bibliothèque (SID) Mémoires de Master Disponible Documents numériques

MEM14-23Adobe Acrobat PDFAnalyse du système de commercialisation du fourrage dans la ville de Niamey (Niger) / Soulé Maman (2014)

Titre : Analyse du système de commercialisation du fourrage dans la ville de Niamey (Niger) Type de document : texte imprimé Auteurs : Soulé Maman, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2014 Importance : 30 p. Note générale :
Langues : Français (fre) Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2014 Mots-clés : FOURRAGE COMMERCIALISATION NIGER Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : La présente étude a été conduite dans la ville de Niamey pendant la saison des pluies
de juillet à septembre 2013. Elle a pour objectif principal d’analyser le système de
commercialisation du fourrage dans la ville de Niamey. L’approche méthodologique
adoptée a consisté dans un premier temps à la recherche bibliographique sur les
définitions des concepts ou notions clés, les ressources fourragères et la
commercialisation du fourrage au Niger.
Par la suite, une enquêté a été réalisée auprès de 90 acteurs dont 31 collecteurs, 4
grossistes et 55 revendeurs qui interagissent dans l’approvisionnement et la vente du
fourrage à travers quatre circuits. L’étude révèle une absence d’organisation des
commerçants. Ces derniers ont en majorité un âge>20 ans (84,88%), de l’ethnie
Djerma et originaires pour la plupart de la région de Tillabéry. La principale
motivation à l’exercice de l’activité est son caractère générateur des revenus. Un
nombre non négligeable de collecteurs (41,9%) pratiquent cette activité comme moyen
de survie.
Les fourrages commercialisés proviennent pour l’essentiel des départements riverains
de Niamey. Certains résidus de cultures (fane d’arachide) sont importés de localités
lointaines comme Maradi et Doutchi. Le prix de vente des fourrages varie selon que
l’acquéreur soit consommateur ou revendeur. Il est aussi lié à la disponibilité du
fourrage dont l’influence traduit les variations saisonnières.
En somme, la commercialisation du fourrage, important moyen de lutte contre la
pauvreté et de renforcement de la sécurité alimentaire, est une activité financièrement
rentable. Elle doit donc être soutenue dans la perspective d’un développement durable.
Ce soutien sera d’autant plus efficace que l’Etat développe des programmes en faveur
de sa promotion et de la commercialisation de ses produits.PRESIDENT DE JURY : M. PANGUI Louis Joseph, Pr à l’EISMV de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. SAWADOGO Germain Jérôme, Pr à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. TOGUEBAYE Bhen Sikina, Pr à la FST de l’UCAD/M. NDIAYE Amadou, Enseignant chercheur (PhD) à l’UGB de Saint Louis CO-DIRECTEUR : M. Ali MAHAMADOU, Enseignant (Agroéconomiste) à L’UAM de Niamey DATE DE SOUTENANCE : 08/03/2014 PAYS : NIGER Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1192 Analyse du système de commercialisation du fourrage dans la ville de Niamey (Niger) [texte imprimé] / Soulé Maman, Auteur . - Dakar : EISMV, 2014 . - 30 p.
Langues : Français (fre)
Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2014 Mots-clés : FOURRAGE COMMERCIALISATION NIGER Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : La présente étude a été conduite dans la ville de Niamey pendant la saison des pluies
de juillet à septembre 2013. Elle a pour objectif principal d’analyser le système de
commercialisation du fourrage dans la ville de Niamey. L’approche méthodologique
adoptée a consisté dans un premier temps à la recherche bibliographique sur les
définitions des concepts ou notions clés, les ressources fourragères et la
commercialisation du fourrage au Niger.
Par la suite, une enquêté a été réalisée auprès de 90 acteurs dont 31 collecteurs, 4
grossistes et 55 revendeurs qui interagissent dans l’approvisionnement et la vente du
fourrage à travers quatre circuits. L’étude révèle une absence d’organisation des
commerçants. Ces derniers ont en majorité un âge>20 ans (84,88%), de l’ethnie
Djerma et originaires pour la plupart de la région de Tillabéry. La principale
motivation à l’exercice de l’activité est son caractère générateur des revenus. Un
nombre non négligeable de collecteurs (41,9%) pratiquent cette activité comme moyen
de survie.
Les fourrages commercialisés proviennent pour l’essentiel des départements riverains
de Niamey. Certains résidus de cultures (fane d’arachide) sont importés de localités
lointaines comme Maradi et Doutchi. Le prix de vente des fourrages varie selon que
l’acquéreur soit consommateur ou revendeur. Il est aussi lié à la disponibilité du
fourrage dont l’influence traduit les variations saisonnières.
En somme, la commercialisation du fourrage, important moyen de lutte contre la
pauvreté et de renforcement de la sécurité alimentaire, est une activité financièrement
rentable. Elle doit donc être soutenue dans la perspective d’un développement durable.
Ce soutien sera d’autant plus efficace que l’Etat développe des programmes en faveur
de sa promotion et de la commercialisation de ses produits.PRESIDENT DE JURY : M. PANGUI Louis Joseph, Pr à l’EISMV de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. SAWADOGO Germain Jérôme, Pr à l’EISMV de Dakar MEMBRE : M. TOGUEBAYE Bhen Sikina, Pr à la FST de l’UCAD/M. NDIAYE Amadou, Enseignant chercheur (PhD) à l’UGB de Saint Louis CO-DIRECTEUR : M. Ali MAHAMADOU, Enseignant (Agroéconomiste) à L’UAM de Niamey DATE DE SOUTENANCE : 08/03/2014 PAYS : NIGER Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1192 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité M194 MEM14-7 Mémoire Bibliothèque (SID) Mémoires de Master Disponible Documents numériques

MEM14-7Adobe Acrobat PDFAnalyse technico- économique de la production de quatre (4) variétés fourragères de niébé dans la station agronomique de l’INRAN et évaluation de la valeur alimentaire de ses fanes / Alassan Nourou Ado (2014)

Titre : Analyse technico- économique de la production de quatre (4) variétés fourragères de niébé dans la station agronomique de l’INRAN et évaluation de la valeur alimentaire de ses fanes Type de document : texte imprimé Auteurs : Alassan Nourou Ado, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2014 Importance : 30 p. Note générale :
Langues : Français (fre) Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2014 Mots-clés : NIEBE FOURRAGE GROSSIER ALIMENT POUR ANIMAUX ALIMENTATION DES ANIMAUX NIGER Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : Une étude a été menée sur la culture de quatre niébé fourrager (TN256-87,
IN92E-26, TN3-78 et Lakadé) dans un contexte d’identification des espèces
fourragères pour une bonne politique d’élevage dans le sahel. La recherche visait à
vérifier la possibilité d’accroître la production des biomasses végétales sans réduire
de manière significative la quantité des graines de niébé produites et en utilisant une
dose d’engrais adaptée aux capacités de financement des agriculteurs. Deux essais
ont été expérimentés dans la station agronomique de l’INRAN à N’Dounga au
CERRA/Kollo sur les quatre (4) variétés de niébé dont l’un est l’essai de production
et l’autre pour la caractérisation des variétés. Les différentes modalités par parcelle
et par répétition étaient disposées en blocs complets randomisés avec fertilisation
recommandée de 100 Kg de15-15-15-NPK par ha soit 8,46 kg pour l’essai sur la
production et 5,76 kg pour celui de la caractérisation
Une ANOVA a été faite avec le logiciel SAS et le test de Student-Newman-Keuls a
permis de comparer les moyennes et les écart-types
Nous avons observé sur la production de ces quatre (4) variétés de niébé
fourrager des différences très significatives (P<0,01) pour les caractères levée à 3
semaines après le semis (LEV), le rendement en grains (RGR), le poids de cent
graines (PCG) et l’indice de récolte (IR). Les caractères vigueur des plants à 3
semaines après le semis (VIG) et le rendement des gousses (RGO) montrent des
différences significatives (P< 0,05). Le rendement en fanes sèches (RFS), le nombre
de jours à 50% de la floraison (FLO) le nombre de jours à 50% de la maturité (MAT),
la sensibilité à la maladie (SSM) et la sensibilité aux insectes (SSI) montrent des
différences non significatives (P> 0,05).
Ainsi, pour l’analyse de la valeur alimentaire de ces variétés les taux de la
cellulose (%CB) et de matière minérale (%MM) et l’unité fourragère (UF g/kg de MS)
montrent des différences significatives alors que l’extractif non azoté montre des
différences très significatives (P<0,0001).
Enfin, l’analyse technico-économique de la production fourragère de quatre
variétés de niébé fourrager (TN256-87, IN92E-26, TN3-78 et Lakadé) ont fourni
successivement les capacités d’autofinancement globales de 11.35.701 ; 960.001;
650.986 et 865.885 Fcfa ce qui montre que cette activité est rénumératrice (EB>0).PRESIDENT DE JURY : M. PANGUI Louis Joseph, Pr à l’EISMV de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. J. SAWADOGO Germain, Pr à l’EISMV de Dakar, M. ISSA Salissou, PhD; Chercheur au DPA/INRAN-Niamey M. ADAMOU Moutari, PhD; Chercheur au DCP/INRAN-Niamey MEMBRE : M. SAWADOGO Germain Jérôme, Pr à l’EISMV de Dakar/M. TOGUEBAYE Bhen Sikina, Pr à la FST de l’UCAD/M. OUEDRAOGO Georges Anicet, Pr à UP de Bobo-Dioulasso/M. NDIAYE Amadou, Enseignant-chercheur à l’UGB de Saint-Louis DATE DE SOUTENANCE : 17/01/2014 PAYS : NIGER Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1127 Analyse technico- économique de la production de quatre (4) variétés fourragères de niébé dans la station agronomique de l’INRAN et évaluation de la valeur alimentaire de ses fanes [texte imprimé] / Alassan Nourou Ado, Auteur . - Dakar : EISMV, 2014 . - 30 p.
Langues : Français (fre)
Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2014 Mots-clés : NIEBE FOURRAGE GROSSIER ALIMENT POUR ANIMAUX ALIMENTATION DES ANIMAUX NIGER Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : Une étude a été menée sur la culture de quatre niébé fourrager (TN256-87,
IN92E-26, TN3-78 et Lakadé) dans un contexte d’identification des espèces
fourragères pour une bonne politique d’élevage dans le sahel. La recherche visait à
vérifier la possibilité d’accroître la production des biomasses végétales sans réduire
de manière significative la quantité des graines de niébé produites et en utilisant une
dose d’engrais adaptée aux capacités de financement des agriculteurs. Deux essais
ont été expérimentés dans la station agronomique de l’INRAN à N’Dounga au
CERRA/Kollo sur les quatre (4) variétés de niébé dont l’un est l’essai de production
et l’autre pour la caractérisation des variétés. Les différentes modalités par parcelle
et par répétition étaient disposées en blocs complets randomisés avec fertilisation
recommandée de 100 Kg de15-15-15-NPK par ha soit 8,46 kg pour l’essai sur la
production et 5,76 kg pour celui de la caractérisation
Une ANOVA a été faite avec le logiciel SAS et le test de Student-Newman-Keuls a
permis de comparer les moyennes et les écart-types
Nous avons observé sur la production de ces quatre (4) variétés de niébé
fourrager des différences très significatives (P<0,01) pour les caractères levée à 3
semaines après le semis (LEV), le rendement en grains (RGR), le poids de cent
graines (PCG) et l’indice de récolte (IR). Les caractères vigueur des plants à 3
semaines après le semis (VIG) et le rendement des gousses (RGO) montrent des
différences significatives (P< 0,05). Le rendement en fanes sèches (RFS), le nombre
de jours à 50% de la floraison (FLO) le nombre de jours à 50% de la maturité (MAT),
la sensibilité à la maladie (SSM) et la sensibilité aux insectes (SSI) montrent des
différences non significatives (P> 0,05).
Ainsi, pour l’analyse de la valeur alimentaire de ces variétés les taux de la
cellulose (%CB) et de matière minérale (%MM) et l’unité fourragère (UF g/kg de MS)
montrent des différences significatives alors que l’extractif non azoté montre des
différences très significatives (P<0,0001).
Enfin, l’analyse technico-économique de la production fourragère de quatre
variétés de niébé fourrager (TN256-87, IN92E-26, TN3-78 et Lakadé) ont fourni
successivement les capacités d’autofinancement globales de 11.35.701 ; 960.001;
650.986 et 865.885 Fcfa ce qui montre que cette activité est rénumératrice (EB>0).PRESIDENT DE JURY : M. PANGUI Louis Joseph, Pr à l’EISMV de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. J. SAWADOGO Germain, Pr à l’EISMV de Dakar, M. ISSA Salissou, PhD; Chercheur au DPA/INRAN-Niamey M. ADAMOU Moutari, PhD; Chercheur au DCP/INRAN-Niamey MEMBRE : M. SAWADOGO Germain Jérôme, Pr à l’EISMV de Dakar/M. TOGUEBAYE Bhen Sikina, Pr à la FST de l’UCAD/M. OUEDRAOGO Georges Anicet, Pr à UP de Bobo-Dioulasso/M. NDIAYE Amadou, Enseignant-chercheur à l’UGB de Saint-Louis DATE DE SOUTENANCE : 17/01/2014 PAYS : NIGER Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1127 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité M188 MEM14-1 Mémoire Bibliothèque (SID) Mémoires de Master Disponible Documents numériques

MEM14-1Adobe Acrobat PDFAppréciation des risques de contamination microbienne de la viande de petits ruminants dans les abattoirs et dibiteries de Dakar, Sénégal / Bernadette Yougbaré (2014)

Titre : Appréciation des risques de contamination microbienne de la viande de petits ruminants dans les abattoirs et dibiteries de Dakar, Sénégal Type de document : texte imprimé Auteurs : Bernadette Yougbaré, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2014 Importance : 30 p. Note générale : PAYS:Burkina Faso
DSOUT:16/04/2014
Langues : Français (fre) Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2014 Mots-clés : VIANDE CHEVRE MOUTON CONTAMINATION CONTROLE DE QUALITE ABATTOIR DIBITERIE ANALYSE MICROBIOLOGIQUE SENEGAL Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : Au Sénégal, la viande rouge est considérée comme un aliment de choix en raison de sa valeur
nutritive. Sa richesse en protéines et la nature de celle-ci en font un aliment indispensable pour une
ration alimentaire équilibrée. Cette filière des viandes rouges notamment , celle des petits ruminants
a permis de développer des métiers de boucherie et une prolifération d'établissements de
restauration ; appelés "Dibiteries". Dans ces dibiteries, la viande est servie aux clients après avoir
subi de nombreuses manipulations et une opération de braisage au feu de bois. Cependant, malgré
ces qualités nutritionnelles, la viande constitue un milieu très favorable à la prolifération
microbienne. Les ouvriers dans les abattoirs et vendeurs de dibiterie ignorant les bonnes pratiques
d’hygiène, contribuent à la dissémination et à la multiplication des germes pathogènes. Ces germes
pouvant être à l’origine de toxi-infections alimentaires chez le consommateur.
La présente étude a pour objectif général d’analyser les risques de contamination microbienne de la
viande de petits ruminants produite dans les abattoirs et vendue dans les dibiteries de Dakar. Pour
ce faire une analyse des risques de contamination de la viande dans les abattoirs et les dibiteries a
été menée selon la méthode de l’OIE. Ainsi, une enquête de type transversale dans les abattoirs,
aires d’abattages de la rue 6 de Médina et dibiteries de Dakar ont permis d’avoir des
renseignements sur la qualité de la viande de l’abattage à la consommation. Des fiches d’enquête
ont été remplies de même que des prélèvements de viandes ont été effectués pour dénombrer les
germes responsables de la contamination. Au total, 138 échantillons de viande (crue et grillée) ont
été analysés pour la recherche des coliformes fécaux, d’Escherichia coli, des Staphylocoques
aureus présumés pathogènes, des anaérobies sulfito réducteurs et de la flore mésophile aérobie à
30°C. La contamination dans les abattoirs et aire d’abattage a indiqué un niveau de contamination
acceptable pour les coliformes fécaux, E. coli et la flore mésophile tandis qu’elle a été satisfaisante
pour les anaéobies sulfito-réducteurs et les staphylocoques. Quant aux dibiteries, 20/40 ont été
jugées non satisfaisantes pour les coliformes fécaux, 18/40 pour E. coli, et 20/40 pour la flore
mésophile. Les anaérobies sulfito-réducteurs et les staphylocoques ont été négligeables.
L’appréciation du risque a pris en compte des schémas événementiels intégrant toutes les étapes
impliquées dans la survenue d’une contamination bactérienne de la viande dans les abattoirs ou
aires d’abattage, pendant le transport, la préparation dans les dibiteries et les conséquences qui en
résultent. Ainsi trois niveaux de risque pour les consommateurs ont été déterminés : i) assez élevé à
très élevé (50,52%) ; ii) très faible à peu élevé (48,95%) ; iii) quasi nul à extrêmement faible
(0,52%).
Au vu de ces résultats, nous avons formulé des recommandations aux différents acteurs afin
d’améliorer la qualité de la viande produite dans les abattoirs et vendue dans les dibiteries.PRESIDENT DE JURY : M. PANGUI Louis Joseph, Pr à l’EISMV de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Dr S. KONE Philippe, Maître Assistant à l’EISMV MEMBRE : M. TOGUEBAYE Bhen Sikina, Pr à la FST de l’UCAD/M. SAWADOGO Germain Jérôme, Pr à l’EISMV de Dakar/M. SAWADOGO Germain Jérôme, Pr à l’EISMV de Dakar/M. SYLLA Babacar Sérigne Khalifa, maitre-assistant à l'EISMV de Dakar DATE DE SOUTENANCE : 16/04/2014 PAYS : BURKINA FASO Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1216 Appréciation des risques de contamination microbienne de la viande de petits ruminants dans les abattoirs et dibiteries de Dakar, Sénégal [texte imprimé] / Bernadette Yougbaré, Auteur . - Dakar : EISMV, 2014 . - 30 p.
PAYS:Burkina Faso
DSOUT:16/04/2014
Langues : Français (fre)
Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2014 Mots-clés : VIANDE CHEVRE MOUTON CONTAMINATION CONTROLE DE QUALITE ABATTOIR DIBITERIE ANALYSE MICROBIOLOGIQUE SENEGAL Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : Au Sénégal, la viande rouge est considérée comme un aliment de choix en raison de sa valeur
nutritive. Sa richesse en protéines et la nature de celle-ci en font un aliment indispensable pour une
ration alimentaire équilibrée. Cette filière des viandes rouges notamment , celle des petits ruminants
a permis de développer des métiers de boucherie et une prolifération d'établissements de
restauration ; appelés "Dibiteries". Dans ces dibiteries, la viande est servie aux clients après avoir
subi de nombreuses manipulations et une opération de braisage au feu de bois. Cependant, malgré
ces qualités nutritionnelles, la viande constitue un milieu très favorable à la prolifération
microbienne. Les ouvriers dans les abattoirs et vendeurs de dibiterie ignorant les bonnes pratiques
d’hygiène, contribuent à la dissémination et à la multiplication des germes pathogènes. Ces germes
pouvant être à l’origine de toxi-infections alimentaires chez le consommateur.
La présente étude a pour objectif général d’analyser les risques de contamination microbienne de la
viande de petits ruminants produite dans les abattoirs et vendue dans les dibiteries de Dakar. Pour
ce faire une analyse des risques de contamination de la viande dans les abattoirs et les dibiteries a
été menée selon la méthode de l’OIE. Ainsi, une enquête de type transversale dans les abattoirs,
aires d’abattages de la rue 6 de Médina et dibiteries de Dakar ont permis d’avoir des
renseignements sur la qualité de la viande de l’abattage à la consommation. Des fiches d’enquête
ont été remplies de même que des prélèvements de viandes ont été effectués pour dénombrer les
germes responsables de la contamination. Au total, 138 échantillons de viande (crue et grillée) ont
été analysés pour la recherche des coliformes fécaux, d’Escherichia coli, des Staphylocoques
aureus présumés pathogènes, des anaérobies sulfito réducteurs et de la flore mésophile aérobie à
30°C. La contamination dans les abattoirs et aire d’abattage a indiqué un niveau de contamination
acceptable pour les coliformes fécaux, E. coli et la flore mésophile tandis qu’elle a été satisfaisante
pour les anaéobies sulfito-réducteurs et les staphylocoques. Quant aux dibiteries, 20/40 ont été
jugées non satisfaisantes pour les coliformes fécaux, 18/40 pour E. coli, et 20/40 pour la flore
mésophile. Les anaérobies sulfito-réducteurs et les staphylocoques ont été négligeables.
L’appréciation du risque a pris en compte des schémas événementiels intégrant toutes les étapes
impliquées dans la survenue d’une contamination bactérienne de la viande dans les abattoirs ou
aires d’abattage, pendant le transport, la préparation dans les dibiteries et les conséquences qui en
résultent. Ainsi trois niveaux de risque pour les consommateurs ont été déterminés : i) assez élevé à
très élevé (50,52%) ; ii) très faible à peu élevé (48,95%) ; iii) quasi nul à extrêmement faible
(0,52%).
Au vu de ces résultats, nous avons formulé des recommandations aux différents acteurs afin
d’améliorer la qualité de la viande produite dans les abattoirs et vendue dans les dibiteries.PRESIDENT DE JURY : M. PANGUI Louis Joseph, Pr à l’EISMV de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : Dr S. KONE Philippe, Maître Assistant à l’EISMV MEMBRE : M. TOGUEBAYE Bhen Sikina, Pr à la FST de l’UCAD/M. SAWADOGO Germain Jérôme, Pr à l’EISMV de Dakar/M. SAWADOGO Germain Jérôme, Pr à l’EISMV de Dakar/M. SYLLA Babacar Sérigne Khalifa, maitre-assistant à l'EISMV de Dakar DATE DE SOUTENANCE : 16/04/2014 PAYS : BURKINA FASO Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1216 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité M201 MEM14-14 Mémoire Bibliothèque (SID) Mémoires de Master Disponible Documents numériques

MEM14-14Adobe Acrobat PDFAspects socioéconomiques de l’utilisation des résidus de cultures et sous produits agroindustriels dans l’alimentation des ruminants domestiques à Niamey (Niger) / Lawal Abdoul Aziz Maman (2014)

Titre : Aspects socioéconomiques de l’utilisation des résidus de cultures et sous produits agroindustriels dans l’alimentation des ruminants domestiques à Niamey (Niger) Type de document : texte imprimé Auteurs : Lawal Abdoul Aziz Maman, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2014 Importance : 30 p. Note générale :
Langues : Français (fre) Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2014 Mots-clés : RESIDU DE RECOLTE ALIMENT POUR ANIMAUX SOUS PRODUIT COMMERCIALISATION NIGER Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : Une étude a été menée durant sept semaines (Août-Octobre 2013) dans la
communauté urbaine de Niamey au Niger, afin d’évaluer les aspects
socioéconomiques de l’utilisation des résidus de cultures et des sous produits
agroindustriels sur le développement de l’élevage urbain et périurbain de
Niamey.
En plus des directeurs des services techniques en relation avec ces secteurs,
l’étude a intéressé 49 vendeurs de résidus de culture (RC), 19 vendeurs de sous
produits agroindustriels (SPAI) et 205 éleveurs qui ont été interviewés.
Il a été identifié 113 sites de vente de RC pour 415 points de vente (285 actifs et
130 inactifs), 16 sites de vente de SPAI pour 72 points de vente (63 actifs et 9
inactifs) et les acteurs impliqués dans ces 2 chaînes.
Les résultats de l’enquête ont montré que les vendeurs de RC sont en majorité
des agriculteurs et ont un âge compris entre 40 et 60 ans. Ils sont positionnés sur
les grands axes et aux alentours des marchés. Les RC sont vendus sous deux
formes de conditionnement (bottes, sacs). Les vendeurs de SPAI renferment une
importante frange de jeunes. Parmi les éleveurs, on retrouve des proportions non
négligeables de fonctionnaires et des femmes ménagères. Les animaux
appartiennent en majorité aux chefs d’exploitation et aux femmes.
Il ressort également de cette étude que les RC et SPAI sont plus utilisés pendant
la saison sèche. Les plus utilisés sont les fanes de niébé et le son des céréales
produit localement. Un éleveur utilise en moyenne 5.51±8,21 « tia » (1,66 kg)
de sons pour un coût de 214,58±48,57 FCFA l’unité et 1,91±1,34 bottes (5,5
kg) de fane de niébé pour 627,34±297,25 FCFA la botte.PRESIDENT DE JURY : M. PANGUI Louis Joseph, Pr à l’EISMV de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. SOUMANA GOURO Abdoulaye, Pr à la FA/UAM de Niamey MEMBRE : M. TOGUEBAYE Bhen Sikina, Pr à la FST de l’UCAD/M. SAWADOGO Germain Jérôme, Pr à l’EISMV de Dakar/M. OUEDRAOGO Georges Anicet, Pr à UP de Bobo-Dioulasso/M. NDIAYE Amadou, PhD Enseignant-chercheur à l’UGB de Saint-Louis DATE DE SOUTENANCE : 17/01/2014 PAYS : NIGER Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1131 Aspects socioéconomiques de l’utilisation des résidus de cultures et sous produits agroindustriels dans l’alimentation des ruminants domestiques à Niamey (Niger) [texte imprimé] / Lawal Abdoul Aziz Maman, Auteur . - Dakar : EISMV, 2014 . - 30 p.
Langues : Français (fre)
Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2014 Mots-clés : RESIDU DE RECOLTE ALIMENT POUR ANIMAUX SOUS PRODUIT COMMERCIALISATION NIGER Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : Une étude a été menée durant sept semaines (Août-Octobre 2013) dans la
communauté urbaine de Niamey au Niger, afin d’évaluer les aspects
socioéconomiques de l’utilisation des résidus de cultures et des sous produits
agroindustriels sur le développement de l’élevage urbain et périurbain de
Niamey.
En plus des directeurs des services techniques en relation avec ces secteurs,
l’étude a intéressé 49 vendeurs de résidus de culture (RC), 19 vendeurs de sous
produits agroindustriels (SPAI) et 205 éleveurs qui ont été interviewés.
Il a été identifié 113 sites de vente de RC pour 415 points de vente (285 actifs et
130 inactifs), 16 sites de vente de SPAI pour 72 points de vente (63 actifs et 9
inactifs) et les acteurs impliqués dans ces 2 chaînes.
Les résultats de l’enquête ont montré que les vendeurs de RC sont en majorité
des agriculteurs et ont un âge compris entre 40 et 60 ans. Ils sont positionnés sur
les grands axes et aux alentours des marchés. Les RC sont vendus sous deux
formes de conditionnement (bottes, sacs). Les vendeurs de SPAI renferment une
importante frange de jeunes. Parmi les éleveurs, on retrouve des proportions non
négligeables de fonctionnaires et des femmes ménagères. Les animaux
appartiennent en majorité aux chefs d’exploitation et aux femmes.
Il ressort également de cette étude que les RC et SPAI sont plus utilisés pendant
la saison sèche. Les plus utilisés sont les fanes de niébé et le son des céréales
produit localement. Un éleveur utilise en moyenne 5.51±8,21 « tia » (1,66 kg)
de sons pour un coût de 214,58±48,57 FCFA l’unité et 1,91±1,34 bottes (5,5
kg) de fane de niébé pour 627,34±297,25 FCFA la botte.PRESIDENT DE JURY : M. PANGUI Louis Joseph, Pr à l’EISMV de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. SOUMANA GOURO Abdoulaye, Pr à la FA/UAM de Niamey MEMBRE : M. TOGUEBAYE Bhen Sikina, Pr à la FST de l’UCAD/M. SAWADOGO Germain Jérôme, Pr à l’EISMV de Dakar/M. OUEDRAOGO Georges Anicet, Pr à UP de Bobo-Dioulasso/M. NDIAYE Amadou, PhD Enseignant-chercheur à l’UGB de Saint-Louis DATE DE SOUTENANCE : 17/01/2014 PAYS : NIGER Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1131 Réservation
Réserver ce document (Actuellement 1 réservation(s) en cours sur cet ouvrage)
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité M189 MEM14-2 Mémoire Bibliothèque (SID) Mémoires de Master Disponible Documents numériques

MEM14-2Adobe Acrobat PDFBien- être des ânes et leurs rôles socio-économiques dans les ménages ruraux du Burkina Faso / Mamounata Tapsoba (2014)

PermalinkCaractérisation moléculaire des souches de Salmonella isolées dans les fermes de poulets de chair de la zone péri- urbaine de Dakar (Sénégal) / Sitraka Arilalaina Andrianony (2014)

PermalinkCaractérisation des mycobactéries isolées chez l’homme et les ruminants domestiques au Tchad : causes des suspicions de la tuberculose dans les hôpitaux et aux abattoirs / Didi Lamireou (2014)

PermalinkCaractérisation des pêcheries du poulpe Octopus Vulgaris (Cuvier, 1797) en saison froide à Kayar et à Mbour (Sénégal) / Christine Yaoua Kouman (2014)

PermalinkCaractéristiques du cycle œstral de deux races caprines du Niger : la chèvre du Sahel et la chèvre rousse de Maradi / Seyni Harouna (2014)

PermalinkContribution à la mise en place d’une démarche HACCP en abattoir de porc : cas de la Société Ivoirienne d’Abattage et de Charcuterie (SIVAC) à Abidjan – Côte d’Ivoire / Claire Brice Valery Senin

PermalinkEffets de la substitution du tourteau d’arachide d’une ration par du tourteau de sésame (Sesamum indicum) sur les performances zootechnico- économiques du poulet de chair à Dakar (Sénégal) / Cé II Zotomy (2014)

PermalinkEffets d’une substitution du tourteau de graines de coton par les gousses d’Acacia raddiana (SAVI) dans l’alimentation, sur les performances laitières du zébu Azawak / Amadou Barthe (2014)

PermalinkEtude de la commercialisation du poisson frais dans la communauté urbaine de Niamey (Niger) / Abdou Oumarou Ali (2014)

PermalinkEtude préliminaire sur l’utilisation des antibiotiques dans les élevages de poules pondeuses et la présence de résidus d’antibiotiques dans les œufs commercialisés à Ouagadougou / Lamouni Habibata Zerbo (2014)

Permalink