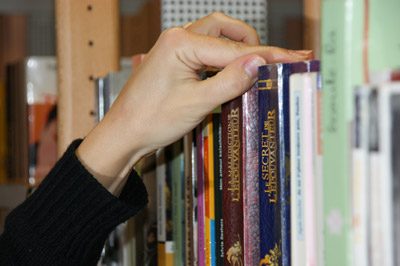EISMV DE DAKAR: Service d'Information et de Documentation
Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (39)


 Interroger des sources externes
Interroger des sources externesAmélioration des stratégies de lutte contre les mouches tsé- tsé et la trypanosomose bovine dans les départements de Say et Torodi (Niger) / Moumouni Harouna (2016)

Titre : Amélioration des stratégies de lutte contre les mouches tsé- tsé et la trypanosomose bovine dans les départements de Say et Torodi (Niger) Type de document : texte imprimé Auteurs : Moumouni Harouna, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2016 Importance : 30 p. Note générale :
Langues : Français (fre) Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2016 Mots-clés : TRYPANOSOMOSE BOVIN NIGER Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : Ce travail avait pour but à améliorer les stratégies de lutte contre la trypanosomose
bovine et les mouches tsé-tsé au Niger. Cette étude a été conduite durant la période
de janvier à mars 2015. Une étape préliminaire a consisté en une prospection
entomologique sur les rivières boisées de la Tapoa et de la Mékrou dans le parc
national W où elle a révélé la présence de deux espèces de glossines (Glossina
tachinoides et Glossina morsitans submorsitans). L’espèce Glossina tachinoides reste
la plus dominante et représente 98,74% de la capture.
Une enquête parasitologique et sérologique sur la trypanosomose bovine a été
ensuite réalisée dans les cinq (5) communes de Say et Torodi sur 384 bovins choisis
sur la base d’un échantillonnage aléatoire simple. L’âge, le sexe des animaux et le
mode d’élevage ont été enregistrés. Les examens parasitologiques basés sur la
méthode d’étalements sanguins colorés au May-Grunwald Giemsa, la mesure de
l’hématocrite, et les tests Elisa-indirect ont été réalisés au laboratoire.
La technique parasitologique a révélé un taux de prévalence globale de 2,34 ±1,5%
pour T. vivax et T. congolense. Les examens sérologiques ont fourni une
séroprévalence de 55,98±4,9% pour les trois tests confondus. Ils ont permis
d’identifier les trois espèces de trypanosomes pathogènes: 26,56 ±4,4 % pour T.
vivax, 15,62±3,6% pour T. congolense et 13,8±3,4% pour T. brucei avec une
prédominance des infections par T. vivax.
Ces résultats ont montré que la trypanosomose bovine est présente dans ces cinq
communes enquêtées et qu’elle demeure une préoccupation majeure pour les
éleveurs.PRESIDENT DE JURY : M. KABORET Yalacé Yamba, Pr à l’EISMV de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. KONE Philippe, Maître de conférences à l’EISMV de Dakar, M. ADAKAL Hassane, Chargé de cherches (DSTE) Maradi-Niger MEMBRE : M. SAWADOGO Germain Jérôme, Pr à l’EISMV de Dakar/Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar /M. GBATI Oubri Bassa, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar DATE DE SOUTENANCE : 15/04/2016 PAYS : NIGER Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1740 Amélioration des stratégies de lutte contre les mouches tsé- tsé et la trypanosomose bovine dans les départements de Say et Torodi (Niger) [texte imprimé] / Moumouni Harouna, Auteur . - Dakar : EISMV, 2016 . - 30 p.
Langues : Français (fre)
Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2016 Mots-clés : TRYPANOSOMOSE BOVIN NIGER Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : Ce travail avait pour but à améliorer les stratégies de lutte contre la trypanosomose
bovine et les mouches tsé-tsé au Niger. Cette étude a été conduite durant la période
de janvier à mars 2015. Une étape préliminaire a consisté en une prospection
entomologique sur les rivières boisées de la Tapoa et de la Mékrou dans le parc
national W où elle a révélé la présence de deux espèces de glossines (Glossina
tachinoides et Glossina morsitans submorsitans). L’espèce Glossina tachinoides reste
la plus dominante et représente 98,74% de la capture.
Une enquête parasitologique et sérologique sur la trypanosomose bovine a été
ensuite réalisée dans les cinq (5) communes de Say et Torodi sur 384 bovins choisis
sur la base d’un échantillonnage aléatoire simple. L’âge, le sexe des animaux et le
mode d’élevage ont été enregistrés. Les examens parasitologiques basés sur la
méthode d’étalements sanguins colorés au May-Grunwald Giemsa, la mesure de
l’hématocrite, et les tests Elisa-indirect ont été réalisés au laboratoire.
La technique parasitologique a révélé un taux de prévalence globale de 2,34 ±1,5%
pour T. vivax et T. congolense. Les examens sérologiques ont fourni une
séroprévalence de 55,98±4,9% pour les trois tests confondus. Ils ont permis
d’identifier les trois espèces de trypanosomes pathogènes: 26,56 ±4,4 % pour T.
vivax, 15,62±3,6% pour T. congolense et 13,8±3,4% pour T. brucei avec une
prédominance des infections par T. vivax.
Ces résultats ont montré que la trypanosomose bovine est présente dans ces cinq
communes enquêtées et qu’elle demeure une préoccupation majeure pour les
éleveurs.PRESIDENT DE JURY : M. KABORET Yalacé Yamba, Pr à l’EISMV de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. KONE Philippe, Maître de conférences à l’EISMV de Dakar, M. ADAKAL Hassane, Chargé de cherches (DSTE) Maradi-Niger MEMBRE : M. SAWADOGO Germain Jérôme, Pr à l’EISMV de Dakar/Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar /M. GBATI Oubri Bassa, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar DATE DE SOUTENANCE : 15/04/2016 PAYS : NIGER Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1740 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité M249 MEM16-8 Mémoire Bibliothèque (SID) Mémoires de Master Disponible Documents numériques

MEM16-8Adobe Acrobat PDFAnalyse des contraintes et atouts de la diffusion et de l’adoption du traitement de la paille à l’urée et de l’utilisation de blocs multi- nutritionnels dans le Delta du Sénégal / Papa Amadou Moctar Gaye (2016)

Titre : Analyse des contraintes et atouts de la diffusion et de l’adoption du traitement de la paille à l’urée et de l’utilisation de blocs multi- nutritionnels dans le Delta du Sénégal Type de document : texte imprimé Auteurs : Papa Amadou Moctar Gaye, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2016 Importance : 30 p. Note générale :
Langues : Français (fre) Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2016 Mots-clés : SOUS PRODUIT PAILLE UREE ALIMENT POUR ANIMAUX BLOC A LECHER ALIMENTATION DES ANIMAUX BOVIN SENEGAL Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : Notre étude, qui avait pour objectif général d’identifier les contraintes majeures qui
entravent le transfert et l’adoption des technologies améliorées (traitement de la paille à l’urée
et utilisation de blocs multi nutritionnels) dans le département de Dagana (Sénégal) et de
proposer des mécanismes permettant de les lever, s’est déroulée du 4 mai au 13 juin 2015. Dans
le but d’atteindre cet objectif, des questionnaires et guides d’entretien ont été adressés aux
différents acteurs intervenant ou pouvant jouer un rôle (éleveurs formés, représentants
d’associations de producteurs, fonctionnaires de l’état, cadres d’ONG, d’entreprises privés et
responsables d’instituts financiers) dans la vulgarisation des technologies précitées. Les
données d’enquêtes ont par la suite fait l’objet de tableaux de contingence pour déterminer les
interactions entre les facteurs susceptibles d’influencer l’adoption ou non de ces technologies.
Les résultats obtenus montrent que trois principaux problèmes entravent l’adoption du
traitement de la paille à l’urée (3,3 % d’adoption) et l’utilisation des BMU (21,7 % d’adoption).
D’abord, des technologies inadaptées aux systèmes d’élevage. En effet, malgré le fait que la
démarche ait été participative, 63,4 % des éleveurs formés pratiquent un élevage transhumant,
donc inadapté au traitement de la paille à l’urée. Cette transhumance est d’autant plus fréquente
chez les éleveurs possédant des effectifs importants (des 19 éleveurs qui pratiquent la
transhumance, 16 ont un effectif de cheptel compris entre 1 et 10 têtes de bétail) et chez ceux
possédant des métis (un seul éleveur possédant des bovins métis sur 21 pratique la
transhumance.
Ensuite, des sous-produits inaccessibles pour les producteurs en raison : i) de leur prix
exorbitant en période de soudure, ii) du gaspillage de la paille de riz, encore brulée et de la
paille de canne qui n’est pas utilisée de façon optimale et iii) de l’absence de rationnement des
aliments.
Enfin, nous avons signalé l’absence de coordination dans les différentes actions de vulgarisation
menées par les acteurs de l’élevagePRESIDENT DE JURY : M. KABORET Yalacé Yamba, Pr à l’EISMV de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. TRAORE El Hadji, Maitre de recherche à l’ISRA, M. AYSIWEDE Simplice, Maitre-assistant à l’EISMV MEMBRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar /M. TOGUEBAYE Bhen Sikina, Pr à la FST/UCAD/M. DIENG Abdoulaye, Pr à l’ENSA de THIES CO-DIRECTEUR : M. SALL Cheikh, Chargé de recherche à l’ISRA/Mme CAMARA Astou Diao, Chargé de recherche à l’ISRA DATE DE SOUTENANCE : 10/05/2016 PAYS : Sénégal Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1750 Analyse des contraintes et atouts de la diffusion et de l’adoption du traitement de la paille à l’urée et de l’utilisation de blocs multi- nutritionnels dans le Delta du Sénégal [texte imprimé] / Papa Amadou Moctar Gaye, Auteur . - Dakar : EISMV, 2016 . - 30 p.
Langues : Français (fre)
Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2016 Mots-clés : SOUS PRODUIT PAILLE UREE ALIMENT POUR ANIMAUX BLOC A LECHER ALIMENTATION DES ANIMAUX BOVIN SENEGAL Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : Notre étude, qui avait pour objectif général d’identifier les contraintes majeures qui
entravent le transfert et l’adoption des technologies améliorées (traitement de la paille à l’urée
et utilisation de blocs multi nutritionnels) dans le département de Dagana (Sénégal) et de
proposer des mécanismes permettant de les lever, s’est déroulée du 4 mai au 13 juin 2015. Dans
le but d’atteindre cet objectif, des questionnaires et guides d’entretien ont été adressés aux
différents acteurs intervenant ou pouvant jouer un rôle (éleveurs formés, représentants
d’associations de producteurs, fonctionnaires de l’état, cadres d’ONG, d’entreprises privés et
responsables d’instituts financiers) dans la vulgarisation des technologies précitées. Les
données d’enquêtes ont par la suite fait l’objet de tableaux de contingence pour déterminer les
interactions entre les facteurs susceptibles d’influencer l’adoption ou non de ces technologies.
Les résultats obtenus montrent que trois principaux problèmes entravent l’adoption du
traitement de la paille à l’urée (3,3 % d’adoption) et l’utilisation des BMU (21,7 % d’adoption).
D’abord, des technologies inadaptées aux systèmes d’élevage. En effet, malgré le fait que la
démarche ait été participative, 63,4 % des éleveurs formés pratiquent un élevage transhumant,
donc inadapté au traitement de la paille à l’urée. Cette transhumance est d’autant plus fréquente
chez les éleveurs possédant des effectifs importants (des 19 éleveurs qui pratiquent la
transhumance, 16 ont un effectif de cheptel compris entre 1 et 10 têtes de bétail) et chez ceux
possédant des métis (un seul éleveur possédant des bovins métis sur 21 pratique la
transhumance.
Ensuite, des sous-produits inaccessibles pour les producteurs en raison : i) de leur prix
exorbitant en période de soudure, ii) du gaspillage de la paille de riz, encore brulée et de la
paille de canne qui n’est pas utilisée de façon optimale et iii) de l’absence de rationnement des
aliments.
Enfin, nous avons signalé l’absence de coordination dans les différentes actions de vulgarisation
menées par les acteurs de l’élevagePRESIDENT DE JURY : M. KABORET Yalacé Yamba, Pr à l’EISMV de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. TRAORE El Hadji, Maitre de recherche à l’ISRA, M. AYSIWEDE Simplice, Maitre-assistant à l’EISMV MEMBRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar /M. TOGUEBAYE Bhen Sikina, Pr à la FST/UCAD/M. DIENG Abdoulaye, Pr à l’ENSA de THIES CO-DIRECTEUR : M. SALL Cheikh, Chargé de recherche à l’ISRA/Mme CAMARA Astou Diao, Chargé de recherche à l’ISRA DATE DE SOUTENANCE : 10/05/2016 PAYS : Sénégal Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1750 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité M253 MEM16-12 Mémoire Bibliothèque (SID) Mémoires de Master Disponible Documents numériques

MEM16-12Adobe Acrobat PDFAnalyse des pratiques de l’élevage bovin autour du gisement minier de Sabodala dans la région de Kédougou (Sénégal) / Ahmadou Nouh Sow (2016)

Titre : Analyse des pratiques de l’élevage bovin autour du gisement minier de Sabodala dans la région de Kédougou (Sénégal) Type de document : texte imprimé Auteurs : Ahmadou Nouh Sow, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2016 Importance : 30 p. Langues : Français (fre) Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2016 Mots-clés : METHODE D’ELEVAGE SENEGAL Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : A l’instar d’autres pays au Sud du Sahara, l’élevage au Sénégal est dominé par un système
extensif. Ce système d’élevage est confronté à de nombreuses difficultés qui impactent
négativement sur les revenus des éleveurs. Afin de mieux cerner les pratiques de cet
élevage et les éventuelles causes de la mortalité bovine déclarée, dans la région de
Kédougou, une étude a été menée dans la commune de Sabodala, plus précisément autour
du gisement minier de ladite commune. Cette étude a consisté à recueillir des données soit
à travers une revue bibliographique, soit par des entretiens auprès de 70 éleveurs de
bovins, et ce d’Avril à Octobre 2015.Ainsi, dans la zone enquêtée, l’élevage bovin est
mené par des hommes, âgés de plus de 50 ans (65,7% des cas), d’ethnies surtout Malinkés
(71,5%) et Peulhs (21,4%), instruits à 41,4%. Plusieurs catégories socioprofessionnelles
sont impliquées dans cette activité d’élevage, mais la majorité des éleveurs sont des agro
éleveurs (84,3%). Cet élevage est pratiqué pour des raisons socioéconomiques et 84,3%
des éleveurs utilisent un fonds propre pour démarrer les activités. Les bovins sont laissés
en divagation (87,1% des cas) sauf en saison des pluies pendant laquelle ils sont tous
parqués et conduits par des bergers. Les troupeaux bovins exploitent les parcours naturels,
situés en dehors du périmètre minier, et sont souvent dotés de forages pastoraux exploités
par 49,2% des enquêtés pour abreuver leur bétail. La vaccination des bovins est effective
à 100% grâce au soutien de la société minière sur place. Quant au déparasitage, 21,4%
éleveurs administrent des déparasitants internes et externes et seulement 7,8%
administrent des déparasitants antihémoparasites. Le traitement des animaux est assuré,
dans 92,9% des cas, par l’éleveur lui-même. L’élevage bovin, dans la zone de Sabodala,
est confronté à des contraintes diverses (81,4% des cas) liées aux pratiques d’élevage
(55,6%), l’alimentation (27,4%) et la santé (17,0%). L’analyse statistique n’a montré
aucun facteur de risque, parmi les indicateurs considérés (composantes de la conduite
d’élevage), pour expliquer les mortalités déclarées (p> 0,05), bien qu’il y ait une
différence significative entre le taux de mortalités des bovins en fonction des saisons
(p<0,05 avec p = 8,523.10-13) avec une mortalité plus élevée en saison sèche (87,7%).PRESIDENT DE JURY : M. KABORET Yalacé Yamba, Pr à l’EISMV de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. KANE Yaghouba, Maître de Conférences agrégé à l’EISMV de Dakar MEMBRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar /M. SAWADOGO Germain Jérôme, Pr à l’EISMV de Dakar/M. NDIAYE Amadou, Maître Assistant à l’UGB de Saint Louis CO-DIRECTEUR : M. OLICHON Sébastien, Agro-pastoraliste DATE DE SOUTENANCE : 21/05/2016 PAYS : Mali Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1764 Analyse des pratiques de l’élevage bovin autour du gisement minier de Sabodala dans la région de Kédougou (Sénégal) [texte imprimé] / Ahmadou Nouh Sow, Auteur . - Dakar : EISMV, 2016 . - 30 p.
Langues : Français (fre)
Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2016 Mots-clés : METHODE D’ELEVAGE SENEGAL Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : A l’instar d’autres pays au Sud du Sahara, l’élevage au Sénégal est dominé par un système
extensif. Ce système d’élevage est confronté à de nombreuses difficultés qui impactent
négativement sur les revenus des éleveurs. Afin de mieux cerner les pratiques de cet
élevage et les éventuelles causes de la mortalité bovine déclarée, dans la région de
Kédougou, une étude a été menée dans la commune de Sabodala, plus précisément autour
du gisement minier de ladite commune. Cette étude a consisté à recueillir des données soit
à travers une revue bibliographique, soit par des entretiens auprès de 70 éleveurs de
bovins, et ce d’Avril à Octobre 2015.Ainsi, dans la zone enquêtée, l’élevage bovin est
mené par des hommes, âgés de plus de 50 ans (65,7% des cas), d’ethnies surtout Malinkés
(71,5%) et Peulhs (21,4%), instruits à 41,4%. Plusieurs catégories socioprofessionnelles
sont impliquées dans cette activité d’élevage, mais la majorité des éleveurs sont des agro
éleveurs (84,3%). Cet élevage est pratiqué pour des raisons socioéconomiques et 84,3%
des éleveurs utilisent un fonds propre pour démarrer les activités. Les bovins sont laissés
en divagation (87,1% des cas) sauf en saison des pluies pendant laquelle ils sont tous
parqués et conduits par des bergers. Les troupeaux bovins exploitent les parcours naturels,
situés en dehors du périmètre minier, et sont souvent dotés de forages pastoraux exploités
par 49,2% des enquêtés pour abreuver leur bétail. La vaccination des bovins est effective
à 100% grâce au soutien de la société minière sur place. Quant au déparasitage, 21,4%
éleveurs administrent des déparasitants internes et externes et seulement 7,8%
administrent des déparasitants antihémoparasites. Le traitement des animaux est assuré,
dans 92,9% des cas, par l’éleveur lui-même. L’élevage bovin, dans la zone de Sabodala,
est confronté à des contraintes diverses (81,4% des cas) liées aux pratiques d’élevage
(55,6%), l’alimentation (27,4%) et la santé (17,0%). L’analyse statistique n’a montré
aucun facteur de risque, parmi les indicateurs considérés (composantes de la conduite
d’élevage), pour expliquer les mortalités déclarées (p> 0,05), bien qu’il y ait une
différence significative entre le taux de mortalités des bovins en fonction des saisons
(p<0,05 avec p = 8,523.10-13) avec une mortalité plus élevée en saison sèche (87,7%).PRESIDENT DE JURY : M. KABORET Yalacé Yamba, Pr à l’EISMV de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. KANE Yaghouba, Maître de Conférences agrégé à l’EISMV de Dakar MEMBRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar /M. SAWADOGO Germain Jérôme, Pr à l’EISMV de Dakar/M. NDIAYE Amadou, Maître Assistant à l’UGB de Saint Louis CO-DIRECTEUR : M. OLICHON Sébastien, Agro-pastoraliste DATE DE SOUTENANCE : 21/05/2016 PAYS : Mali Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1764 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité M258 MEM16-17 Mémoire Bibliothèque (SID) Mémoires de Master Disponible Documents numériques

MEM16-17Adobe Acrobat PDFAnalyse zootechnico-économique des systèmes d’élevage du porc dans la région naturelle de la Casamance (Sénégal) / Félix Nimbona (2016)

Titre : Analyse zootechnico-économique des systèmes d’élevage du porc dans la région naturelle de la Casamance (Sénégal) Type de document : texte imprimé Auteurs : Félix Nimbona, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2016 Importance : 30 p. Note générale :
Langues : Français (fre) Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2016 Mots-clés : SYSTEME D’ELEVAGE PORC SENEGAL Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : Une étude diagnostique a été conduite auprès de 324 élevages porcins sous forme
d’enquêtes dans les 3 régions de la Casamance naturelle (sud du Sénégal), pour décrire les
caractéristiques zootechnico-économiques de l’élevage du porc.
Les résultats ont montré que la proportion des hommes propriétaires des porcs (50,15%)
est sensiblement équivalente à celle des femmes (49,85%). Ces éleveurs sont
majoritairement issus des ethnies Diola (41,27%) et Mancagne (36,51%). Ils sont pour la
plupart mariés (65,31%) et instruits (74,06%). Près d’un quart (24,76%) des éleveurs
associent l’élevage porcin à l’agriculture. Ils évoluent dans trois systèmes différents :
traditionnel, semi-intensif et intensif. Le système traditionnel est dominant (85,49 %) et
exploite principalement la race locale (90,43% des exploitations). Dans ce système,
l’élevage est de type naisseur-engraisseur. La taille moyenne du cheptel est de
19,24±20,06 porcs par exploitation. Les porcheries traditionnelles améliorées (51,13%) et
des abris de fortunes (28,43%) sont les habitats les plus dominants. L’accès aux aliments
de porcs est difficile (90,22%), une raison qui ouvre la porte à la divagation avec
claustration saisonnière (73,68%). Les aliments distribués aux porcs sont formulés
essentiellement par les éleveurs eux-mêmes (97,04%) et sont constitués de déchets
alimentaires, de restes de cuisine, de fruits, etc. Les éleveurs dans 98,13% de cas ne
contrôlent pas la reproduction des porcs qui se fait par monte naturelle dans toutes les
exploitations. L’âge moyen à la mise à la reproduction est de 7,56 ±1,76 mois et la taille
moyenne de la portée est de 7,36±2,18 porcelets. Le sevrage se fait selon la volonté de la
truie entre 3 à 6 mois (86,14%). Les pratiques telles que la castration (96,76%) et le
marquage à l’oreille (74,52%) sont réalisées essentiellement par les éleveurs.
Au plan sanitaire, il y a peu de médicaments vétérinaires sur le marché et d’agents de santé
qui s’intéressent à l’élevage de porcs. Ainsi, en cas de maladie, 33,94% des éleveurs
n’appliquent aucun traitement tandis que 35,04% utilisent des médicaments traditionnels.
Les problèmes sanitaires et alimentaires sont de loin les principaux facteurs limitant à la
production porcine dans la région de Casamance.
Au plan économique, ce sous-secteur d’élevage a un réel potentiel de réduction de la
pauvreté car les éleveurs de porc, même dans la forme traditionnelle, arrivent à dégager un
bénéfice net de 7566,45 FCFA par porc engraissé et vendu.PRESIDENT DE JURY : M. KABORET Yalacé Yamba, Pr à l’EISMV de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. AYSSIWEDE Simplice Bosco, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar MEMBRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar /Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar /M. ASSANE Moussa, Pr à l’EISMV de Dakar CO-DIRECTEUR : M. OSSEBI Walter, Maître – Assistant à l’E.I.S.M.V. de Dakar DATE DE SOUTENANCE : 22/12/2016 PAYS : Burundi Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1941 Analyse zootechnico-économique des systèmes d’élevage du porc dans la région naturelle de la Casamance (Sénégal) [texte imprimé] / Félix Nimbona, Auteur . - Dakar : EISMV, 2016 . - 30 p.
Langues : Français (fre)
Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2016 Mots-clés : SYSTEME D’ELEVAGE PORC SENEGAL Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : Une étude diagnostique a été conduite auprès de 324 élevages porcins sous forme
d’enquêtes dans les 3 régions de la Casamance naturelle (sud du Sénégal), pour décrire les
caractéristiques zootechnico-économiques de l’élevage du porc.
Les résultats ont montré que la proportion des hommes propriétaires des porcs (50,15%)
est sensiblement équivalente à celle des femmes (49,85%). Ces éleveurs sont
majoritairement issus des ethnies Diola (41,27%) et Mancagne (36,51%). Ils sont pour la
plupart mariés (65,31%) et instruits (74,06%). Près d’un quart (24,76%) des éleveurs
associent l’élevage porcin à l’agriculture. Ils évoluent dans trois systèmes différents :
traditionnel, semi-intensif et intensif. Le système traditionnel est dominant (85,49 %) et
exploite principalement la race locale (90,43% des exploitations). Dans ce système,
l’élevage est de type naisseur-engraisseur. La taille moyenne du cheptel est de
19,24±20,06 porcs par exploitation. Les porcheries traditionnelles améliorées (51,13%) et
des abris de fortunes (28,43%) sont les habitats les plus dominants. L’accès aux aliments
de porcs est difficile (90,22%), une raison qui ouvre la porte à la divagation avec
claustration saisonnière (73,68%). Les aliments distribués aux porcs sont formulés
essentiellement par les éleveurs eux-mêmes (97,04%) et sont constitués de déchets
alimentaires, de restes de cuisine, de fruits, etc. Les éleveurs dans 98,13% de cas ne
contrôlent pas la reproduction des porcs qui se fait par monte naturelle dans toutes les
exploitations. L’âge moyen à la mise à la reproduction est de 7,56 ±1,76 mois et la taille
moyenne de la portée est de 7,36±2,18 porcelets. Le sevrage se fait selon la volonté de la
truie entre 3 à 6 mois (86,14%). Les pratiques telles que la castration (96,76%) et le
marquage à l’oreille (74,52%) sont réalisées essentiellement par les éleveurs.
Au plan sanitaire, il y a peu de médicaments vétérinaires sur le marché et d’agents de santé
qui s’intéressent à l’élevage de porcs. Ainsi, en cas de maladie, 33,94% des éleveurs
n’appliquent aucun traitement tandis que 35,04% utilisent des médicaments traditionnels.
Les problèmes sanitaires et alimentaires sont de loin les principaux facteurs limitant à la
production porcine dans la région de Casamance.
Au plan économique, ce sous-secteur d’élevage a un réel potentiel de réduction de la
pauvreté car les éleveurs de porc, même dans la forme traditionnelle, arrivent à dégager un
bénéfice net de 7566,45 FCFA par porc engraissé et vendu.PRESIDENT DE JURY : M. KABORET Yalacé Yamba, Pr à l’EISMV de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. AYSSIWEDE Simplice Bosco, Maître de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar MEMBRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar /Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar /M. ASSANE Moussa, Pr à l’EISMV de Dakar CO-DIRECTEUR : M. OSSEBI Walter, Maître – Assistant à l’E.I.S.M.V. de Dakar DATE DE SOUTENANCE : 22/12/2016 PAYS : Burundi Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1941 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité M278 MEM16-37 Mémoire Bibliothèque (SID) Mémoires de Master Disponible Documents numériques

MEM16-37Adobe Acrobat PDFAppréciation de l’efficacité du nettoyage et de la désinfection au niveau de la restauration universitaire de Dakar / Florentin Njejimana (2016)

Titre : Appréciation de l’efficacité du nettoyage et de la désinfection au niveau de la restauration universitaire de Dakar Type de document : texte imprimé Auteurs : Florentin Njejimana, Auteur Editeur : Dakar : EISMV Année de publication : 2016 Importance : 30p. Note générale :
Langues : Français (fre) Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2016 Mots-clés : RESTAURATION COLLECTIVE NETTOYAGE DESINFECTION HYGIENE DES ALIMENTS CONTROLE DE QUALITE COUD SENEGAL Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : Dans le but d’évaluer l’efficacité du nettoyage
et désinfection dans la restauration
universitaire de Dakar, 100 prélèvements de
surfaces ont été analysés au laboratoire de
microbiologie alimentaire de l’EISMV. Les
germes témoins de l’hygiène : les Coliformes
Thermotolérants et la FMAT ont été
recherchés.
Ces analyses ont été faites selon les méthodes
horizontales de l’AFNOR et interprétées selon
la DGAL/France (N2003-8066) pour les C.T et
le forum des hygiénistes et technologues
alimentaires pour la FMAT.
Il ressort de cette étude que :
- Sur les 100 échantillons analysés, 39 % et
13 % sont satisfaisants respectivement
pour les C.T et la FMAT
- En fonction des Restaurants, les
échantillons sont satisfaisants
respectivement par rapport aux C.T et à la
FMAT de manière suivante :
? Restaurant A, 60 % et 8 %
? Restaurant B, 44% et 16%
? Restaurant C, 24% et 16%
? Restaurant D, 28 % et 12%
Les résultats montrent que l’hygiène des
surfaces n’est pas satisfaisante dans la
restauration Universitaire de Dakar. C’est
pourquoi, il serait souhaitable d’assurer la
formation et la sensibilisation du personnel sur
le nettoyage et la désinfection des surfaces et
les bonnes pratiques d’hygiène en général.PRESIDENT DE JURY : M. KABORET Yalacé Yamba, Pr à l’EISMV de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. SYLLA Khalifa Serigne Babacar, Maître – Assistant à l’EISMV de Dakar MEMBRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar /M. TOGUEBAYE Bhen Sikina, Pr de titulaire à la Faculté des Sciences et Techniques (FST) à l’UCAD /M. SEYDI Malang, Pr à l' EISMV DATE DE SOUTENANCE : 19/03/2016 PAYS : Burundi Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1702 Appréciation de l’efficacité du nettoyage et de la désinfection au niveau de la restauration universitaire de Dakar [texte imprimé] / Florentin Njejimana, Auteur . - Dakar : EISMV, 2016 . - 30p.
Langues : Français (fre)
Catégories : MEMOIRES DE MASTER:2016 Mots-clés : RESTAURATION COLLECTIVE NETTOYAGE DESINFECTION HYGIENE DES ALIMENTS CONTROLE DE QUALITE COUD SENEGAL Index. décimale : MEM-MEMOIRE MASTER Résumé : Dans le but d’évaluer l’efficacité du nettoyage
et désinfection dans la restauration
universitaire de Dakar, 100 prélèvements de
surfaces ont été analysés au laboratoire de
microbiologie alimentaire de l’EISMV. Les
germes témoins de l’hygiène : les Coliformes
Thermotolérants et la FMAT ont été
recherchés.
Ces analyses ont été faites selon les méthodes
horizontales de l’AFNOR et interprétées selon
la DGAL/France (N2003-8066) pour les C.T et
le forum des hygiénistes et technologues
alimentaires pour la FMAT.
Il ressort de cette étude que :
- Sur les 100 échantillons analysés, 39 % et
13 % sont satisfaisants respectivement
pour les C.T et la FMAT
- En fonction des Restaurants, les
échantillons sont satisfaisants
respectivement par rapport aux C.T et à la
FMAT de manière suivante :
? Restaurant A, 60 % et 8 %
? Restaurant B, 44% et 16%
? Restaurant C, 24% et 16%
? Restaurant D, 28 % et 12%
Les résultats montrent que l’hygiène des
surfaces n’est pas satisfaisante dans la
restauration Universitaire de Dakar. C’est
pourquoi, il serait souhaitable d’assurer la
formation et la sensibilisation du personnel sur
le nettoyage et la désinfection des surfaces et
les bonnes pratiques d’hygiène en général.PRESIDENT DE JURY : M. KABORET Yalacé Yamba, Pr à l’EISMV de Dakar DIRECTEUR DE THESE OU MEMOIRE : M. SYLLA Khalifa Serigne Babacar, Maître – Assistant à l’EISMV de Dakar MEMBRE : Mme BADA ALAMBEDJI Rianatou, Pr à l’EISMV de Dakar /M. TOGUEBAYE Bhen Sikina, Pr de titulaire à la Faculté des Sciences et Techniques (FST) à l’UCAD /M. SEYDI Malang, Pr à l' EISMV DATE DE SOUTENANCE : 19/03/2016 PAYS : Burundi Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=1702 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité M246 MEM16-5 Mémoire Bibliothèque (SID) Mémoires de Master Disponible Documents numériques

MEM16-5Adobe Acrobat PDFAppréciation du niveau de contamination bactérienne du poisson commercialisé à Niamey (Niger) / Zara Hachimou (2016)

PermalinkAppréciation de la qualité microbiologique des repas servis dans la restauration collective de N’Djamena (Tchad) : Cas d’un restaurant X de N’Djamena / Hadjé Madina Hadjer (2016)

PermalinkAppréciation de la qualité physico-chimique des laits de consommation des élevages et des vendeuses dans la région de Kaolack au Sénégal / Wendmisida Victor Hyacinthe Guigma (2016)

PermalinkCaractérisation fourragère, capacité de charge, élaboration d’un plan d’aménagement et évaluation de ses impacts économiques : cas du centre de multiplication de bétail de Fako (Nord-Dakoro/Niger) / Daouda Sofiani Salou (2016)

PermalinkCaractérisation morphobiométrique et zootechnique de la chèvre du Sahel du Niger / Sayadi Illiassou (2016)

PermalinkCaractérisation des systèmes d’élevage caprin dans la zone urbaine et périurbaine d’Abéché (Tchad) / Romain Daïba Ahmota (2016)

PermalinkCaractéristiques morpho-biométriques et productivité en biomasse fourragère et en grains de cinq (05) variétés de sorgho ((Sorghum bicolor [L.] Moench.) fourrager au Niger. / Kabissiga Oumarou Lompo (2016)

PermalinkCaractéristiques technico- économiques de l’élevage de la pintade Galor en milieu paysan : cas des départements de Tibiri et Birni N’gaouré (Niger) / Mohamed Yacouba Omar Albachir (2016)

PermalinkContribution à l’amélioration de la réactivité du réseau de l’épidémiosurveillance des maladies animales dans la région du Ouaddaï (Tchad) / Souleyman Hachim (2016)

PermalinkContribution à la redynamisation du reseau d’epidemiosurveillance veterinaire en cote d’ivoire / Wilfried Délé Oyetola (2016)

Permalink